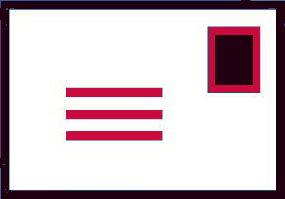Les débats sur
le socialisme comportent toujours des discussions sur les origines
des êtres humains et des institutions sociales. Les révolutionnaires
considèrent l’exploitation de certaines personnes par d’autres,
l’existence d’un Etat oppressif, et la subordination des femmes
aux hommes dans la famille nucléaire comme des résultats de
l’histoire humaine. Nos adversaires les voient comme des produits
de la nature humaine.
C’est la raison pour laquelle Marx et Engels,
lorsqu’ils ont commencé à formuler leurs idées, l’ont fait en
développant une compréhension complètement nouvelle de la façon
dont les êtres humains se relient au monde qui les entoure, qui
rejetait les deux visions dominantes de cette relation :
l’idéalisme, qui voit les êtres humains comme semi-divins,
assujettis à la volonté de Dieu et complètement coupés du monde
animal ; et le matérialisme vulgaire, qui considère les
humains comme ni plus ni moins que des machines ou des animaux qui,
soit réagissent à des stimuli du monde extérieur (ce qu’on
appelle aujourd’hui le « behaviorisme »), soit sont
biologiquement programmés pour se comporter d’une manière donnée
(la « sociobiologie »).1
Marx et Engels ont présenté leurs idées dans
L’idéologie
allemande et les Thèses
sur Feuerbach de 1845-46. Ils y traitaient les êtres humains
comme des produits du monde biologique naturel, et l’histoire comme
une partie de l’histoire naturelle. Mais ils voyaient aussi le
caractère spécifique des humains dans leur capacité à réagir aux
circonstances qui les avaient créés, changeant à la fois ces
circonstances et eux-mêmes au cours de ce processus. Les
connaissances, tant sur l’histoire naturelle que sur l’histoire
humaine, étaient encore très limitées à l’époque où Marx et
Engels ont formulé leurs idées pour la première fois : la
découverte des premiers restes humains (l’homme de Néandertal) ne
devait pas avoir lieu avant 1856 ; L’origine
des espèces, de Darwin, ne fut pas publiée avant 1859 et sa
Descendance
de l’homme avant 1871 ; et l’Américain Henry Morgan ne
publia son œuvre pionnière sur l’évolution de la famille et de
l’Etat, La société ancienne, qu’en 1877.
Engels s’appuya sur ces avancées scientifiques
pour approfondir les travaux qu’il avait abordés en compagnie de
Marx. Il publia deux textes importants, Le
rôle du travail dans la transformation du singe en homme (écrit
en 1876)2
et L’origine
de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (1884)3,
qui contiennent une exposition extensive, par les fondateurs du
matérialisme historique, de la façon dont les êtres humains en
sont venus à vivre comme ils vivent aujourd’hui – d’où
proviennent la « nature humaine » et les institutions
humaines. C’est la raison pour laquelle les attaques contre le
marxisme et la réputation d’Engels se sont souvent concentrées
sur ces textes – en particulier sur L’origine de la famille.
Les découvertes scientifiques du siècle passé ont, bien
évidemment, rendu en partie caduc le matériel utilisé par Engels :
il écrivait avant la découverte de la théorie génétique
mendélienne4
,
avant que les premiers restes d’hominidés ne soient mis au jour en
Afrique, et à une époque où la recherche sur les sociétés sans
écriture était dans son enfance. Ses écrits conservent néanmoins
une importance énorme en ce sens qu’il y applique une méthode qui
est matérialiste sans être mécanique – et qui continue à défier
à la fois l’idéalisme et les frères ennemis du behaviorisme et
de la sociobiologie.
C’est la raison pour laquelle il est important
d’examiner l’argumentation de ces deux ouvrages et de défendre
ce qui y demeure valide, tout en éliminant ce qui est périmé.
C’est ce que je tente de faire, en jetant mon regard d’abord sur
l’évolution humaine telle qu’exposée dans Le rôle du
travail, puis sur l’explication de l’émergence des classes
et de l’Etat dans L’origine de la famille, pour arriver
finalement à l’analyse de l’oppression des femmes contenue dans
ce dernier texte. Dans chaque cas, j’essaierai de résoudre les
manques et les inexactitudes contenus dans l’argumentation
d’Engels, en présentant les avancées récentes sur ces questions.
I. Le
débat sur les origines des êtres humains
Engels présentait sa vision des origines des
êtres humains dans des paragraphes qu’il me parait bon de
reproduire ici presque intégralement :
Il y a plusieurs centaines de milliers
d’années, à une période encore impossible à déterminer avec
certitude (...) vivait quelque part dans la zone tropicale (...) une
race de singes anthropoïdes (...) ils vivaient en bandes sur les
arbres (...)
Ces singes commencèrent à perdre
l’habitude de s’aider de leurs mains pour marcher sur le sol et
adoptèrent de plus en plus une démarche verticale. Ainsi était
franchi le pas décisif dans le
passage du singe à l’homme.
Les opérations auxquelles nos ancêtres
(...) ont appris à adapter peu à peu leurs mains (...) (n’étaient)
au début que des opérations très simples (...) Mais le pas décisif
était accompli : la main s’était libérée ; elle
pouvait désormais acquérir de plus en plus d’habiletés
nouvelles.
Utiliser la main pour le travail avait d’autres
effets :
Nos ancêtres simiesques étaient des
êtres sociables (...) le développement du travail a nécessairement
contribué à resserrer les liens entre les membres de la société
en multipliant les cas d’assistance mutuelle, de coopération
commune, et en rendant plus claire chez chaque individu la conscience
de l’utilité de cette coopération. Bref, les hommes en formation
en arrivèrent au point où ils avaient réciproquement quelque
chose à se dire. Le besoin se créa son organe, le larynx non
développé du singe se transforma, lentement mais sûrement, grâce
à la modulation pour s’adapter à une modulation sans cesse
développée, et les organes de la bouche apprirent peu à peu à
prononcer un son articulé après l’autre.
En parallèle, il y eut le nécessaire
développement du cerveau : « Le développement du cerveau
et des sens qui lui sont subordonnés, la clarté croissante de la
conscience, le perfectionnement de la faculté d’abstraction et de
raisonnement ont réagi sur le travail et le langage et n’ont cessé
de leur donner, à l’un et à l’autre, des impulsions sans cesse
nouvelles pour continuer à se perfectionner ». Globalement :
Des centaines de milliers d’années
(...) ont dû s’écouler avant que de la bande de singes grimpant
aux arbres soit sortie une société d’hommes. Mais en fin de
compte, elle existait. Et que trouvons-nous ici encore comme
différence caractéristique entre le troupeau de singes et la
société humaine ? Le travail.
La position d’Engels, par conséquent, consiste
à voir l’évolution humaine comme passant par un certain nombre
d’étapes intermédiaires : la marche sur deux jambes, la
fabrication d’outils et leur emploi, le développement de la main,
la sociabilité, le développement du cerveau et du langage, plus de
contrôle sur la nature, plus de sociabilité, plus de développement
du cerveau et du langage. Sa vision dépendait du travail préalable
de Darwin, et chacun de ces éléments est mentionné par Darwin.
Mais Engels altère l’ordre des étapes de façon significative.
Darwin supposait que la croissance de la taille du
cerveau et de l’intellect s’était produite avant la transition
vers la marche debout et l’utilisation des mains pour façonner des
outils. Engels pensait que la séquence des évènements s’était
déroulée dans l’autre sens. C’est la libération des mains qui
a rendu possible le travail coopératif à une échelle inimaginable
chez les primates, et c’est à partir de là que le cerveau s’est
développé. Comme le dit l’archéologue Bruce Trigger :
Darwin était (...) limité par sa
réticence à remettre en cause la primauté que la pensée
idéaliste, religieuse et philosophique de son temps accordait à la
pensée rationnelle comme le moteur du changement culturel. Par
conséquent, dans son raisonnement sur l’évolution humaine (...)
c’était le développement du cerveau qui avait eu pour résultat
l’usage des outils.5
A l’inverse :
Engels pensait qu’un mode de vie de
plus en plus terrestre avait encouragé (...) l’utilisation
croissante d’outils. Cela provoquait une sélection naturelle en
faveur de la bipédie et de la dextérité manuelle aussi bien (...)
qu’une division du travail plus complexe : la fabrication
d’outils et le développement d’une capacité de langage pour
mieux coordonner les activités productives menèrent à la
transformation graduelle du cerveau d’un singe en celui d’un être
humain moderne.
La vision darwinienne de la séquence des étapes
a dominé la recherche sur les origines humaines pendant près d’une
centaine d’années, menant à la croyance en un « chaînon
manquant » entre les singes et les humains, qui aurait eu un
cerveau volumineux mais une posture simiesque, remettant en cause
toute l’étude de notre évolution. Cela a encouragé l’accueil
réservé pendant une cinquantaine d’années à l’une des plus
grandes fraudes scientifiques de tous les temps : l’affaire
Piltdown, dans laquelle le crâne d’un homme et la mâchoire d’un
singe furent présentés comme les restes d’un de nos ancêtres les
plus reculés. Cela mena au refus, pendant trente ans, de prendre en
considération une authentique découverte, celle faite par Raymond
Dart en Afrique du Sud, des restes d’une créature simiesque qui
avait adopté la marche sur deux jambes. Ce ne fut pas avant la
découverte en 1974 par Donald Johanson d’un squelette complet
vieux de 3,5 millions d’années, pourvu d’un crâne de singe et
ayant adopté la marche debout, que la séquence de Darwin fut
finalement abandonnée.6
C’est seulement alors que les archéologues purent commencer à
expliquer l’évolution d’une série de squelettes vers une
autre.7
Evaluation
de la thèse d’Engels aujourd’hui
Mais si Engels avait, de façon frappante, raison
contre Darwin sur cette question, quelle est la cohérence du reste
de son argumentation ? Nous avons aujourd’hui beaucoup plus de
connaissances qu’à l’époque d’Engels, mais nous avons
toujours d’énormes problèmes pour en faire un tout cohérent.
La plupart des connaissances physiques que nous
avons de nos ancêtres singes et humains reposent sur des trouvailles
de fragments d’os épars, parfois des dents, et de bouts de roche
qui pourraient avoir été des outils. En utilisant de tels
échantillons, ceux qui étudient l’origine humaine doivent essayer
de deviner à quoi ressemblaient les squelettes entiers, la nature
des nerfs et des muscles qui les entouraient, les capacités
intellectuelles des individus auxquels ils appartenaient, comment ils
se nourrissaient et dans quel contexte social ils vivaient. Comme l’a
dit un des archéologues britanniques les plus renommés, Chris
Stinger :
Le champ de l’évolution humaine est
encombré d’ancêtres, abandonnés avec les théories qui allaient
avec. (...) L’échec à comprendre les complexités entraînées
par la tentative d’interpréter une poignée de fossiles dispersés
dans le temps et l’espace a caractérisé l’approche des
travailleurs les plus compétents, résultant en interprétations
naïves. (...) Par conséquent, des édifices évolutionnistes
entiers se sont effondrés, avec ancêtres et descendants, à chaque
nouveau développement de la théorie, de l’investigation d’une
supposition sous-jacente ou d’une nouvelle découverte.8
Par exemple, jusqu’à la fin des années 1970 on
croyait qu’il y avait eu quatre âges glaciaires dans les 800 000
dernières années. On pense aujourd’hui qu’il y en a eu au moins
huit.9
De même, on acceptait il y a vingt ans l’idée que la séparation
de nos ancêtres des grands singes s’était produite avec un
primate appelé ramapithèque, il y a 15 millions d’années.
Maintenant on considère habituellement que la séparation s’est
faite avec l’évolution des « singes du sud », ou
australopithèques, qui vivaient en Afrique de l’Est et du Sud il y
a 3 ou 4 millions d’années.10
La rareté des informations fiables facilite
l’élaboration de conjectures sans substance sur ce qui pourrait
s’être passé, sans faits pour confirmer ou réfuter – la
version moderne des « histoires comme ça » écrites par
Rudyard Kipling pour les enfants il y a une centaine d’années.
Toutes sortes de spécialistes de l’évolution humaine font des
hypothèses du genre : « Ainsi, peut-être, pouvons-nous
expliquer la descente de certains singes des arbres par le besoin de
faire X ». Au bout de quelques paragraphes, le
« peut-être »
a disparu, et X devient l’origine de l’humanité.
Cette méthode est la marque des
sociobiologistes11
,
mais il y a aussi de très bons théoriciens qui y succombent à
l’occasion.12
C’est une méthode que les marxistes doivent rejeter. Raconter des
histoires ne nous intéresse pas. Nous allons donc nous concentrer
sur ce que nous savons avec certitude.
L'état
des connaissances : nos cousins
On accepte généralement que nos collatéraux les
plus proches sont les chimpanzés, les bonobos13 et les gorilles.14
L’analyse du matériel génétique suggère que nous avons un
ancêtre commun, datant de 4 à 7 millions d’années et que même
aujourd’hui, après avoir évolué dans des directions différentes,
nous avons avec les chimpanzés 97,5 % de gènes en commun. Sur
le plan génétique, « l’homme et le chimpanzé sont plus
proches que le cheval et l’âne, le chat et le lion, le chien et le
renard ».15
C’est un fait peu confortable pour les
idéalistes de toutes sortes, qui confirme la vision de Marx selon
laquelle l’histoire humaine fait partie de l’histoire naturelle.
Mais souvent des matérialistes mécanistes s’en emparent pour
proclamer que nous sommes simplement des « singes nus »,
et que tous les défauts de la société peuvent être mis sur le
compte de notre constitution génétique de mammifères. Comme
l’explique une version populaire des origines humaines :
La hiérarchie est une institution parmi
tous les animaux sociaux et la tendance à dominer ses semblables est
un instinct vieux de trois ou quatre millions d’années (...) Le
fait que l’humain soit poussé vers l’acquisition de possessions
est la simple expression d’un instinct animal plus vieux de
nombreux siècles que la race humaine elle-même (...) Les
carriéristes répondent à des instincts animaux tout aussi
caractéristiques des babouins, des pies, des morues, que des
hommes.16
Même un texte prétendument plus sophistiqué,
affirmant qu’il prend en compte aussi bien les effets de
l’évolution culturelle que ceux de la génétique, conclut que le
« chauvinisme » et « l’agression de groupe »
découlent de déterminations génétiques – « La réaction à
la peur de l’étranger, la tendance à s’associer avec des
groupes des premiers stades du jeu social et la tendance
intellectuelle à dichotomiser les continuités entre groupes
internes et groupes externes ».17
Vu depuis de semblables positions, le marxisme
repose sur une épouvantable erreur – la « méprise
romantique » qui ne voit pas les bases génétiques des
horreurs de la société moderne et met celles-ci sur le compte de
« l’environnement social »18,
« l’erreur de base » du marxisme étant de « concevoir
la nature humaine comme relativement peu structurée et largement ou
totalement le produit de forces socio-économiques externes ».19
En réalité, l’erreur réside dans toute
explication de type « singe nu » selon laquelle nous
pouvons déduire du comportement des primates une base génétique
du comportement des humains. Elle ignore un élément essentiel de la
constitution génétique humaine, qui nous sépare de nos cousins les
plus proches. Ceux-ci sont génétiquement programmés de façon
étroite pour avoir le comportement approprié à un spectre limité
d’environnements, alors que précisément ce qui nous caractérise
est une immense flexibilité de comportement nous rendant capables,
virtuellement seuls dans le monde animal, de croître et multiplier
dans toutes les parties du monde. C’est là que se trouve la
différence fondamentale entre nous et les primates d’aujourd’hui.
On ne trouve pas de gorilles hors des forêts vierges tropicales, de
chimpanzés en dehors des régions boisées de l’Afrique
sub-saharienne, de gibbons en dehors des cimes des arbres d’Asie du
Sud-Est, d’orangs-outangs en dehors de certaines îles
d’Indonésie ; à l’inverse, les hommes ont été capables
de vivre dans de vastes régions d’Afrique, d’Europe et d’Asie
depuis au moins un demi-million d’années. Notre
« spécialité »
génétique est précisément que nous ne sommes pas spécialisés,
restreints par un répertoire limité de comportement instinctif.
De plus, les idées du genre « singe nu »
reposent sur des modèles très simplistes du comportement des
singes. Jusqu’aux années 1960, pratiquement toutes les études
réalisées sur des singes étaient conduites dans des jardins
zoologiques, comme la fameuse description, réalisée par Solly
Zuckerman en 1930, de la vie dans l’enclos des chimpanzés du zoo
de Londres. Elle les rangeait dans un modèle de comportement plus
large résultant de l’observation des babouins (bien que les
babouins aient des différences génétiques importantes avec les
chimpanzés). On les considérait comme presque totalement
végétariens, avec peu de capacités pour apprendre, et rien qu’on
aurait pu appeler, même avec un effort d’imagination, une culture.
Par dessus tout, ils étaient vus comme naturellement agressifs, les
mâles engagés dans une compétition permanente et féroce pour les
femelles et seulement disciplinés par une hiérarchie de
« domination » imposée par les « mâles alpha »
les plus agressifs.
Au cours des 30 dernières années, les études
portant sur les chimpanzés, les bonobos et les gorilles dans la
nature ont remis en question ce modèle20,
suggérant que tirer des conclusions sur le comportement des singes à
partir de la vie dans des cages de zoo était aussi valide que
retirer des enseignements sur le comportement humain en menant des
études dans un pénitencier.21 Leurs principales
conclusions étaient :
-
les chimpanzés et les bonobos sont beaucoup
plus sociables qu’on ne le pensait. Les confrontations agressives sont
beaucoup moins fréquentes que les interactions amicales. La plupart des
contentieux sont réglés sans violence.22
-
les mâles ne sont pas en compétition
permanente pour dominer les femelles. « Dans la troupe de
chimpanzés, contrairement à ce qui se passe chez les babouins de la
savane, le mâle dominant est relativement tolérant quant à l’attention
que peuvent porter d’autres mâles aux femelles : la promiscuité
sexuelle est de mise (...) Généralement, il y a peu de signes de
jalousie ou d’agression ».23 Les femelles initient de
nombreux contacts sexuels et leur
collaboration est essentielle si les mâles veulent avoir avec elles des
relations spéciales.24
-
Le rôle de la « domination » parmi
les chimpanzés et les gorilles a été surestimé dans le passé. Il n’y a
pas de hiérarchie unique pour toutes les activités chez les chimpanzés,
et chez les gorilles la « domination » semble souvent plus
proche de ce que nous appellerions « leadership ».25
-
Il y a beaucoup plus de comportements appris
et transmis socialement qu’on ne le croyait, ainsi que beaucoup plus
d’utilisation d’outils primitifs. Les chimpanzés emploient des pierres
pour casser les noix, des bâtons pour retirer les termites des trous et
des feuilles comme éponges pour recueillir des liquides pour boire.
-
Les chimpanzés ne sont pas complètement
végétariens. Ils chassent de petits animaux (par exemple, des petits
singes) lorsque l’occasion se présente et obtiennent ainsi 10 % de
leur régime de sources non végétales. Et la chasse est une activité
sociale : certains chimpanzés vont chasser les singes, d’autres
vont se poster en embuscade et les tuer.
-
Les chimpanzés ne sont pas en compétition pour
la consommation de la nourriture. Si l’un d’entre eux trouve une source
de nourriture – un buisson couvert de baies comestibles, par exemple –
il en avertit les autres. Et bien que les chimpanzés communs consomment
des aliments végétaux individuellement (sauf pour la mère qui apporte
la nourriture à sa progéniture), ils partagent la viande26,
et les bonobos partagent aussi les aliments végétaux.
-
Des formes de communication élémentaires
jouent un rôle significatif parmi les chimpanzés. Les gestes ne sont
pas utilisés uniquement pour attirer l’attention mais aussi pour
indiquer certaines intentions – comme lorsqu’un bonobo femelle indique
la façon dont elle entend procéder à l’acte sexuel.27 Et
toute une panoplie de sons est utilisée dans différents buts, pour
signaler un danger ou une abondante source de nourriture.
-
Le comportement social des chimpanzés varie
d’une bande à l’autre à l’intérieur de chaque espèce, montrant qu’il ne
dépend pas simplement de facteurs instinctifs génétiquement programmés,
mais aussi du terrain naturel sur lequel ils vivent et des techniques
qu’ils ont apprises pour s’y adapter.
La plupart de ces développements sont plus
marqués chez les bonobos que parmi les chimpanzés communs et les
gorilles. Il y a davantage de partage de la nourriture, davantage
d’initiative des femelles dans l’activité sexuelle, et une
rupture avec le modèle de domination « babouin » dans la
mesure où un groupe de femelles peut jouer un rôle central dans la
cohésion du groupe.28
Cela a mené à la suggestion selon laquelle
« les
bonobos présentent de nombreux indices du « chaînon
manquant » entre les singes et les humains ».29 En
tout état de cause, les observations de singes dans la nature, et
des bonobos en particulier, remet en question l’image courante d’un
comportement inné qui serait agressif et compétitif. Elles montrent
aussi que dans certaines conditions des éléments de ce que nous
considérons habituellement comme des formes uniquement humaines de
comportement se manifestent parmi les parents les plus proches de
l’humanité – et donc pourraient avoir commencé à se manifester
chez nos ancêtres communs il y a plus de quatre millions d’années.
Nos
ancêtres
Nous savons peu de choses avec certitude sur nos
ancêtres singes et humains (ou hominidés). Mais ce que nous savons
semble indiquer que l’adoption de la marche bipède a été le fait
de créatures que nous appelons australopithèques (ou « singes
du sud »).30
Ceux-ci étaient, à de nombreux égards, plus proches des singes que
des humains, avec des cerveaux peu supérieurs en taille à ceux des
chimpanzés, de l’ordre de 385 à 500 cm3, et on n’a
trouvé parmi eux aucune preuve de fabrication d’outils.31 D’où
leur classification comme primates et non comme humains.
Les premiers restes humains32 datent d’il y a 2 à 2,5
millions d’années. Leur cerveau est
substantiellement plus gros (de plus de 50 %) que celui des
australopithèques ou des chimpanzés33,
et l’espèce a été appelée homo habilis (ou « homme
adroit ») parce qu’il a d’abord été trouvé, dans les
gorges d'Olduvai en Afrique de l’Est, parmi des outils de pierre.
La forme de ses dents suggère une alimentation mixte de viande et de
végétaux, à l’opposé du régime alimentaire essentiellement
végétarien des grands singes modernes.
Il y a environ 1,6 millions d’années, des
humains pourvus de cerveaux considérablement plus gros –
habituellement désignés comme une nouvelle espèce, l’homo
erectus (homme debout), vivaient en Afrique et se répandirent
bientôt sur le continent eurasien. Pendant le million d’années
qui suivit, le cerveau continua à se développer jusqu’à
atteindre environ 1 000 cm3 – aussi gros que celui
de certains humains modernes, même s’il était plus petit que la
moyenne de nos contemporains. Désormais la dentition était
clairement adaptée à une alimentation carnée, ce qui montre que la
chasse était associée à la cueillette de végétaux comestibles.
Des outils de pierre étaient façonnés selon des schémas
standardisés (habituellement appelés acheuléens) adaptés à des
tâches différentes comme haches, tranchoirs, grattoirs, etc. Il est
intéressant de constater que les mâles étaient à peu près 20 %
plus grands que les femelles (au lieu du double chez les
australopithèques et les grands singes), ce qui indique que la
défense contre les prédateurs a dû dépendre bien plus d’une
coopération au sein de chaque groupe, et de l’utilisation des
outils comme armes, que des prouesses physiques d’un mâle
particulier.
Pour la période qui commence il y a 500 000
ans, on a trouvé en Afrique, en Europe et en Asie toute une variété
de types humains qui ressemblent aux hommes modernes par leur cerveau
volumineux (parfois plus gros que le nôtre) et des parois crâniennes
fines. Ceux-ci sont appelés « homo sapiens
archaïques », et sont considérés comme la première version
de notre espèce. Les plus connus sont les hommes de Néandertal, qui
vivaient en Europe et dans certaines parties du Moyen-orient il y a
entre 150 000 et 35 000 ans.
Enfin, les humains anatomiquement modernes
(souvent appelés homo sapiens sapiens) semblent avoir évolué
en Afrique et peut-être au Moyen-orient il y a 200 000 à
100 000 ans.34
Il y a 40 000 ans, ils s’étaient répandus en Afrique, en
Asie et en Europe et faisaient leurs premières incursions en
Australie. Il y a 12 000 ans au plus tard, ils étaient passés
de l’Asie du Nord-Est aux Amériques.35
Il y a eu de longues discussions sur la parenté
entre les humains modernes et les Néandertaliens. Lorsque le premier
squelette d’homme de Neandertal a été découvert il y a 140 ans,
on le considérait comme une espèce beaucoup plus primitive que
nous, avec des caractéristiques simiesques « bestiales »
(d’où l’utilisation courante en anglais du terme « homme
de Néandertal » pour signifier bestial ou barbare). On le
considérait encore il y a quarante ans comme une impasse de
l’évolution – « un type humain qui avait évolué dans le
climat plus froid de l’Europe de l’âge glaciaire avant de
s’éteindre ».36
Puis le balancier intellectuel pencha dans l’autre direction :
l’accent fut mis sur le gros cerveau des Néandertaliens et leurs
similitudes avec nous.
Aujourd’hui, le balancier a effectué, au moins
en partie, un retour en arrière, l'opinion la plus répandue étant
que l’évolution des humains modernes s'est déroulée sur une
ligne complètement séparée des « archaïques », tirant
son origine d’un groupe d’homo erectus identifié comme
vivant en Afrique. Mais il y a encore une résistance substantielle à
cette vision dite de l'« origine africaine » de la part
de ceux qui voient une continuité entre au moins une partie des
archaïques et nous-mêmes.37 Mais la rareté des éléments
de preuve est telle que la discussion
peut ne jamais aboutir.38
Et quelle que soit l’importance du débat dans une perspective
purement scientifique, il n’est pas, en lui-même, essentiel pour
comprendre la nature des humains modernes.39
Une
espèce née dans le sang ?
Les théories de type « singe nu »
sont basées sur l’affirmation que nos ancêtres étaient engagés
dans un combat sanglant et permanent à la fois avec les autres
espèces et entre eux. Ainsi, Ardrey affirme : « L’homme
a émergé du passé anthropoïde pour une seule raison : parce
qu’il était un tueur ».40 A partir de là, on peut
conclure que le meurtre est dans nos gènes,
et qu’il est mis – difficilement – en échec par les mécanismes
de la civilisation. De telles opinions sont encouragées par les
idées sur l’évolution des êtres humains primitifs développées
par Raymond Dart après la découverte des premiers restes
d’australopithèques. Il prétend que les os trouvés montrent que
la chasse était le facteur majeur dans l’évolution de nos
premiers ancêtres non singes, qu’il y avait eu « la
transition prédatrice du singe à l’homme ».41 On
trouve encore ces opinions dans certains milieux. Mais la plupart
des éléments de preuve mis en avant pour les justifier ont été
discrédités. La pile d’ossements de Dart n’est probablement pas
le résultat de la chasse humaine. Nos cousins les plus proches, en
particulier les bonobos, ne sont pas particulièrement agressifs. Et,
comme nous allons le voir, la guerre est absente et la végétation a
fourni plus de nourriture que la viande dans les sociétés
survivantes similaires à celles dans lesquelles vivaient nos
ancêtres il y a 10 000 ans.
Une des interprétations de la tendance de
l' « origine africaine » peut, néanmoins, soutenir
la thèse de la « naissance dans le sang ». Elle repose
sur le fait que des généticiens auraient prouvé que certains de
nos gènes tiraient leur origine d’une femme unique née en Afrique
il y a 100 ou 200 000 ans. L’humanité a commencé, dit-on,
avec elle, ses descendants se répandant hors d’Afrique,
« remplaçant les anciens humains indigènes dans le monde
entier (...) de façon brusque et violente ».42
L’implication est que les humains modernes se sont engagés dans
des génocides contre des peuples qui leur étaient très semblables,
et que cela met en évidence des caractéristiques guerrières
profondes qui définissent notre nature.
Mais toute cette argumentation repose sur une
confusion élémentaire entre le sort des gènes et celui de ceux qui
portent ces gènes. Tout individu a au moins une paire de gènes pour
toutes les caractéristiques transmises génétiquement, l’une
provenant de sa mère et l’autre de son père.43 Mais les deux gènes n’ont
pas nécessairement une influence égale
sur la constitution physique d’un individu, l’un des deux étant
parfois « dominant », masquant complètement l’existence
de l’autre, bien que tous deux aient des chances égales d’être
transmis à la descendance de cet individu. Ainsi, un enfant dont
l’un des parents a les yeux bleus et l’autre des yeux marron peut
lui-même avoir des yeux marron, mais reste capable de transmettre
des yeux bleus à ses propres enfants.
L’évolution se produit lorsqu’une nouvelle
forme de gène apparaît, qui peut changer les caractéristiques
physiques d’un individu, accroissant ainsi ses chances de survivre
et de se reproduire. Finalement, la nouvelle forme de gène va
remplacer l’ancienne. Mais dans l’intervalle (qui peut durer très
longtemps), des générations successives d’individus vont porter
les deux formes de gène, et certains de ceux qui présentent les
caractéristiques nouvelles peuvent transmettre le gène
correspondant aux anciennes à leur descendance. Quand le nouveau
gène devient prédominant, c’est parmi des gens qui partagent un
ancêtre commun (le premier possesseur du gène) mais qui ont aussi
beaucoup d’autres ancêtres.44 De telle sorte que l’origine
africaine des humains modernes ne
signifie pas nécessairement que nous avons une ancêtre femelle
unique, dont les descendants ont éliminé tous les autres ;
cela signifie plutôt que nous avons au moins un ancêtre commun en
même temps que beaucoup d’autres.
En tout cas Allan Wilson, qui fit les premières
recherches génétiques suggérant l’ancêtre africaine commune, ne
croyait pas qu’elle était la source unique dont nous provenons, et
deux de ses collègues ont écrit, peu de temps après sa mort, au
sujet de ces interprétations : « Elles ont confondu la
migration et l’extinction des gènes avec celles des populations.
Il n’y a aucune raison de penser qu’Eve ait été la première,
et, pendant un certain temps, la seule femme ».45
Chris Singer, l’un des représentants les plus
éminents de l’école de « l’origine unique »,
reconnaît que « pendant les quelques millénaires de
cohabitation possible des Néandertaliens et des homo sapiens
modernes, un échange continu de gènes aurait pu avoir lieu entre
les deux groupes ».46 Lors d’une conférence tenue
en 1987 sur les origines humaines, il
y eut « un consensus sur le fait que bien qu’il y ait des
différences morphologiques considérables entre les homo sapiens
archaïques et modernes, on ne peut écarter une hybridation ou une
continuité locale entre les deux groupes ».47 Cette
possibilité est renforcée par le fait que les deux groupes
ont coexisté pendant des milliers d’années dans certaines
régions, vivant sur les mêmes sites (mais pas forcément ensemble)
et utilisant des outils similaires.
Même si les humains ne se sont pas mélangés
avec les Néandertaliens et d’autres membres archaïques de notre
espèce, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils les ont
déplacés par la violence. La violence n’est pas nécessaire pour
qu’une population animale en remplace une autre en l’espace de
quelques milliers d’années. Cela implique seulement que l’une
réussisse mieux que l’autre à retirer une subsistance de
l’environnement. Son nombre va s’accroître, réduisant d’autant
les ressources disponibles pour l’autre, dont petit à petit la
natalité ne va pas suffire à compenser la mortalité. Des modèles
pertinents ont été suggérés, selon lesquels une telle chose
aurait pu se produire dans le cas des humains modernes et des
Néandertaliens en l’espace d’un petit millier d’années, sans
que l’un ne dût massacrer l’autre.48
Le
cerveau, la culture, le langage et la conscience
Il y a, bien plus importantes que les
argumentations sur l’arbre généalogique exact des humains
contemporains, des questions avec lesquelles celles-ci sont souvent
entrecroisées. Elles ont trait aux origines de la culture et du
langage.
Le débat est intense, parce que les squelettes et
les outils de pierre ne nous disent pas, en tant que tels, comment
nos ancêtres vivaient, quel était leur degré de communication,
quelle était leur efficacité dans la cueillette d’aliments
végétaux et à la chasse, encore moins s’ils se racontaient des
histoires, procédaient à des rites ou avaient une pensée
intérieure. La structure des os du crâne ne nous permet même pas
de savoir en détail comment le cerveau était construit, encore
moins ce qu’il faisait. Et les vestiges des outils de pierre de nos
ancêtres ne peuvent rien nous dire de leurs outils de bois et d’os
(qui étaient sans doute beaucoup plus nombreux, ces substances étant
plus faciles à modeler que la pierre), s’ils utilisaient des peaux
de bêtes et des matières végétales comme décoration (ce qui
impliquerait de l’imagination) aussi bien que comme nourriture et
protection contre le froid.
Ainsi, de la même manière qu’il existe des
conjectures élaborées et opposées sur la généalogie des corps
physiques dont proviennent les squelettes, il y a des interprétations
complètement contradictoires du développement de leurs esprits et
de leurs cultures.
Il y a deux grands axes théoriques. D’abord,
celui qui considère la culture et le langage comme s’étant
manifestés très tôt dans l’histoire des hominidés, au moins
depuis l’homo habilis (il y a deux millions d’années),
alors que les humains coopéraient dans l’usage d’outils pour
obtenir une subsistance. Le développement de la culture, du langage,
du cerveau et de l’intelligence humains est vu comme un long
processus cumulatif, commençant il y a deux millions d’années et
continuant jusqu’à l’arrivée des humains complètement
modernes, il y a environ 100 000 ans. La nécessité de
s’adapter à l’environnement et la posture redressée adoptée
par les anciens hominidés amenait, à chaque génération, à la
sélection naturelle des gènes qui encourageaient l’intelligence
et la sociabilité. Comme l’a dit Nancy Makepeace Tanner :
La sélection a dû favoriser intensément
le jeune le plus intelligent qui pouvait le mieux accomplir les
nouveaux gestes (...) La réorganisation (du cerveau) a pu se
produire très rapidement : les jeunes qui n’y arrivaient pas
et qui mourraient avant l’âge de se reproduire ne transmettaient
pas leurs gènes. La sélection a dû favoriser les jeunes qui
étaient curieux, joueurs et au contact du comportement des autres
membres du groupe, imitant les méthodes de fabrication des outils,
le savoir-faire avec l’environnement, apprenant à reconnaître et
à fréquenter un réseau social large et diversifié.49
La plupart de ces interprétations se sont
construites sur le travail de Glyn Isaacs, qui a suggéré que les
collections d’ossements d’animaux et d’outils mettaient en
évidence l’existence chez l’homo habilis de bases de
résidence où ils apportaient les carcasses d’animaux chassés
pour les partager.50
Les outils eux-mêmes, dit-on, ne pourraient pas avoir été
fabriqués sans un niveau de dextérité et d’intelligence bien
supérieur à celui des singes. John Gowlett dit :
Nous savons avec certitude que la
fabrication d’outils remonte au moins à 2 millions d’années
(...) Au cours du processus consistant à détacher des éclats de
pierre (...) en séquence (...) chaque étape franchie par l’individu
est subordonnée au but final (...) La frappe des éclats requiert
une dextérité manuelle et une coordination de la main et de l’œil,
aussi bien qu’une estimation des propriétés de fragmentation de
la pierre. Mieux, cela demande la capacité de « voir »
comment l’éclat va se faire.51
En même temps que la primauté accordée à la
fabrication des outils et au développement intellectuel, il existe
une théorie selon laquelle le crâne de l’homo habilis
indique une organisation du cerveau spécifiquement humaine, avec le
premier développement de zones adaptées au discours (les zones de
Broca et de Weinecke), ce qui « suggère fortement que même il
y a deux ou trois millions d’années la sélection naturelle
s’exerçait sur l’adaptation à des niches écologiques, et que
le comportement cognitif et social était certainement au premier
plan ».52
D’après ces opinions, les agrandissements
successifs du cerveau sur une période de 2 ou 3 millions d’années
correspondent à la dépendance croissante envers des aptitudes
communicatives et cognitives, qui à leur tour étaient nécessaires
à la transmission de la connaissance relative aux méthodes de
fabrication des outils, à la cueillette et à la chasse collectives,
et afin de s’adapter aux réseaux bien plus denses d’interactions
sociales qui étaient nés de ces activités.
Certains tenants de cette vision proclament qu’il
existe des preuves archéologiques qui la soutiennent : la
découverte de « camps de base » chez les homo
habilis, des vestiges de feux sur les « sites de rites
funéraires » chez l’homo erectus, les restes de
peintures corporelles et de construction de huttes chez des êtres
humains archaïques. Tout ceci indique une complexité croissante de
la vie sociale, un accroissement de la transmission de la culture et
de la communication symbolique, et des expressions d’intelligence
et d’imagination artistique semblables, bien que moins développées,
à ce qui existe chez les êtres humains modernes.
Si ce modèle de l’évolution humaine est
correct, il confirme la version d’Engels. Comme l’a dit Charles
Woolfson, cela signifie que « les grandes lignes de la théorie
d’Engels sont confirmées par la recherche contemporaine, et qu’à
cet égard l’essai d’Engels est une brillante anticipation de ce
qu’on considère à l’heure actuelle comme le schéma le plus
vraisemblable de l’évolution humaine ».53
La
nouvelle critique idéaliste
Mais ce modèle a été la cible d’attaques
féroces au cours des dernières années. Elles ont reposé sur un
certain nombre d’arguments.
D’abord, la plus grande partie des preuves
archéologiques ne serait pas fiable. Les « camps de base »
de l’homo habilis selon Isaacs, pourraient bien n’avoir
été que des versions humaines anciennes des nids de chimpanzés, et
les ossements d’animaux le résultat de la récupération des
restes laissés par d’autres carnivores et non d’une chasse
organisée socialement.54
Les vestiges de crânes n’en disent pas assez sur la forme du
cerveau qu’ils enveloppaient pour que nous puissions en déduire
l’existence de zones spécialisées (celles de Broca et de
Weinecke) consacrées à la parole.55 Des vestiges qui sont censés
démontrer la construction de huttes
chez l’homo erectus et l’usage de la décoration chez
l’homo sapiens archaïque peuvent, en fait, être expliquées
de bien d’autres manières qui n’impliquent pas un niveau élevé
de culture. Les prétendus rites funéraires peuvent très bien avoir
été le résultat d’évènements naturels – comme l’effondrement
de la voûte d’une caverne sur ses occupants, par exemple.56
Deuxièmement, les preuves les plus convaincantes
en notre possession, les outils de pierre, changent très peu au
cours de l’existence d’un million d’années de l’homo
erectus et de l’histoire de 100 000 ans des
Néandertaliens. Ce qui est remarquable, nous dit-on, ce n’est pas
qu’il y ait un changement, mais qu’il ne se soit pas produit une
avancée plus importante, plus rapide, plus systématique. Celle-ci
n’arrive pas avant les cultures du « paléolithique
supérieur » des humains modernes d’il y a 35 000 ans.
Jusque là, dit-on, la production d’outils ne diffère pas
qualitativement de ce qui se passe chez des mammifères non humains.57 Et
c’est seulement à cette époque que nous trouvons des preuves
incontestables de production artistique (peintures rupestres) et de
comportement rituel (cérémonies funéraires, etc.).
Troisièmement, on prétend que ni l’homo
erectus ni l’homme de Néandertal n’avaient un larynx capable
de produire plus d’une fraction de la gamme de sons émis par
l’homme moderne, et qu’ils étaient par conséquent incapables
d’un langage tel que nous le connaissons.58
Finalement, le modèle reposerait sur une version
gradualiste désuète de la théorie de l’évolution, dans laquelle
l’espèce change petit à petit en même temps que se produisent
les mutations génétiques et qu’elles sont sélectionnées. Une
théorie évolutionniste plus récente accepte la possibilité de ce
que Gould et Eldridge appellent « l’évolution ponctuelle »
(ou modèle des « équilibres ponctués »), selon
laquelle les changements génétiques peuvent se produire par
explosions.59
L’impact majeur de ces différents arguments a
été d’encourager dans les dernières années une mode qui ne voit
« un style de vie distinctement humain » que très tardif
dans l’histoire, qui serait le résultat d’une « évolution
humaine » qui a commencé par produire la culture et le
langage. Une présentation récente de cette thèse l’énonce
ainsi :
L’homo
erectus n’était pas loin d’une capacité cérébrale
moderne, mais apparemment il n’avait à sa disposition que très
peu de culture pour en faire la démonstration. Si par origine
humaine on entend les débuts d’une culture humaine identifiable,
alors les premiers 3,5 millions des 4 millions d’années d’histoire
des hominidés doivent toujours être considérés comme une période
de préhistoire60
Il est vraisemblable que les changements les plus
importants ne se sont produits qu’après l’évolution de l’homo
sapiens. Ils pourraient même avoir commencé plus tard, après
que des humains anatomiquement modernes aient remplacé les anciennes
variétés d’homo sapiens.61
Si cela est vrai, alors toute la vision d’Engels
souffrait d’un défaut de conception fondamental. Quelque chose
d’autre que le travail coopératif doit avoir été à la base de
l’évolution de l’humanité. Mais l’argumentation comporte de
grandes lacunes qui ne peuvent être comblées par des explications
matérialistes.
La preuve basée sur les outils de pierre
n’établit pas qu’aucune avancée dans la culture ne s’est
produite. La pierre n’était certainement pas la seule substance
utilisée par nos prédécesseurs homo habilis et homo
erectus pour faire des outils, même si elle était la plus
capable de survivre aux rigueurs du temps. Ils utilisaient
certainement du bois, des os, des peaux d’animaux et du feu pour
faire face à leur environnement, et devaient sans doute avoir trouvé
le moyen de tresser des lianes pour capturer des animaux et comme
moyen de portage.62
Tous ceux-ci pouvaient être aussi importants pour eux, sinon
davantage, et peuvent avoir été utilisés de façons innombrables
et changeantes sans que cela laisse la moindre trace. De plus, un
changement lent dans les outils de pierre n’est pas équivalent à
aucun changement. Et cela est loin de prouver qu’ils ont été
fabriqués par des créatures dépourvues d’intellect cumulatif et
de développement culturel.
Comme l’indique McGrew, il y a un écart énorme
entre les outils utilisés par les chimpanzés et ceux de l’homo
habilis, pour ne pas parler de l’homo erectus :
Les chimpanzés sont des fabricants et
des utilisateurs adroits d’outils (...) il y a certaines choses
qu’on n’a jamais vu faire à un chimpanzé (...) Ils n’emploient
pas d’outils de forage pour atteindre des racines (...) ils
n’utilisent pas d’objets de jet ni d'échelles pour atteindre des
fruits hors de portée.63
S.T. Parker et K.R. Gibson, utilisant le cadre
conceptuel de Piaget concernant le développement du langage chez les
humains, affirment détenir la preuve que les premiers hominidés
auraient eu « une intelligence et un langage comparables à
ceux des jeunes enfants ».64 Thomas Wynn affirme qu’à la
fin de la période acheuléenne, il y
a 300 000 ans, les premiers humains avaient atteint le second
stade le plus élevé du développement intellectuel humain, celui
des « opérations concrètes », avec la « symétrie
quasi parfaite des haches » qui indiquait une aptitude à la
« réversibilité, la conservation, la correction des erreurs,
etc. ».65
Les outils de pierre pourraient avoir changé très
lentement tout simplement parce qu’ils étaient adaptés aux tâches
qui leur étaient imparties – de la même façon que certains
outils de base de charpentier ont connu peu de changements entre
l’ancienne Egypte et le début du 20ème siècle. Et
même si les outils de pierre ont changé lentement, cela ne signifie
pas qu’ils étaient faciles à faire ou qu’ils étaient l’œuvre
de gens qui copiaient les autres sans penser à ce qu’ils
faisaient.
Il va de soi que les outils de
pierre ne peuvent servir à justifier
la prétention d’un énorme écart entre les premiers humains
modernes et les humains « archaïques » plus tardifs. Non
seulement les deux groupes ont coexisté pendant des centaines de
milliers d’années, mais ils avaient des cultures communes. Jusqu’à
il y a 40 000 ans les humains modernes d’Europe et du
Moyen-orient utilisaient les mêmes outils « moustériens »
que les Néandertaliens (comme le reconnaît Adam Kuper, qui accepte
l'idée à la mode selon laquelle une « culture distinctement
humaine » n’apparaît pas avant il y a 25 000 ou 35 000
ans).66
Pourtant les derniers hommes de Néandertal d’il y a 35 000
ans avaient appris à employer certaines des technologies les plus
avancées, comme leurs voisins les humains modernes.67
Même après que ces humains modernes aient adopté
les nouvelles technologies, le changement était souvent très lent,
sans « développements technologiques majeurs, ni
d’accroissement significatif dans la capacité des hommes de
générer de l’énergie » pendant une longue période.68 Là où
nous avons aujourd’hui la France, par exemple, il y a un
écart de 20 000 ans entre l’arrivée de la culture
« paléolithique supérieure » et les peintures rupestres
magdaléniennes de La Marche. Et il a fallu encore 10 000 ans
pour que les techniques agricoles remplacent la chasse et la
cueillette dans ces régions.
Nous sommes donc en présence d’un lent
développement des techniques sur 2 ou 3 millions d’années, avec
une accélération il y a 200 000 à 150 000 ans au moment
où apparaissaient les Néandertaliens et les premiers humains
modernes. Une autre accélération se produit il y a 30 à 35 000
ans, à la fois dans la population humaine croissante et pour les
Néandertaliens en déclin ; un nouveau changement rapide à
l’époque des peintures rupestres il y a 15 000 ans ; un
développement très rapide avec l’agriculture il y a 10 000 à
5 000 ans ; et une accélération massive pendant le
dernier millénaire. Cela signifie que, bien qu’il y ait pu avoir
des différences biologiques importantes entre les humains archaïques
et modernes, la rapidité de l’innovation n’en dépend pas
nécessairement. Quelque chose d’autre entre en ligne de compte.
Même si
l’homo erectus et les humains archaïques avaient une gamme
vocale plus limitée que les humains modernes – et certains
paléontologues contestent cette assertion69 – cela ne signifie pas que
les Néandertaliens et autres humains
archaïques ne connaissaient absolument pas le langage. Cela signifie
simplement qu’ils n’étaient pas aussi doués pour la
communication que nous le sommes. Comme Lieberman lui-même, le
représentant le plus engagé de la théorie mettant l’accent sur
les limitations linguistiques des Néandertaliens, l’a écrit :
« Le modèle informatique ne montre pas que les hominidés de
Néandertal ne connaissaient pas la parole ou le langage ; ils
avaient l’équipement anatomique pour produire des versions
nasalisées de tous les sons du discours humain sauf le i, le u, le a
et les consonnes vélaires, et ils avaient probablement un langage et
une culture développés ».70
Finalement, l’argument selon lequel l’évolution
peut se produire ponctuellement ne prouve pas, en lui-même, que le
langage et la culture aient pu apparaître soudainement. Et il y a un
argument de poids à l’encontre de cette vision – celui de la
taille du cerveau. Si l’évolution de l’humanité était le
résultat de changements très rapides vers la fin d’une période
de plusieurs millions d’années, c’est alors à ce moment qu’on
s’attendrait à ce que les traits les plus caractéristiques de
l’homo sapiens – à savoir la taille importante de notre
cerveau par rapport à notre corps – apparaissent. La formulation
originelle de l’évolution ponctuelle par Gould et Eldridge s’en
tenait en fait à cette vision, et supposait que le cerveau s’était
peu développé en taille pendant le million d’années où l’homo
erectus avait existé. Mais, comme le remarque Stringer, il y a
« peu d’éléments de preuve » à l’appui de cette
version.71
Ainsi, les théories qui voient « l’évolution
humaine » comme se produisant d’un seul coup il y a un
demi-million d’années avec le remplacement de l’homo erectus
par l’homo sapiens, pour ne pas dire il y a 35 000 ans,
après l’évolution des humains anatomiquement modernes, posent un
problème : pourquoi les derniers homo erectus
avaient-ils un cerveau dont la taille était le double de celui des
australopithèques, et les Néandertaliens un cerveau de taille
moderne ? Cela ne pouvait pas être simplement pour s’engager
dans des opérations mentales qui auraient pu être effectuées par
leurs ancêtres de plusieurs millions d’années auparavant.
En même temps, il n’est pas concevable que nos
prédécesseurs d’il y a un million d’années aient pu survivre
sans avoir déjà développé des moyens de coopérer ensemble pour
faire face à leur environnement et pour transmettre le savoir à une
échelle qualitativement plus grande que celle qu’on observe chez
nos cousins les singes. Car à cette époque, ils quittaient les
vallées d’Afrique, où leur espèce était née, pour coloniser la
plus grande partie de l’Eurasie, montrant qu’ils n’étaient pas
seulement capables de vivre dans certaines niches écologiques
restreintes, mais bien d’adapter toute une variété
d’environnements à leurs besoins – apprenant à différencier
les espèces végétales nouvellement rencontrées, celles qui
étaient comestibles et celles qui étaient vénéneuses, apprenant à
chasser des animaux jusque là inconnus, à se protéger contre de
nouveaux prédateurs et à vivre dans des climats nouveaux.
La
dialectique du travail et de l’intellect
Les preuves directes de l’existence d’un
travail social – ou de toute autres forme de comportement – parmi
nos ancêtres sont nécessairement réduites. Mais les indices sont
surabondants.
Regardons les traits qui différencient l’homo
erectus des singes. Il marchait sur deux jambes et perdit le
moyen facile de fuite devant les prédateurs consistant à se
réfugier dans les arbres ; ses jeunes grandissaient beaucoup
plus lentement (et avaient donc besoin d’une plus longue période
de protection par leurs parents) ; les mâles de l’espèce
étaient en moyenne seulement 20 % plus grands que les femelles,
et non 100 %, et n’étaient donc pas bâtis uniquement pour la
défense ; il avait connu une réduction considérable de la
taille de ses canines (les longues dents latérales pointues avec
lesquelles les singes et les gorilles menacent leurs prédateurs
potentiels et tuent de petits animaux pour s’en nourrir) ; ses
dents postérieures (molaires) étaient adaptées à un régime qui
comportait beaucoup de viande, excluant les matières végétales
exigeant une longue mastication ; la main fut remodelée, avec
le développement d’un pouce qui permettait la préhension et la
manipulation de petits objets ; l’intérêt sexuel des
femelles n’était plus concentré principalement sur la période de
l’ovulation ; et, comme nous l’avons vu, il y avait eu une
énorme augmentation de la taille du cerveau.
Une créature porteuse de cette combinaison de
traits ne pouvait survivre que si elle avait développé certains
moyens de remplacer les caractéristiques physiques qu’elle avait
perdues. Elle devait pouvoir défendre ses jeunes pendant des
périodes plus longues que ses cousins singes dont elle avait perdu
les énormes canines, l’adresse à grimper aux arbres et la
constitution robuste des mâles. Elle devait être capable de se
relier à une plus grande variété végétale qu’eux avec des
molaires qui n’étaient pas aussi efficaces pour broyer. Elle
devait trouver un moyen de trancher la chair des animaux, qu’elle
les chasse elle-même ou qu’elle s’approprie simplement les
carcasses laissées par d’autres prédateurs. Tout ceci implique
une énorme dépendance envers l’utilisation de divers procédés
pour se défendre, trancher, creuser, cueillir et moudre. Cela
implique aussi un plus haut niveau d’organisation sociale que tout
ce qu’on peut trouver chez les plus sociables des singes ;
c’est cela qui explique sans doute le changement dans les schémas
sexuels féminins, encourageant des liens permanents entre les sexes
plutôt que l’accouplement frénétique, concentré sur quelques
jours par mois, que l’on rencontre chez les chimpanzés communs.
Mais transmettre la connaissance des techniques nécessaires et
assumer un niveau énorme de coopération dans le cadre d’une vie
sociale intense nécessitait une puissance cérébrale bien plus
importante qu’auparavant. Au cours de nombreux millénaires, ces
créatures dont les gènes changeait de façon à leur permettre
d’apprendre des autres, de communiquer avec les autres et de
prendre soin d’eux, avaient un avantage en matière de survie et de
reproduction. La sélection naturelle portait l’évolution dans le
sens de réseaux neuronaux plus larges, plus denses et plus
complexes, capables de diriger les fonctions motrices compliquées de
la main et d’utiliser des changements subtils dans les gestes et la
voix pour communiquer.
C’est seulement lorsqu’on considère les
choses de cette manière qu’on peut expliquer pourquoi notre espèce
était déjà dotée, il y a 35 000 ans, de la capacité de
développer tout un ensemble nouveau de technologies. L’explication
réside dans 2 millions d’années d’évolution cumulative, le
travail encourageant à chaque étape la dextérité manuelle, la
sociabilité et un cerveau plus gros. Et à chaque étape, la main
adroite, la sociabilité plus grande et le cerveau plus important
rendaient possibles des formes de travail plus avancées. Tout ceci
fait du travail le véritable chaînon manquant dans l’histoire de
l’évolution humaine, et Engels avait raison d’insister sur ce
point.
Un tel travail avait des implications énormes
pour le cerveau. Ceux qui étaient les meilleurs dans la coopération
avec les autres dans la production et l’usage des outils étaient
ceux dont le cerveau avait connu des changements de structure et de
taille leur permettant d’améliorer la coordination des fonctions
motrices contrôlant les mains avec la vision et l’ouïe, et aussi
d’être plus à l’écoute des signaux émis par leurs
semblables.72
Un processus cumulatif était bientôt en cours, dans lequel la
survie dépendait de la culture et de la capacité à participer à
la culture sur la base d’un capital génétique qui encourageait la
combinaison de la sociabilité, de la communication, de la dextérité
et du pouvoir de raisonner.
C’est cela qui explique pourquoi nos ancêtres
ont été capables, il y a un million d’années, d’émigrer de
leur Afrique natale vers les conditions climatiques très différentes
de l’Eurasie, et pourquoi les Néandertaliens ont pu survivre dans
les conditions très dures de l’âge glaciaire européen pendant
100 000 ans ou plus. Quelle que soit l’importance des
différences qu’ils présentaient avec nous, ils n’auraient pu
survivre s’ils n’avaient pas eu au moins des rudiments de
culture, de langage et d’intelligence. Après tout, ils étaient
comme nous sur un point très important : ils n’avaient rien
d’autre pour se protéger, pas de fourrure, pas de grande vitesse
de fuite, pas de crocs ou de griffes, et pas de capacité à
disparaître en un clin d’œil dans les arbres.
C’est cela qui explique aussi le développement
des attributs humains les plus spécifiques, le langage et la
conscience. Le trait distinctif du langage humain, à l’inverse des
sons et des gestes produits par d’autres animaux, c’est que nous
utilisons des mots pour nous référer à des choses et des
situations qui nous sont pas présentes devant nous. Nous les
utilisons pour tirer des représentations abstraites de la réalité
à laquelle nous faisons face, et pour décrire d’autres réalités.
Et si nous pouvons le faire avec les autres, nous pouvons aussi le
faire avec nous-mêmes, en utilisant le « discours intérieur »
qui se tient en nous pour envisager des situations et des buts
nouveaux. La capacité de faire tout cela n’a pas pu émerger d’un
seul coup. Elle a dû grandir au cours de nombreuses générations,
en même temps que nos ancêtres éloignés apprenaient dans la
pratique, par le travail, à tirer des représentations abstraites de
la réalité immédiate et à la changer – en commençant à
utiliser des sons et des gestes, non pas simplement pour désigner ce
qui était sous leurs yeux ou ce qu’ils désiraient dans l’immédiat
(ce que font certains animaux), mais pour indiquer comment ils
voulaient changer quelque chose et comment ils entendaient que les
autres les aident. En ce qui concerne l’usage des outils, nous
savons qu’il y a eu un changement significatif entre les singes et
les premiers humains : alors que le singe ramasse un bâton ou
une pierre qu’il emploie comme outils, les humains primitifs d’il
y a 2 millions d’années non seulement mettaient déjà en forme le
bâton ou la pierre, mais utilisaient d’autres pierres pour les
façonner, et, sans aucun doute, apprenaient cela les uns des autres.
Cela suppose non seulement des conceptions sur les choses immédiates
(la nourriture) mais aussi sur des choses absentes de l’immédiateté
(l’outil qui permet d’obtenir la nourriture) et doublement
absentes de la réalité (l’outil qui peut mettre en forme l’outil
qui permet d’obtenir la nourriture). Et cela suppose aussi la
communication, par gestes ou par sons, sur des choses à deux degrés
d’éloignement de la réalité – en fait, la première
utilisation de noms, d’adjectifs et de verbes abstraits. Ainsi, le
développement du travail et celui de la communication vont
nécessairement de pair. Et, en se développant, ils encouragent tous
deux le développement de ces nouveaux gènes qui y rendent les gens
plus habiles : la main plus adroite, le cerveau plus gros, le
larynx qui produit une gamme de sons plus étendue.
Ces développement ne comportent pas seulement des
changements quantitatifs. En même temps que la croissance du
travail, de la sociabilité et du langage se renforcent mutuellement,
encourageant la sélection de toute une série de gènes nouveaux, de
nouveaux réseaux de cellules nerveuses apparaissent dans le cerveau,
rendant possibles de nouvelles séries d’interactions entre les
êtres et le monde. Cela peut très bien expliquer pourquoi de
nouvelles espèces d’humains se développent soudain, qui vivaient
avec, puis dépassaient ceux qui les avaient précédés, comme avec
l’apparition de l’homo habilis, de l’homo erectus
et des formes variées des humains archaïques. Ainsi, il se peut
très bien que les humains modernes aient fini par remplacer les
Néandertaliens parce qu’ils étaient capables de communiquer plus
vite et plus clairement entre eux (même si nous ne le saurons
probablement jamais avec certitude).
Nous avons donc vu comment la quantité se
transforme en qualité, comment, à travers des changements
successifs, la vie animale a donné naissance à cette nouvelle forme
de vie que nous appelons « humaine », qui possède une
dynamique propre, modelée par son travail et sa culture, et non par
ses gènes. Mais cela ne devrait pas amener à sombrer dans un nouvel
idéalisme qui consisterait à voir la culture et le langage comme
émergeant de nulle part dans un passé assez récent. Et si cette
approche est à la mode dans certains cercles, ce n’est pas parce
qu’elle peut fournir une version scientifique, matérialiste de nos
origines, mais parce qu’elle convient à l’humeur générale de
l’intelligentsia depuis la fin des années 1970. Dans pratiquement
toutes les disciplines, on a assisté à des tentatives de séparer
le développement du langage et des idées de celui de la réalité
matérielle. Comme à l’époque de Marx et Engels, la lutte pour la
science est un combat à la fois contre l’idéalisme et le
matérialisme mécanique – l’idéalisme prenant aujourd’hui la
forme des modes « post-modernistes » et le matérialisme
mécanique celle de la sociobiologie.73
Questions
non résolues
Il y a dans l’histoire de l’évolution humaine
beaucoup de points de détail qui ne sont pas encore élucidés et
qui, du fait de la rareté des éléments de preuve, ne le seront
peut-être jamais. Cela donne lieu à toute une série de débats qui
font monter la tension dans les conférences académiques et
fournissent des accroches aux journalistes scientifiques.
Par exemple, un débat tout à fait fascinant est
en cours sur la question de savoir pourquoi un groupe de primates a
commencé à adopter la position debout. La plupart des autorités
disent que c’est parce que le changement climatique a détruit les
forêts dans lesquels les singes ancestraux vivaient, leur laissant
le choix entre battre en retraite dans les forêts subsistantes ou
s’adapter à un environnement plus ouvert. La sélection naturelle
aurait alors choisi des traits génétiques, parmi les groupes qui se
retiraient dans la forêt, adaptés à cette forme de vie, les traits
que nous trouvons chez les gorilles d’aujourd’hui. De la même
manière, elle aurait choisi parmi les habitants des plaines
herbeuses les caractéristiques d’usage d’outils
« coopératifs »
et transmis culturellement que nous trouvons chez les humains.
« Les
hominidés obtenaient des aliments végétaux moins succulents et
probablement plus difficiles à trouver dans l’environnement
nouveau, la savane de l’Est africain. Ils se sont spécialisés en
devenant plus intelligents, bipèdes, et en faisant usage
d’outils ».74
Contre cette opinion, d’autres affirment que des preuves
archéologiques indiquent que les premiers primates bipèdes vivaient
dans les forêts et non dans les plaines herbeuses.75
Il y a un autre débat sur le rôle de la chasse
dans les premières étapes de la lignée des hominidés. Le
renouveau de la discussion sur les aspects sociaux de l’évolution
humaine a connu une accélération à l’occasion de la conférence
convoquée en 1966 par Richard Lee et Irven DeVore sur le thème
« L’homme, un chasseur » (« Man the Hunter »),
qui rassembla des archéologues et des anthropologues étudiant les
sociétés contemporaines de chasseurs-cueilleurs. Comme le suggère
le thème de la conférence, l’accent était mis sur la chasse en
tant qu’activité sociale formative.76 Mais cela fut bientôt
contesté par ceux77
qui affirmaient que les preuves archéologiques concernant l’homo
habilis indiquaient une pratique individuelle de charognards
(consistant à manger des animaux déjà tués par d’autres
carnivores) et non une chasse collective. Ce qui, à son tour, mena
au compromis selon lequel nos ancêtres auraient sans doute été
motivés par des pratiques collectives de charognards (ils auraient,
en nombre, fait fuir le carnivore qui avait tué la proie, les
individus isolés ayant peu d’intérêt à garder pour eux-mêmes
une carcasse bien trop grosse pour être mangée par une seule
personne avant de se décomposer).78
En même temps, d’une autre direction, on
affirma que les premiers bipèdes auraient été nécessairement des
chasseurs maladroits, mais que pour élever leur progéniture et être
d’habiles cueilleurs d’aliments végétaux ils auraient été
contraints à devenir des utilisateurs sociaux d’outils :
« Tout indique que la population de primates proches des
chimpanzés d’il y a 5 millions d’années possédait des éléments
comportementaux et anatomiques de base permettant une adaptation à
la cueillette, dans laquelle toute une série de plantes comestibles
de la savane pouvait avoir été exploitée avec des outils ».79 Les
jeunes devaient se soumettre à une socialisation extensive s’ils
voulaient apprendre à exécuter de telles tâches, ce qui met
l’accent sur le « lien mère-enfant », les femmes étant
« le centre nécessaire du groupe social : des schémas
moteurs, appropriés à la fabrication et l’emploi d’outils de
cueillette pour creuser, couper, éplucher, ouvrir et diviser la
nourriture, pour transporter des ustensiles, des aliments et des
bébés, et pour se défendre contre les prédateurs, devaient être
appris ».80
Enfin, il y a le débat, déjà mentionné en
passant, sur les relations entre les différents spécimens
d’hominidés qui ont été trouvés – les formes variées
d’australopithèques, d’homo habilis, d’homo erectus,
les diverses sortes d’humains « archaïques », les
Néandertaliens et les humains modernes.
Mais aucun de ces désaccords entre professionnels
ne devrait obscurcir les développements les plus passionnants de
l’histoire intellectuelle pendant les 30 années passées – la
confirmation de la ligne d’analyse mise en œuvre dans la brochure,
inachevée et non publiée, écrite par Engels après sa lecture de
Darwin. Trigger nous dit à quel point
l’œuvre d’Engels démontre qu’il
était possible de conceptualiser la théorie matérialiste moderne
de l’évolution dès les années 1870. Pourtant les concepts de
Darwin, essentiellement idéalistes, sur l’évolution humaine
étaient à l’évidence plus compatibles avec les croyances de la
plupart des scientifiques issus de la classe moyenne d’Europe de
l’Ouest qu’avec celles de l’inflexible révolutionnaire
qu’était Engels. Il n’est donc pas surprenant que le travail
d’Engels ait été ignoré (...)
Le résultat a été que la recherche des origines
a fourvoyé les trois quarts d’un siècle dans des impasses,
jusqu’à ce que, dans les années 1960, « Kenneth Oakley,
Sherwood Washburn et F. Clark Howell posent les bases de la
construction d’une nouvelle théorie de l’évolution qui, même
si elle était en grande partie le résultat d’une démarche
inductive, ressemblait à s’y méprendre au travail, depuis
longtemps oublié, d’Engels ».81
II.
Les origines des classes et de l’Etat
Le rôle joué par le travail finit sur
deux paragraphes qui suggèrent comment, une fois l’espèce humaine
établie biologiquement, l’action de son labeur sur le monde mena à
des changements successifs dans ses institutions sociales. L’origine
de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, écrit
huit ans plus tard et construit sur ces prémices, développe un
récit global de l’évolution de la société de classes.
Ce livre explique qu’à l’origine, les humains
ont vécu dans des sociétés sans propriété privée dans le sens
où nous utilisons le terme aujourd’hui (c’est à dire pas de
richesse privée, par opposition, par exemple, aux brosses à dents),
sans aucune division de classe, et sans domination des femmes par les
hommes. Mais des changements dans la manière dont les humains
coopéraient pour produire leur subsistance ont mené au remplacement
de ce « communisme primitif » par une succession de
formes de sociétés de classes, dont le capitalisme est la plus
récente. Et, avec les classes, vinrent l’Etat et les différentes
formes de famille dans lesquelles les femmes sont opprimées.
Si Le rôle joué par le travail a été
ignoré par la science sociale officielle, L’origine de la
famille a été, lui, systématiquement dénoncé. L’idée de
« communisme primitif » a été dans son ensemble rejetée
comme un conte de fées. L’expérience vécue par l’anthropologiste
américaine Eleanor Leacock est typique. Elle raconte qu’il était
« généralement considéré, lorsque j’étais étudiante,
que le « communisme de vie » auquel faisaient référence
Lewis Henry Morgan et Friedrich Engels n’avait jamais existé ».82
D’une part, la critique subie par Engels était
politique, liée aux attaques générales contre les idées
socialistes. Mais elle correspondait aussi à une tendance générale,
anhistorique et anti-évolutionniste, dans la sociologie et
l’anthropologie sociale. Alors qu’au 19ème siècle
ces disciplines étaient nées comme des tentatives spéculatives de
montrer comment toute l’histoire humaine avait abouti à la
merveille qu’était le capitalisme, au 20ème siècle la
tendance allait dans la direction opposée – le rejet de toute
notion d’évolution sociale, quelle qu’elle fût. Il y avait
beaucoup d’études de la vie dans des cultures individuelles. Il y
avait des tentatives de montrer que les différents aspects de
certaines sociétés « primitives » avaient la
« fonction » de maintenir la société. Il y avait même
des essais de « théories » du fonctionnement de toutes
les sociétés, dont le plus grandiose et le plus stérile fut le
travail de Talcott Parsons. Mais il y avait un rejet de toute
tentative de rendre compte de l’évolution sociale.
Pourtant, tout au long de cette période, les
recherches réelles des anthropologues sociaux prouvaient l’existence
d’un grand nombre de sociétés dans lesquelles les classes, l’Etat
et l’oppression des femmes tels que nous les connaissons
n’existaient pas – par exemple les livres de Margaret Mead Mœurs
et sexualité en Océanie ,
celui de Ruth Benedict
Echantillons
de civilisations ,
ou même celui de Bronislaw Malinowski Les
argonautes du Pacifique occidenta l et La
sexualité et sa répression dans les sociétés primitives, ou
encore Systèmes politiques africains de Meyer Fortes et
Edward E. Evans-Pritchard.
Dans une seule discipline, l’archéologie, les
notions d’évolution persistaient. Cela peut avoir été dû au
fait que les archéologues trouvent des ossements humains et des
objets divers dans des couches géologiques déposées à diverses
époques du passé, et sont donc portés à considérer que certains
succèdent à d’autres. Mais c’est surtout parce que le
scientifique le plus éminent de l’archéologie britannique était
un socialiste de gauche, V. Gordon Childe, qui fut attiré par une
version stalinisée du marxisme dans les années 30, et a utilisé
des éléments puisés dans Engels pour corriger les erreurs
contenues dans ses travaux précédents sur le changement culturel
(qui étaient construits sur des schémas élaborés selon lesquels
la culture « se diffusait » d’une société à une
autre).83
Puis, à la fin des années 60, le climat
intellectuel changea – un changement qui ne peut être séparé des
évènements plus globaux de cette décennie. Dans les marges du
monde académique, certains anthropologues (parmi lesquels des
marxistes comme Eleanor Leacock ou des anti-impérialistes comme
Richard Lee) commencèrent à travailler avec des archéologues (qui
étaient souvent influencés par Gordon Childe) à l’élaboration
d’interprétations évolutionnistes de la société humaine. Ils
rétablirent la validité d’idées qui avaient été vouées aux
gémonies pendant deux générations, en particulier celle qui
consistait à dire que pendant des centaines de milliers d’années
l’humanité avait vécu dans des sociétés sans classes, sans
propriété privée et sans Etat.
Aujourd’hui, un non-marxiste comme Ernest
Gellner accepte que pendant une longue période les humains ont vécu
comme « chasseurs-cueilleurs (...) définis par le fait qu’ils
ne possédaient aucun moyen de produire, d’accumuler ou de stocker
de la richesse », dans des sociétés « caractérisées
par un bas niveau de division du travail ».84 Et
Richard Lee peut proclamer en restant respectable :
« Avant
l’avènement de l’Etat et l’installation de l’inégalité
sociale, les gens ont vécu pendant des millénaires dans des petits
groupes sociaux basés sur la parenté, dans lesquels les
institutions fondamentales de la vie économique incluaient la
propriété collective ou commune de la terre et des ressources, une
réciprocité généralisée dans la distribution de la nourriture,
et des rapports politiques relativement égalitaires ».
Cela ne signifie pas que nous allons simplement
accepter les arguments d’Engels dans leur totalité et les traiter
comme sacro-saints. Il notait lui-même, en 1891, que ce qu’il
avait écrit en 1884 avait besoin d’être révisé en prenant en
compte les « progrès importants » accomplis par la
connaissance. Et nous sommes éloignés non pas de sept ans, mais de
plus de cent ans de ces écrits. Comme l’a noté Gailey, dans une
étude inscrite dans la tradition inaugurée par Engels, une grande
partie des « sources ethnographiques » de L’origine
de la famille a été rendu caduc par les recherches
ultérieures.85
Il y a un élément fondamental de l’argumentation d’Engels dans
ce livre qui demeure extrêmement précieux. Mais il est nécessaire
de l’expurger d’une série d’informations factuellement
incorrectes et d’arguments spéculatifs qui ont été traités
comme parole d’évangile par des prétendus marxistes et utilisés
par nos adversaires pour discréditer l’œuvre d’Engels dans son
ensemble.86
Le
communisme primitif
Le point de départ d’Engels était une
reformulation de l’opinion exprimée par Marx et lui-même en
1845-46, selon laquelle la façon dont les êtres humains retirent
leur subsistance de la nature détermine leur manière de coopérer
entre eux et pose donc les bases de la société dans laquelle ils
vivent :
Selon la conception matérialiste, le
facteur déterminant, en dernier ressort, dans l’histoire, c’est
la production et la reproduction de la vie immédiate (...) D’une
part, la production de moyens d’existence, d’objets servant à la
nourriture, à l’habillement, au logement et des outils qu’ils
nécessitent ; d’autre part, la production des hommes mêmes,
la propagation de l’espèce. Les institutions sociales sous
lesquelles vivent les hommes d’une certaine époque historique et
d’un certain pays sont déterminées par ces deux sortes de
production87
Morgan, en toute indépendance de Marx et Engels,
était arrivé à une conclusion pratiquement identique88
:
Les hommes sont les seuls êtres dont on
peut dire qu’ils ont acquis un contrôle absolu de la production de
nourriture (...) Si elle n’avait pas posé les bases de la
subsistance, l’humanité n’aurait pas pu se propager dans
d’autres régions (...) et finalement sur toute la surface de la
terre (...)
Il est donc probable que les grandes
époques de progrès humain ont été identifiées plus ou moins
directement avec l’accroissement des sources de subsistance.89
Engels emboîtait le pas à Morgan dans sa
division de l’histoire humaine en trois grands stades : l’état
sauvage, la barbarie et la civilisation. Chacun avait « une
culture et un mode de vie distincts, plus ou moins spécial et lui
étant particulier » et reposait sur une façon donnée
d’assurer l’existence90
:
Etat sauvage : Période où
prédomine l’appropriation de produits naturels tout faits ;
les productions artificielles de l’homme sont essentiellement des
outils aidant à cette appropriation.
Barbarie : Période de l’élevage
du bétail, de l’agriculture, de l’apprentissage de méthodes qui
permettent une production accrue de produits naturels grâce à
l’activité humaine.
Civilisation : Période où l’homme
apprend l’élaboration supplémentaire de produits naturels,
période de l’industrie proprement dite, et de l’art.91
Les termes eux-mêmes reflètent les préjugés de
la fin du 19ème siècle, la représentation des sociétés
soi-disant « primitives » comme « sauvages »
et « barbares ». Mais Morgan et Engels, qui tous deux
rejetaient dans l’ensemble ces préjugés, pouvaient utiliser ces
distinctions pour comprendre ce qui est central dans toute étude
scientifique du développement social humain : la distinction
entre des sociétés où les êtres humains se nourrissent en
cueillant des baies, des noix et des racines et en chassant des
créatures sauvages (sociétés appelées « de
chasseurs-cueilleurs »), des sociétés où les humains
cultivent la terre et élèvent des mammifères (« sociétés
agricoles ») et des sociétés qui connaissent un certain degré
d’urbanisation (« civilisation » au sens littéral de
basées dans les villes).92 Ceci, à son tour, a permis à
Engels de remettre en cause bien des
préjugés orthodoxes sur la société.
Les penseurs les plus réactionnaires proclament
que les « sociétés primitives » sont très
hiérarchisées, sous la coupe de mâles brutaux, agressifs et
meurtriers.93
Comme ces sociétés ont existé bien plus longtemps que la
« civilisation », il s’ensuit que la nature humaine est
semblablement brutale, agressive et meurtrière.
L’opinion d’Engels était très différente.
Il pensait, utilisant comme modèle la descriptio par Morgan des
Iroquois d’Amérique du Nord, que les premières sociétés étaient
organisées de façon complètement différente des sociétés de
classe. Il n’y avait pas chez elles de propriété privée et pas
de division en classes. Et elles n’étaient pas rendus cohésives
par un Etat dans le sens d’une « autorité publique spéciale
séparée de la totalité de ceux qui étaient concernés dans chaque
cas ». Au lieu de cela, elles étaient organisés en groupes
« consanguins » étendus et liés entre eux (de gens qui
avaient des liens de parenté ou pensaient en avoir) – des groupes
qu’Engels appelait « gentes » , « clans »
ou « phratries » et que les anthropologues modernes
appellent habituellement « lignages » :
Et avec toute son ingénuité et sa
simplicité, quelle admirable constitution que cette organisation
gentilice ! Sans soldats, gendarmes ni policiers, sans noblesse, sans
rois ni gouverneurs, sans préfets ni juges, sans prisons, sans
procès, tout va son train régulier. Toutes les querelles et toutes
les disputes sont tranchées par la collectivité de ceux que cela
concerne (...) Bien que les affaires communes soient en nombre
beaucoup plus grand que de nos jours, – l’économie domestique
est commune et communiste dans une série de familles, le sol est
propriété de la tribu, seuls les petits jardins sont assignés
provisoirement aux ménages, – on n’a quand même nul besoin de
notre appareil administratif, vaste et compliqué (...) Il ne peut y
avoir de pauvres et de nécessiteux – l’économie domestique
communiste et la gens connaissent leurs obligations envers les
vieillards, les malades, les invalides de guerre. Tous sont égaux et
libres, y compris les femmes. Il n’y a pas encore place pour les
esclaves, pas plus qu’en général pour l’asservissement des
tribus étrangères (...) Voilà ce qu’étaient les hommes et la
société humaine, avant que s’effectuât la division en
différentes classes94
Les études modernes sur les sociétés
survivantes de chasseurs-cueilleurs et d’agriculteurs primitifs ont
confirmé l’essentiel de la vision d’Engels. Les peuples
chasseurs-cueilleurs vivent dans ce qu’on appelle habituellement
des « sociétés de bandes » – basées sur des groupes
variables de 30 à 40 personnes qui peuvent, périodiquement,
rencontrer d’autres groupes dans des rassemblements pouvant compter
jusqu’à deux cents individus. Il n’y a pas de commandement
formel, pour ne pas parler de divisions de classe, dans ces sociétés.
Les prises de décision individuelles
sont possibles à la fois pour les hommes et les femmes en ce qui
concerne leurs activités quotidiennes (...) Les hommes aussi bien
que les femmes sont libres de décider comment ils vont passer la
journée : aller à la chasse ou à la cueillette, et avec qui95
Il n’y avait pas d’accès aux
ressources différencié selon la propriété privée du sol ni de
spécialisation du travail autre que celle déterminée par le sexe
(...) Le principe de base des sociétés égalitaires de bandes était
que les gens prenaient des décisions concernant les activités dont
ils étaient responsables.96
Les membres individuels de la bande jouissent d’un
niveau d’autonomie infiniment plus grand que la masse du peuple
dans les sociétés de classe. Mais elle n’est pas accompagnée
d’égoïsme dans leurs relations réciproques. Bien au contraire,
l’accent est mis sur la générosité, sur l’aide que s’apportent
mutuellement les individus :
La nourriture n’est jamais consommée
par une famille seule : elle est toujours partagée entre les
membres d’un groupe de vie ou d’une bande (…) Chaque membre du
camp reçoit une part équitable (…) Ce principe de réciprocité
généralisée a été constaté chez les chasseurs-cueilleurs sur
tous les continents et dans tous les types d’environnement.97
Il y règne un mépris marqué pour les notions de
compétition qui sont considérées comme normales dans notre
société. Comme le raconte Richard Lee à propos des !Kung98 du
Kalahari (appelés parfois « bushmen ») :
Les !Kung sont un peuple résolument
égalitaire, et ils ont mis en place toute une série d’importantes
pratiques culturelles pour maintenir cette égalité, d’abord en
remettant à leur place les arrogants et les vantards, ensuite en
venant en aide à ceux qui connaissent des périodes de malchance.
(…) Les hommes sont encouragés à chasser du mieux qu’ils
peuvent, mais l’attitude correcte pour un chasseur doué est la
modestie.99
Un des !Kung raconte :
Mettons qu'un homme est allé à la
chasse. Il ne doit pas, en rentrant à la maison, annoncer comme un
vantard : « J’en ai tué un gros dans la savane !’ »Il
doit d’abord s’asseoir en silence jusqu’à ce que moi ou un
autre vienne à son feu et lui demande : « Qu’est-ce que
tu as fait aujourd’hui ? » Il répond calmement :
« Ah, je ne suis pas un bon chasseur. Je n’ai rien vu… sauf
peut-être une petite chose.’ » Et là je souris, parce que
je sais qu’il a tué un gros gibier.100
Un jésuite d’autrefois rapportait de ses
observations d’un autre peuple chasseur-cueilleur, les Montagnais
du Canada : « ces deux tyrans qui donnent la torture et la
géhenne à un grand nombre de nos Européens ne règnent pas dans
leurs grandes forêts, – je veux parler de l’ambition et de
l’avarice (…) comme ils se contentent d’une vie élémentaire,
aucun d’entre eux ne s’est vendu au diable pour acquérir de la
richesse ».101
Il n’y a ni chef ni patron dans ces bandes. Ainsi, les pygmées
Mbuti du Congo
n’ont jamais de chefs (…) Dans chacun
des aspects de la vie des pygmées il peut y avoir un ou deux hommes
ou femmes qui se distinguent des autres, mais c’est habituellement
pour de bonne raisons pratiques (…) Le respect de la loi était une
affaire de coopération (…) Le plus sérieux des crimes, comme un
vol, était traité par une bonne raclée administrée collectivement
par ceux qui avaient envie d’y participer, mais uniquement après
que le camp tout entier ait débattu du cas. Les pygmées détestent
et évitent l’autorité personnelle.102
Parmi les !Kung « des schémas de leadership
existent », mais ils sont très différents du pouvoir tel que
nous le connaissons. Dans les discussions, les opinions de certains
individus tendent à avoir plus d’impact que celles des autres.
« Ces individus sont le plus souvent des anciens qui ont vécu
là longtemps et qui ont quelque qualification personnelle digne de
respect en tant qu’orateurs, débatteurs, spécialistes des rites,
ou chasseurs. » Mais
Quelles que soient leur habileté, les
leaders !Kung n’ont aucune autorité formelle. Ils peuvent
seulement persuader, mais jamais imposer leur volonté aux autres.
(…) Aucun n’est arrogant, abusif ou vantard. Chez les !Kung, ces
traits disqualifient absolument une personne comme dirigeant. (…)
Un autre trait qu’on ne trouve absolument pas chez les dirigeants
de camp traditionnels est le désir de richesse ou la possessivité.103
De plus – et là Engels se trompait – il n’y
a pas grand-chose qui ressemble à la guerre chez les chasseurs
cueilleurs. Il peut y avoir à l’occasion des conflits entre
différentes bandes, mais ils sont d’importance marginale.104
Parmi les !Kung, il existe une notion selon laquelle un trou d’eau
et la portion de terrain qui l’entoure sont « possédés »
par un groupe et transmis de génération en génération. Mais
d’autres groupes peuvent utiliser le terrain, à condition de
demander la permission. « Les disputes sur la nourriture ne
sont pas inconnues chez les !Kung, mais elles sont rares ».105
De telles preuves réfutent complètement la
version selon laquelle la préhistoire de l’humanité dans son
ensemble, de l’époque des australopithèques jusqu’à
l’émergence de l’écriture, était fondée sur « l’impératif
de tuer », que « les bandes de chasseurs-cueilleurs
livraient bataille pour des trous d’eau qui trop souvent tendaient
à disparaître sous les effets du soleil africain », que nous
sommes tous les « enfants de Caïn », que « l’histoire
humaine a changé du fait du développement d’armes supérieures
(...) pour des nécessités génétiques », et que, par
conséquent, seul un vernis de « civilisation » peut
dissimuler une « joie du massacre, de l’esclavage, de la
castration et du cannibalisme » de nature instinctive.106
Les attributs de « communisme primitif »
des sociétés de bandes ne peuvent être compris qu’en jetant un
coup d’œil à la façon dont elles subsistent. La taille normale
des bandes est restreinte par la nécessité de trouver suffisamment
de nourriture quotidiennement dans la zone du camp. A l’intérieur
de cette zone, les membres individuels sont en mouvement constant,
d’une source de plantes à une autre ou à la poursuite d’animaux.
Et la bande dans son ensemble devra migrer périodiquement, en même
temps que les ressources locales commencent à se raréfier. Le
mouvement constant interdit toute accumulation de richesse pour les
membres de la bande, tout devant être aisément transporté. Au
maximum, un individu peut avoir un javelot ou un arc et des flèches,
un sac de voyage et quelques ustensiles. « La valeur majeure
est la liberté de mouvement (...) le désir d’être libéré des
charges et des responsabilités qui pourraient interférer avec
l’existence itinérante de la société ».107
L’accent mis sur la valeur de la générosité
est la conséquence du fait que les chasseurs et les cueilleurs sont
intensément dépendants les uns des autres. Les cueilleurs
fournissent habituellement la source de nourriture la plus sûre, les
chasseurs celle qui est la plus appréciée. De telle sorte que ceux
qui sont spécialisés dans la chasse dépendent pour leur survie
quotidienne de la générosité de ceux qui cueillent, en même temps
que ceux qui se spécialisent dans la cueillette – ou ceux qui
temporairement sont malchanceux à la chasse – dépendent pour des
compléments appréciés à leur régime de ceux qui réussissent à
tuer des animaux. Et la chasse elle-même ne consiste pas
habituellement dans l’activité du héros masculin individuel qui
s’en va tuer sa proie, mais plutôt dans celle d’un groupe
d’hommes (souvent avec l’aide des femmes et des enfants) qui
collaborent pour poursuivre et capturer cette proie.
Il y a presque toujours dans ces sociétés une
division du travail entre les hommes et les femmes, les hommes
assumant la plus grande part de la chasse et les femmes la
cueillette. Ceci parce qu’une femme enceinte, ou qui allaite, ne
peut prendre part à la chasse qu’en s’exposant au danger –
menaçant ainsi la reproduction de la bande. Mais cette division
n’équivaut pas à la dominance masculine telle que nous la
connaissons dans les sociétés contemporaines. Les mâles et les
femelles prennent une part égale dans les prises de décision, comme
le moment de lever le camp ou le fait de quitter une bande pour en
rejoindre une autre. Et l’unité conjugale elle-même est
structurée de façon souple. Les épouses, dans n’importe laquelle
de ces sociétés, peuvent se séparer de leur conjoint sans mettre
en péril leurs moyens d’existence ou ceux de leurs enfants.108
Ainsi, Engels avait raison de dire qu’il n’y
avait pas, dans ces sociétés, de domination systématique exercée
sur les femmes. Cela dit, il avait probablement tort en ce qui
concerne un détail important – il surestimait le rôle joué par
les lignages dans la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs.
Les bandes similaires qui subsistent sont organisées de façon
souple et flexible. Les membres sont libres d’entrer et de sortir.
Ils ne sont pas étroitement contrôlés par des groupes de lignage,
même si les membres d’une bande sont souvent reliés par des liens
de parenté et ont, par mariage, des liens avec d’autres bandes.109
La croyance d’Engels dans le pouvoir de la gens
ou du clan dans toutes les « sociétés primitives »
existantes était le résultat des connaissances anthropologiques de
son temps. Il s’appuyait essentiellement sur la narration directe
de Morgan concernant les Iroquois et sur celle, indirecte, de la
société polynésienne – toutes deux des sociétés agricoles (ou
« horticoles ») – plutôt que de chasseurs-cueilleurs,
sur lesquels ni lui ni Morgan ne savaient grand-chose.
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs existantes
ne sont pas nécessairement identiques à celles dans lesquelles
l’ensemble de l’humanité vivait autrefois. Des gens comme les
!Kung, les Mbuti, les Inuit et les aborigènes australiens ont une
histoire aussi longue que la nôtre – et leur société a été
influencée, d’abord par l’impact des sociétés agricoles
voisines et aussi, de façon traumatique, par la colonisation
occidentale.110
De telle sorte que leurs formes de vie sociale peuvent être
différentes à de nombreux égards de celles observées chez nos
ancêtres communs. Ces derniers peuvent avoir eu de fortes structures
de lignage, comme le pensait Engels, mais nous n’avons aucun
élément pour le prouver.
Sur la question de l’égalitarisme, malgré
tout, nous sommes en terrain plus ferme. L’importance du partage,
les fortes valeurs coopératives et la constitution flexible de la
bande doivent avoir caractérisé la vie de nos ancêtres pendant des
dizaines de milliers d’années de la même manière qu’elles
caractérisent celle des chasseurs-cueilleurs contemporains. Ces
valeurs conviennent parfaitement aux besoins de la vie nomade. Ce ne
sont pas des valeurs qu’on retrouve dans les sociétés de classe,
et donc leur survie parmi les chasseurs-cueilleurs ne peut être le
résultat de pressions externes. Lee fait remarquer avec pertinence
que « malgré sa puissance économique et militaire et son
quasi monopole de l’appareil idéologique, l’Etat capitaliste n’a
pas réussi à éradiquer d’innombrables poches de communautarisme
(communisme primitif) ».111 Ceci désigne le communisme
primitif comme un stade antérieur à
l’émergence de la société de classe, comme étant la condition
de l’humanité dans son ensemble à une époque de notre histoire.
Ceci est d’une importance extrême dès lors
qu’il s’agit de définir la « nature humaine ». Si
une telle nature existe, elle a été modelée, par la sélection
naturelle, pendant les 2,5 millions d’années de la période de
chasse et de cueillette, entre la première apparition de l’homo
habilis et les premières plantations par l’homo sapiens
du 8ème millénaire av. JC. Lee a raison d’insister sur
le fait que
C’est le long vécu de partage
égalitaire qui a modelé notre passé. Malgré notre apparente
adaptation à la vie dans des sociétés hiérarchisées, et malgré
l’état inquiétant des droits de l’homme dans de nombreuses
parties du monde, il y a des signes que l’humanité conserve un
sens profond de l’égalitarisme, un engagement enraciné envers la
norme de réciprocité, un sens profond (...) de la communauté
(...)112
Les
premiers agriculteurs
Plus de 99,9 % de l’humanité vit
aujourd’hui dans des sociétés qui ont été modelées par un
changement intervenu il y a environ 10 000 ans. Il a comporté
l’établissement de villages stables, l’utilisation d’une
panoplie d’outils nouveaux, plus variés et plus complexes, faits
de pierre, de bois et d’os (d’où le terme de « néolithique »,
qui signifie « nouvel âge de pierre »), l’usage de
pots d’argile pour conserver les aliments et les cuisiner, et,
peut-être le plus important, la première mise en culture du sol.
Cette étape est habituellement désignée par le
terme de Gordon Childe « révolution néolithique ».
Engels la considérait comme la transition de « l’état
sauvage » à la « barbarie ». Selon lui, elle a
commencé avec l’introduction de la poterie et a continué dans
l’hémisphère oriental (Eurasie et Afrique) « avec l’élevage
d’animaux », et aux Amériques « avec la culture de
plantes alimentaires au moyen de l’irrigation et avec l’emploi
pour les constructions d’adobes (briques séchées au soleil) et
de pierre ».113
Dans l’hémisphère oriental, mais pas dans les Amériques, a suivi
un « stade supérieur de la barbarie » qui « commence
avec la fonte du minerai de fer ». « Nous rencontrons
pour la première fois la charrue de fer traînée par des animaux,
qui rendit possible la culture des champs sur une grande échelle,
l’agriculture, et du même coup un accroissement des moyens
d’existence pratiquement illimité, eu égard aux conditions de
l’époque ». Et « de là également le défrichage des
forêts, et leur transformation en terres arables et en prairies,
transformation impossible elle aussi, à grande échelle, sans la
hache de fer et la bêche de fer. Mais de là encore vint
l’accroissement rapide de la population, et la densité de celle-ci
sur un espace restreint ».114 Ces changements dans la
production sous la « barbarie »,
poursuit Engels, ont posé les bases des premiers développements de
la société de classe :
A qui donc appartenait cette richesse
nouvelle ? A l’origine, elle appartenait sans aucun doute à
la gens. Mais de bonne heure déjà la propriété privée des
troupeaux a dû se développer (...) au seuil de l’histoire pour
laquelle nous possédons des documents, nous trouvons que les
troupeaux étaient déjà partout la propriété particulière des
chefs de famille, au même titre que les produits de l’art
barbare : ustensiles de métal, articles de luxe, au même titre
enfin que le bétail humain : les esclaves.
Car l’esclavage aussi était inventé,
dès ce moment-là (...) l’esclave était sans valeur (...) à ce
stade, la force de travail humaine ne fournit pas encore d’excédent
appréciable sur ses frais d’entretien. Il en fut tout autrement
avec l’introduction de l’élevage, du travail des métaux, du
tissage et, enfin, de l’agriculture.115
Engels a tort sur un certain nombre de points
relativement importants. La société de classe et la civilisation se
sont bien développées en Amérique centrale et méridionale ainsi
qu’en Eurasie et en Afrique. L’agriculture (sans usage de la
charrue) a commencé à peu près à la même époque que l’élevage,
et non après. La première forme de société de classe n’est pas
l’esclavagisme, qui semble être resté une forme marginale
d’exploitation des classes opprimées jusqu’à l’époque
gréco-romaine. Cela dit, son image générale de l’apparition de
la société de classe est fondamentalement correcte.
L’organisation de la société tout entière a
connu un changement radical en même temps que les groupes humains
développaient de nouveaux moyens de subsistance. A des époques
différentes, ils passèrent de la chasse et de la cueillette à
l’agriculture indépendamment les uns des autres (dans plusieurs
régions des Amériques, dans au moins trois parties distinctes de
l’Afrique, sur les plateaux de l’Irak, dans la vallée de
l’Indus, en Indochine, dans les vallées de la Papouasie-Nouvelle
Guinée centrale, et en Chine).116 Et là où le changement
cumulatif allait le plus loin, il donna
naissance à la première division en classes, aux premiers Etats et
à la première oppression systématique des femmes. Mais le
changement total se produisit sur une longue période – 4 000
ou 5 000 ans dans le cas le plus étudié, celui de la
Mésopotamie (aujourd’hui l’Irak). Et dans la plupart des
sociétés il n’alla pas aussi loin, et il y a encore un siècle et
demi des millions de personnes vivaient dans des sociétés agricoles
sans divisions de classe.
La première forme d’agriculture (souvent
appelée « horticulture ») consistait à défricher
l’espace (en coupant les forêts et les broussailles avec des
haches et en brûlant le reste) et à planter et à récolter des
graines ou des tubercules en employant une houe ou un bâton pour
creuser. Habituellement, après un an ou deux la fertilité de la
terre était épuisée. Cela amenait à se déplacer vers de
nouvelles zones qui étaient à leur tour défrichées pour être
cultivées. La récolte, dans un endroit où était pratiquée la
culture sur brûlis, était loin d’être aussi importante que celle
obtenue plus tard par l’irrigation et la charrue, mais le produit
était considérablement plus élevé que celui de toutes les formes
de chasse-cueillette.
Tout ceci était porteur de conséquences sociales
immédiates. Les gens n’avaient plus besoin de se déplacer
constamment comme avec la chasse et la cueillette, en fait il aurait
été désastreux de bouger entre les semailles et la récolte. Pour
la première fois, cela avait un sens de fabriquer de lourds pots
d’argile et d’y stocker des objets divers. Et la production
locale de denrées alimentaires étant souvent suffisante pour
nourrir cinq ou dix fois plus de personnes qu’auparavant, elle
donna naissance à l’existence villageoise.
Des changements se produisirent aussi,
nécessairement, dans la structure de chaque groupe social. D’une
part, les foyers individuels devinrent moins dépendants de la
coopération avec le reste du groupe pour obtenir leur
subsistance :
une large coopération de groupe était souvent nécessaire pour
défricher les terres, mais chaque foyer pouvait lui-même ensemencer
et cultiver son propre lopin de terre défrichée. D’autre part, il
fallait faire en sorte que les foyers qui avaient beaucoup de
personnes en mesure de travailler mais peu de bouches à nourrir
fournissent aide et assistance à ceux qui avaient beaucoup de
bouches à nourrir mais peu de personnes en mesure de travailler –
en particulier ceux qui avaient de nombreux enfants en bas âge.117
Car les enfants représentaient la future force de travail du village
dans son ensemble, et s’ils n’étaient pas élevés avec soin, le
groupe lui-même finirait par disparaître.
Le passage à l’agriculture produisit en fait un
changement très important dans les besoins du groupe au regard de la
reproduction. Aux temps de la chasse et de la cueillette, la
nécessité de porter les enfants, que ce soit dans la tournée
quotidienne de cueillette ou lors des mouvements périodiques du camp
tout entier, menait à une sévère restriction du taux de natalité.
Les femmes ne pouvaient pas se permettre d’avoir en même temps
plus d’un enfant à porter, de telle sorte que les naissances
étaient espacées de trois ou quatre ans (si nécessaire par
l’abstention sexuelle, l’avortement ou l’infanticide). Avec une
vie de village fixe basée sur l’agriculture, au contraire, non
seulement au bout de quelques mois l’enfant n’avait plus besoin
d’être porté, mais plus le nombre d’enfants était grand, et
plus grande était la superficie de terre qui pourrait être
défrichée et cultivée dans l’avenir. Pourvoir à la reproduction
devint central dans la dynamique de la société.
Il fallait qu’autre chose soit assuré pour le
groupe puisse s’épanouir – un mécanisme nouveau de contrôle
social. Une grosse altercation dans une bande de chasseurs-cueilleurs
peut se régler par la scission de la bande ou par le départ de
quelques individus. Cette option n’est pas possible pour un groupe
d’agriculteurs une fois qu’ils ont défriché et ensemencé leur
terre. Ils ne peuvent survivre aux disputes, aux conflits et aux
infractions aux normes sociales que s’il existe une superstructure
de contrôle bien plus développée que chez les
chasseurs-cueilleurs.
Cela peut expliquer le rôle accru des lignages.
Ils relient les gens entre eux de façon beaucoup plus étroite dans
les premières sociétés de cultivateurs que chez la plupart des
chasseurs-cueilleurs. Désormais apparaît un ensemble de droits et
de devoirs envers les membres d’autres foyers avec lesquels existe
un lien, qu’il soit de parenté directe ou indirecte par le mariage
ou d’association de groupes d’âge. Les individus qui n’ont
rien à manger peuvent espérer obtenir de la nourriture de ceux
désignés comme « oncles », « cousins » dans
leur lignage (pas seulement les parents proches, mais aussi les
cousins au second, troisième ou quatrième degré ou plus). Et le
moyen d’accéder à un prestige social est d’avoir suffisamment
de nourriture en surplus pour pouvoir se comporter en généreux
donateur.
Les lignages, en empêchant qu’un foyer
connaisse la faim, assurent la reproduction du groupe dans son
ensemble. Mais ce n’est pas tout. Comme ils deviennent responsables
de l’exercice du contrôle social sur leurs membres, ils sont de
plus en plus formalisés dans leur mode opérationnel. La prise de
décision en vient à être concentrée entre les mains d’un des
membres du lignage – habituellement un des anciens. Et dans
beaucoup de sociétés les choses arrivent au point ou certains
lignages ont plus de prestige que d’autres. Et on peut parvenir à
une situation, comme à Tonga même avant tout contact avec les
Européens, dans laquelle les personnalités dirigeantes
(« chefs »)
issues de lignages prestigieux parviennent à échapper à la charge
du travail productif et commencent à se transformer en classe
exploiteuse.118
Les
premières hiérarchies
Pourquoi cette différenciation se
produit-elle ?
L’explication la plus plausible est la suivante : une fois que
des groupes humains sont installés quelque part, ils peuvent
commencer à stocker des quantités considérables de nourriture et
d’autres valeurs. Ceux des lignages qui réussissent le mieux –
même pour des raisons purement accidentelles, par exemple le fait
d’avoir une terre plus fertile que la moyenne – vont pouvoir
faire des cadeaux plus importants que d’autres lignages, et y
gagner un plus grand prestige. Et, de façon similaire, à
l’intérieur de chaque lignage, certains foyers vont pouvoir
devenir plus riches que d’autres et obtenir à nouveau du prestige.
C’est ainsi que les valeurs mêmes de générosité dont cette
société est porteuse encouragent une différenciation de statut.
Cela conduit à l’apparition de ceux que les
anthropologues appellent « les grands hommes », des
individus obtenant du prestige du fait des richesses qui sont à leur
disposition. Pourtant, et ceci est très important, ces individus
n’utilisent pas ces richesses pour leur bien-être personnel. Ils
ont du prestige précisément parce qu’ils donnent aux autres.
Dans sa forme la plus développée, tout un
système de collecte et de distribution de la richesse voit le jour.
Les « grands hommes » utilisent leur prestige pour réunir
entre leurs mains tout le surplus produit par les autres membres de
leur lignage, mais ils renforcent leur prestige en redistribuant le
surplus, au cours de grandes fêtes cérémonielles données à ceux
qui leur sont reliés directement ou indirectement. Et un lignage
particulier peut élever son prestige au dessus de celui d’autres
lignages auxquels il est relié par mariage en leur donnant des
fêtes.
C’est un système dans lequel certains individus
et certains lignages ont un prestige plus grand que les autres,
culminant dans certains cas dans l’établissement de chefs
héréditaires et de lignages de chefs. Mais ce n’est pas un
système de classes, dans lequel une section de la société consomme
le surplus produit par une autre section. Malgré l’établissement
de hiérarchies héréditaires ou semi-héréditaires en termes de
prestige, le mode de production demeure commun, avec des schémas de
consommation définis par l’égalitarisme et le partage.
Richard Lee note qu’un « grand nombre de
sociétés pastorales et horticoles du tiers monde partagent les
mêmes traits » de « concepts de propriété commune »
que les sociétés de chasseurs-cueilleurs. « Dans un certain
nombre de chefferies décrites par les anthropologues en Afrique,
Océanie et Amérique du Sud, on note, par exemple, qu’une grande
partie du tribut reçu par les chefs est redistribuée aux sujets, et
le pouvoir du chef peut être contesté par l’impact de l’opinion
publique et des institutions ».119 Ainsi, parmi les
Nambikwara d’Amérique du Sud
le chef ne doit pas se contenter de bien
faire. Il doit essayer, et c’est ce que son groupe attend de lui,
de faire mieux que les autres (...) Même si le chef ne paraît pas
dans une position privilégiée du point de vue matériel, il doit
avoir sous son contrôle un surplus suffisant de nourriture,
d’outils, d’armes et d’ornements (...) Lorsqu’un individu,
une famille ou une bande souhaite ou a besoin de quelque chose, c’est
au chef qu’un appel est lancé. La générosité est donc le
premier attribut que l’on attend d’un nouveau chef.120
Cela peut même aboutir à ce que le chef
connaisse plus de difficultés matérielles que ses subordonnés.
Ainsi, chez les Busama de Nouvelle Guinée, le dirigeant « doit
travailler davantage que tout le monde pour maintenir ses réserves
de nourriture (...) Il doit trimer du matin au soir – ses mains ne
sont jamais libres de la terre, et son front dégouline
continuellement de sueur ».121 Dans ces sociétés beaucoup
de valeurs de base restent plus proches
de celles des chasseurs-cueilleurs que de celles auxquelles on est
habitué dans les sociétés de classe. Un observateur des
horticulteurs Iroquois du début du 18ème siècle a
noté : « Si une tribu d’Iroquois affamés en rencontre
une autre dont les provisions ne sont pas entièrement épuisées,
ces derniers partageront avec les nouveaux venus (...) sans attendre
qu’on leur demande, même s’ils s’exposent ainsi aux mêmes
dangers que ceux qu’ils assistent ».122 Et une histoire semblable
peut être trouvée dans une étude
classique des pasteurs Nuer.123
Pourtant, ces valeurs communautaires, égalitaires,
connaissent souvent des débuts de contestation, des foyers essayant
de se soustraire à leurs obligations d’une façon qui n’arrive
jamais chez les chasseurs-cueilleurs. Dissimulées derrière
l’égalitarisme et l’idéologie communautaire, on trouve souvent
des tendances latentes à placer les besoins du foyer au dessus de
ceux de la communauté. Les Bemba d’Afrique de l’Est, par
exemple, vont cacher leur bière lorsqu’un vieux parent vient les
visiter, lui racontant : « Ah ! Pauvres de nous, nous
n’avons rien à manger ».124 Il y a chez les Maoris un
dicton : « Cuis ton rat (un mets
favori) avec sa fourrure, de peur d’être dérangé ».125
Après qu’un ouragan ait causé une sérieuse pénurie chez les
Tikopia – un peuple connu pour sa générosité – des maisonnées
se mirent à éviter de manger lorsque des gens avec lesquels ils
étaient censés partager étaient présents.126
Ce comportement contradictoire n’est pas le
résultat d’un égoïsme inhérent à la « nature humaine »,
mais une contradiction du système productif. La production en
elle-même ne repose pas sur la coopération du groupe dans son
ensemble, comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais est
basée, grosso modo, sur le soin apporté aux cultures et au cheptel
par le foyer individuel.127 Le lignage et le groupe
sont concernés par la redistribution et la
reproduction plutôt que par la production. Comme dit Karen Sachs, il
y a une « contradiction » dans ce « mode de
production » entre les « rapports de production »
basés sur le lignage et les « forces productives » qui
dépendent essentiellement des foyers.128
La survie de la société dépend à la fois de
l’activité individuelle des foyers qui assurent la production et
du partage coopératif et altruiste à l’intérieur du groupe qui
assure la reproduction. Et cela signifie que le foyer peut résister
à ses obligations envers la société lorsque surviennent des
conditions dans lesquelles sa survie est en jeu. Ce n’est pas une
question de bénéfice individuel opposé au bien-être social, mais
des besoins d’un élément du mode de production qui entrent en
conflit avec d’autres éléments.
Habituellement le foyer réussit à concilier les
pressions contradictoires, et le système ne s’effondre pas. Mais
il n’est pas difficile de voir comment des changements internes (de
nouvelles techniques productives) ou des pressions externes
(catastrophes naturelles, épuisement des sols, impact d’autres
sociétés) peuvent créer les conditions d’une crise aiguë dans
laquelle le vieil ordre ne peut plus se maintenir, amenant certains
foyers ou lignages riches à briser complètement avec leurs
obligations ancestrales. Ce qui était de la richesse à distribuer
aux autres en retour du prestige devient dès lors de la richesse à
consommer pendant que d’autres souffrent. « Dans des formes
avancées de chefferies (...) ce qui commence avec l'homme fort
potentiel qui met sa production à la disposition des autres se
termine, à un certain degré, avec les autres mettant leur
production à la disposition du chef ».129
Il y a un autre changement très important dans la
transition de la chasse-cueillette à l’agriculture. Pour la
première fois, la guerre systématique prend un sens. La richesse
stockée est une richesse qui peut être volée aux groupes
d’agriculteurs. Alors que les affrontements entre bandes rivales
sont très rares chez les chasseurs-cueilleurs, « la guerre
organisée dans le but de défendre ou d’agrandir son territoire
est endémique (...) chez les horticulteurs ».130
Mais la guerre permet à certains individus et
lignages d’obtenir un grand prestige en concentrant entre leurs
mains le butin et les tributs extorqués à des sociétés rivales.
La hiérarchie devient plus prononcée, même si elle reste associée
avec la capacité de donner aux autres. Et dans ce cadre la guerre
devient un facteur qui ouvre la possibilité de l’émergence de
rapports de classe face à une importante crise sociale.
Ainsi, Christine Ward Gailey suggère que les
tentatives exercées entre 1100 et 1400 par les chefs de haut rang de
Tonga pour s’exonérer de leurs obligations envers les gens de rang
inférieur – une tentative de s’ériger en classe dirigeante –
étaient le résultat de leur victoire dans la bataille contre les
habitants d’autres îles.
Les
origines de l’agriculture
Il y a un problème qui a longtemps intrigué ceux
qui ont étudié la transition de la chasse-cueillette à
l’agriculture. Pourquoi les gens ont-ils fait le changement ?
On avait l’habitude de penser que le changement avait apporté de
telles améliorations dans leur vie qu’ils étaient prêts à
l’accepter avec enthousiasme. Mais aujourd’hui de nombreux
éléments réfutent cette notion simpliste. Dans beaucoup de
sociétés de chasseurs cueilleurs et d’horticulteurs, les gens ont
dans la réalité travaillé moins et étaient au moins aussi bien
nourris que dans des sociétés basées sur l’agriculture
intensive. Ainsi les !Kung du désert du Kalahari semblent avoir vécu
dans une région où les ressources permettant la survie humaine
étaient rares. Mais ils avaient une ration alimentaire et un apport
calorique plus élevés que la moyenne relevée dans l’Inde
d’aujourd’hui – et ils n’avaient pas besoin de travailler
plus de trois ou quatre heures par jour. Ils semblent avoir vécu
dans ce que Marshall Sahlins a appelé « la société
d’abondance originelle ».131
Cela explique pourquoi beaucoup de sociétés de
chasseurs-cueilleurs ont refusé de faire la transition vers
l’agriculture, même s’ils étaient parfaitement au courant de
certaines techniques agricoles. Ils identifiaient l’agriculture
avec une charge de travail alourdie sans nécessité.
Des versions plus récentes de la transition
mettent l’accent, au contraire, sur la façon dont certains
changements auraient pu produire des tensions dans les sociétés de
chasseurs-cueilleurs avant la transition vers l’agriculture. En
particulier, ils font remarquer que toutes les sociétés de
chasseurs-cueilleurs ne sont pas en mouvement continuel. Certaines
ont trouvé des sources de nourriture plus ou moins stables leur
permettant de vivre dans des camps fixes, qui parfois se développent
et deviennent des villages de plusieurs centaines d’habitants. Cela
est vrai, par exemple, des habitants originaux de la côte pacifique
nord-ouest de l’Amérique, qui subsistent sur la base de
l’abondance du poisson. Il est significatif que dans de telles
sociétés il y ait déjà des traces de stratification sociale :
parce qu’un surplus peut être stocké et que la cohésion d’un
groupe social relativement important doit être maintenue, certains
individus acquièrent du prestige (mais pas de pouvoir ni de niveau
de vie plus élevé) en remplissant ces tâches.132 Cela dit, la vie pour la
majorité des gens possède des avantages
sur celle des chasseurs-cueilleurs nomades. Les enfants ne doivent
pas être transportés à tout bout de champ sur de longues
distances, et donc il n’y a pas besoin d’espacer les naissances,
que ce soit par avortement, infanticide ou abstention sexuelle. Et le
regroupement social permanent, plus large, offre davantage
d’occasions de rapports sociaux, occasions qui sont habituellement
réduites chez les chasseurs-cueilleurs nomades aux quelques semaines
de l’année durant lesquelles plusieurs bandes différentes campent
ensemble.
Si la vie est plus facile pour les
chasseurs-cueilleurs nomades que pour les agriculteurs, elle est
encore plus facile pour les chasseurs-cueilleurs non nomades, à
condition qu’ils aient une source de nourriture abondante et
stable. Il n’est pas surprenant que des chasseurs-cueilleurs
nomades optent pour ce nouveau mode de vie et que, dans de telles
conditions, leur population s’accroisse rapidement.
Malgré tout, le nouveau mode de vie dépendait de
l’existence de sources de nourriture locales copieuses. Si
celles-ci disparaissaient pour une raison ou une autre, les gens
faisaient face à d’énormes problèmes. Leurs communautés étaient
trop grandes pour qu’ils puissent revenir à un mode de vie basé
sur de petites bandes mobiles. Cela aurait impliqué une rupture
complète avec le mode de vie établi, une désintégration sociale
massive, l’apprentissage (ou le ré-apprentissage) de techniques de
survie – et sans doute une famine à grande échelle au début. Ils
étaient donc incités à aborder de nouvelles manières d’obtenir
leur subsistance, même si cela signifiait une intensification du
travail.
C’est ce
qui semble s’être produit dans le Croissant fertile du
Moyen-orient. Vers 11 000 avant notre ère, les conditions
climatiques de la région ont changé au point de fournir aux peuples
« Natoufiens » locaux des sources abondantes à la fois
de viande (des troupeaux d’antilopes) et de grain sauvage, de telle
sorte qu’ils ont pu commencer à vivre dans de larges groupes
sédentaires (villages) sans avoir à abandonner le mode de vie
chasseur-cueilleur. Mais, après trois millénaires, les conditions
écologiques ont à nouveau changé, et ils ne pouvaient plus compter
sur les troupeaux et les grains sauvages pour se nourrir. « Le
déséquilibre entre la population et les ressources est reflété
par la tension du régime alimentaire, l’infanticide des filles et
le déclin de la consommation de viande ».133
A ce moment-là, la survie des habitants de la
société dépendait d’un changement dans leur mode de vie. Il y
avait deux directions que pouvait prendre le changement : faire
l’effort de cultiver les plantes et d’élever les animaux qu’ils
avaient autrefois cueillis ou chassés, ou d’abandonner la vie de
village et se divisant en petites bandes qui exploreraient la région
à la recherche de subsistances naturelles qu’ils n’avaient pas
sous la main. En fait, les Natoufiens semblent être allés dans les
deux directions. Certains ont utilisé leur connaissance des végétaux
et de la vie animale pour entreprendre de cultiver des plantes et
d’élever des troupeaux, pendant que d’autres revenaient au mode
de vie de leurs ancêtres nomades. Nous ne savons pas sur quelles
bases les groupes individuels ont fait leur choix, mais il est
probable que ceux qui ont opté pour l’agriculture l’ont fait en
acceptant une réorganisation de l’économie locale sous la
direction des individus prestigieux qui étaient auparavant
responsables de la centralisation et de la redistribution des
surplus.134
Une telle version explique pourquoi la transition
vers l’agriculture s’est produite, de façon indépendante,
simultanément dans beaucoup d’endroits différents de la planète.135
C’était le résultat de l’apparition de sociétés de
chasseurs-cueilleurs qui avaient eu tellement de succès dans leur
exploitation des ressources alimentaires locales qu’elles étaient
devenues trop grosses pour s’adapter lorsque, après des centaines
de milliers d’années, ces ressources se sont taries. A ce stade,
ils leur fallait changer ou périr.
Une fois la transition vers l’agriculture
accomplie dans un groupe régional, c’était quelque chose
d’irréversible. Les populations des sociétés pratiquant
l’agriculture commencèrent à croître bien plus vite que celles
qui dépendaient encore de la chasse et de la cueillette. Le surplus
que leur mode de vie sédentaire leur permettait d’accumuler
fournissait la base d’une spécialisation accrue dans la
fabrication d’objets, d’abord de pierre, puis de cuivre. Et,
parmi les objets nouveaux, on trouvait les armes qu’ils
fabriquaient et entassaient pour lutter les uns contre les autres –
des armes qui pouvaient aussi être utilisées pour déloger les
voisins chasseurs-cueilleurs des terrains les plus productifs. Les
nouvelles sociétés agricoles commencèrent à se répandre hors de
leur lieu d’origine, faisant souche dans de nouvelles régions,
conquérant ou convertissant les chasseurs-cueilleurs alentour.
Ainsi, par exemple, l’agriculture se répandit à partir des hautes
terres du Croissant fertile il y a 8 000 à 9 000 ans vers
les plaines de la région et l’Europe du sud-est il y a 7 000
ou 8 000 ans, puis vers le nord de l’Europe il y a 4 500
à 4 000 ans.136
La chasse-cueillette ne disparut pas partout. Des
niches écologiques bénéficiant d’une profusion de vie animale
sauvage se perpétuaient au milieu de régions agricoles, permettant
la survie, pendant des millénaires, de sociétés restées fidèles
à la chasse et à la cueillette. Et des groupes d’agriculteurs
trouvaient parfois commode de revenir à la chasse-cueillette en
investissant de nouvelles zones. Malgré tout, il ne faut pas se
dissimuler la tendance à la domination de régions entières par
l’agriculture, les chasseurs-cueilleurs restants étant relégués
dans les endroits qui ne convenaient pas à l’exploitation des sols
– les forêts, les déserts, les zones arctiques.
Les
premières sociétés de classe
Peu de sociétés agricoles se sont transformées
en sociétés de classe du fait de leur développement interne, même
si c’est ce qui s’est produit en Mésopotamie il y a 6 000
ans, en Egypte, en Iran, dans la vallée de l’Indus et en Chine
quelques siècles plus tard, dans la moyenne vallée du Nil (le
Soudan actuel) et la Méditerranée orientale un millier d’années
après, et en Amérique centrale, la région des Andes, les plateaux
éthiopiens et l’Afrique de l’ouest et du sud-est il y a entre
2 500 et 1 000 ans.137 Dans tous ces cas,
l’essentiel des pressions vers un nouvel ordre
social était généré de l’intérieur. Mais, dans la plupart des
autres parties du monde, des pressions externes ont été
nécessaires. Les vieilles sociétés purement horticoles ou
agricoles ont continué à persister jusqu’à ce que le commerce
extérieur, la défaite militaire ou la colonisation les poussent au
changement. Ceci est vrai, par exemple, de l’Europe du Nord il y a
entre 2 500 et 1 000 ans, et des hauts plateaux de Nouvelle
Guinée au début des années 1930.
Engels associait l’apparition de la société de
classe à l’agriculture intensive et au début de l’usage des
métaux. Gordon Childe acceptait la même vision, appelant le
processus de changement la « révolution urbaine » (bien
qu’il estimât, à l’inverse d’Engels, que cela avait pris des
milliers d’années après la première stabilisation de
l’agriculture dans la « révolution néolithique »).
D’une part, la croissance de la population
associée à l’agriculture primitive trouva finalement, dans chaque
lieu, ses limites dans la quantité de terre qui pouvait être
cultivée en utilisant les techniques existantes. « La
croissance de la population néolithique fut en fin de compte limitée
par une contradiction de la nouvelle économie ». Cela
encouragea un recours plus fréquent à la guerre, avec des « haches
de guerre en pierre et des poignards de silex », qui devint de
plus en plus répandue « dans les derniers stades de la
révolution néolithique en Europe ». D’autre part, le
village néolithique autarcique n’était jamais à l’abri d’une
catastrophe naturelle :
Tout son labeur et ses projets pouvaient
être frustrés par des évènements au-delà de son contrôle :
sécheresse ou inondations, tempêtes ou gelées, averses de grêle,
pouvaient annihiler les cultures et les troupeaux (...) Ses réserves
étaient trop petites pour lui permettre de faire face à une série
prolongée de désastres.
La révolution urbaine permettait d’échapper à
ces deux problèmes :
Les pires contradictions de l’économie
néolithique se trouvèrent transcendées lorsque les cultivateurs
furent persuadés ou contraints d’extraire du sol un surplus bien
plus important que leurs besoins domestiques et lorsque ce surplus
eût été mis à la disposition de nouvelles classes économiques
qui n’étaient pas engagées directement dans la production de leur
propre nourriture.
Mais ceci, à son tour, nécessitait une avancée
technique – « des additions au stock de la science » :
Les mille années environ qui ont précédé
3 000 avant notre ère ont été peut-être plus fertiles en
inventions et découvertes fructueuses que n’importe quelle période
de l’histoire humaine avant le 16ème siècle. Ses
réalisations ont rendu possible cette réorganisation économique de
la société que j’appelle la révolution urbaine.138
Les avancées technologiques incluaient la
découverte de la fonte du cuivre et de la façon de l’allier à
l’étain pour faire du bronze, l’utilisation de la charrue au
lieu de la houe et de la traction animale (des bœufs au début) pour
labourer la terre, l’emploi des premiers chariots à roues (ainsi
que des chars de guerre), la construction de canaux et de digues pour
l’irrigation, de nouvelles façons de construire les bateaux et de
naviguer.
Tous ces changements impliquaient ce que Childe
appelle « des modifications dans les rapports économiques et
sociaux » – des changements dans les relations mutuelles des
gens aussi bien que dans leur rapport à la nature. La fonte des
métaux était une fonction demandant bien plus d’adresse que la
poterie, et en vint à dépendre de groupes de spécialistes
hautement qualifiés qui se transmettaient les secrets du métier de
génération en génération. L’emploi de la charrue tendait à
accroître la division du travail entre les sexes dans la mesure où
c’était une tâche lourde, difficile à accomplir par des femmes
portant ou allaitant des enfants. Le creusement et la maintenance de
canaux permanents d’irrigation impliquait la coopération de
douzaines ou même de centaines de foyers, et encourageait une
division entre ceux qui supervisaient le travail et ceux qui
l’exécutaient.
L’utilisation de chariots à roues et
d’embarcations à voile permit le développement d’échanges
commerciaux entre groupes d’agriculteurs éloignés les uns des
autres – donnant aux gens un accès à des objets utiles qu’ils
ne pouvaient pas produire eux-mêmes. L’augmentation de la
productivité du travail du fait de ces changements permit à la
taille moyenne des exploitations de s’élever énormément, jusqu’à
ce que, dans certaines régions, les villages de la période
néolithique laissent la place à des cités. Et l’augmentation du
surplus résultant de l’accroissement de la productivité
fournissait un motif de plus aux préparatifs de guerre.
Gordon Childe décrit la transformation qui se
produisit en Mésopotamie, où des humains s’étaient installés
dans les vallées du Tigre et de l’Euphrate. Ils trouvèrent la
terre extrêmement fertile, mais elle ne pouvait être cultivée que
« par drainage et travaux d’irrigation » , dépendant
d’un « effort coopératif ».139 Une étude bien plus
récente de la Mésopotamie, celle de Maisels,
suggère que des gens qui avaient déjà appris l’agriculture sur
des terres irriguées naturellement trouvèrent, au quatrième
millénaire avant notre ère, « que les lits des rivières
coulaient entre des levées (des berges de boue) dans lesquelles il
suffisait de percer des brèches locales pour améliorer la
productivité des terrains environnantes ». Mais toute cette
production, ainsi accrue, n’était pas consommée immédiatement.
Une partie était mise en réserve :
Les surplus étaient utilisés pour
l’échange contre des produits pastoraux ou autres, en même temps
que des stocks supplémentaires devaient être constitués en
prévision d’années de sécheresse, d’invasions d’insectes, ou
de dommages saisonniers résultant par exemple des orages (...) De
telles réserves (...) signifiaient des méthodes permanentes
d’organisation de la production et de la consommation de telle
sorte qu’il existât toujours une marge de sécurité.140
Au cours de milliers d’années, les
exploitations agricoles basés sur les nouvelles méthodes
d’irrigation grossirent jusqu’à devenir des villes, et les
villes des métropoles. Le stockage des grains en vint à nécessiter
des constructions de grande taille qui, s’élevant au-dessus des
terres d’alentour, symbolisaient pour les gens la continuité et la
préservation de la vie sociale. Ceux qui supervisaient les silos
devinrent le groupe le plus prestigieux de la société. Très
rapidement, des temples apparurent, qui étaient surveillés par des
prêtres.141
Avec la formation d’un groupe permanent
d’administrateurs religieux, quelque chose d’autre, d’une
importance historique énorme, apparut : un système de signes
pour tenir les comptes de la richesse de la société, le premier
alphabet. Gordon Childe écrit :
Pour tenir la comptabilité des recettes
et des dépenses de la divinité, les corporations religieuses
administrant le domaine du temple mirent au point un système de
signes conventionnels – c’est à dire de l’écriture ; les
seuls documents écrits (jusqu’à 2 800 av. JC) sont des
tables de comptes. Ainsi l’accumulation d’un surplus social
substantiel dans les trésoreries des temples – ou plutôt des
silos – fut l’occasion de l’avancée culturelle que nous
considérons aujourd’hui comme le critère de la civilisation.
La divinité peut être considérée
comme le représentant ou la projection de la communauté, et les
prêtres qui la servaient étaient donc des serviteurs de la
communauté, même s’ils étaient sans doute mieux payés que les
autres membres du peuple de dieu.142
Au cours
des générations, la couche de prêtres devint de plus en plus
distincte du reste de la société, jusqu’à former une classe aux
intérêts particuliers. Gordon Childe décrit comment « des
prêtres en faveur pratiquaient diverses formes d’extorsion
(faisant payer très cher les enterrements, par exemple) et
traitaient les terres, les troupeaux et les servants de dieu (c’est
à dire de la communauté) comme leur propriété privée et leurs
esclaves personnels », et cite un édit de la ville Lagash
datant de 2 500 av JC :
Le grand-prêtre venait dans le jardin
des pauvres et y prenait du bois. Si la maison d’un grand homme
jouxtait celle d’un citoyen ordinaire, le premier pouvait annexer
l’humble demeure sans payer la moindre compensation à son
propriétaire.
« Ce texte archaïque », conclut-il,
« nous donne des aperçus incontestables d’un véritable
conflit de classe (...) Le surplus produit par la nouvelle économie
était, en fait, concentré entre les mains d’une classe
relativement petite ».143
En Mésopotamie, la première classe exploitée
n’était pas constituée d’esclaves faits prisonniers à la
guerre, comme le pensait Engels (ce qu’acceptait Gordon Childe
jusqu’à un certain point), mais des peuples « erin »,
des foyers paysans autrefois indépendants qui avaient été
contraints à dépendre de groupes plus puissants, en particulier les
temples, et qui étaient employés, pour des rations ou un salaire,
au creusement de canaux, à la culture des terres ou au service
militaire.144
L'exploitation s'étendit jusqu’à prendre des
proportions massives. T.B. Jones raconte comment, à Lagash vers
2 100 avant notre ère :
Une douzaine ou plus d’établissements
religieux étaient responsables de la mise en valeur de la plus
grande partie des terres arables. A peu près la moitié (de la
récolte) était consommée par le coût de production (salaires des
travailleurs, nourriture des animaux de trait, etc.) et un quart
allait au monarque comme impôt royal. Les 25 % restants
allaient aux prêtres.145
La pitance normale d’un travailleur ordinaire
était de trois silla (à peu près 2,4 litres) de grain par
jour, avec un supplément de bière et d’huile. Ce régime était
probablement déficient en protéines, minéraux et vitamines, mais
atteignait quand même 3 000 calories par jour, 1 000 de
plus que la plupart des gens dans l’Inde et l’Afrique
sub-saharienne d’aujourd’hui.146 On voit la merveille
qu’est le capitalisme comparé aux autres
sociétés de classe !
La Mésopotamie a sans doute été le premier
exemple – c’est en tous cas le plus étudié – de transition
vers la « civilisation ». Mais, comme nous l’avons vu,
ce n’était pas le seul. Les conditions qui ont mené aux premiers
éléments de vie urbaine et de division de classe étaient
présentes, nous l’avons vu, dans plusieurs parties du monde.
Engels, induit en erreur par les éléments de preuve disponibles à
son époque, les voyait comme ayant surgi de l’usage du fer par les
peuples sémitiques « pastoraux » et indo-européens
d’Eurasie. De plus, il y avait beaucoup plus d’exemples de
sociétés agricoles se développant jusqu’à un niveau où des
centaines ou même des milliers d’individus pouvaient être
mobilisés pour construire des édifices de pierre imposants –
comme les temples de pierre du 4ème millénaire qu’on
peut trouver à Malte, les cercles de pierre du 3ème
millénaire dont Stonehenge est l’exemple le plus connu, les
statues de l’île de Pâques du 18ème siècle, et les
plate-formes de Tahiti.147
Parfois le développement vers la
« civilisation »
a pu être influencé de l’extérieur.148 Mais cela ne change rien
au fait que les processus menant à la
formation des cités, et souvent à l’invention de l’écriture,
ont commencé indépendamment dans des lieux différents, du fait de
la dynamique interne de la société une fois que l’agriculture
s’était développée au-delà d’un certain point. Ce qui rend
particulièrement stupide toute tentative de proclamer qu’un groupe
de peuples du monde est « supérieur » aux autres parce
qu’il est arrivé à la « civilisation » le premier.
Dans de nombreux endroits, des peuples différents
sont arrivés à un point final identique, résumé par Gordon Childe
comme « l’agrégat de vastes populations dans les cités ;
la différenciation parmi ceux-ci en producteurs primaires (pêcheurs,
fermiers, etc.), artisans spécialisés à plein temps, marchands,
fonctionnaires, prêtres et dirigeants ; l’utilisation de
symboles conventionnels pour enregistrer et transmettre de
l’information (l’écriture), et des standards également
conventionnels de poids et de mesure du temps et de l’espace menant
à une forme de science mathématique et calendaire ».149
Mais le parcours exact de la chasse-cueillette à
la civilisation, en passant par l’horticulture et l’agriculture,
a varié considérablement d’une société à une autre.150
Des études relatives aux débuts de la
stratification au sein de sociétés agricoles
« communautaires »
contemporaines suggère que cela peut prendre différents chemins –
parfois les sages d’un lignage émergent comme chefs tribaux, par
fois les « grands hommes » deviennent les dirigeants d’un
village, ou des lignages entiers se transforment en castes de
prêtres, ou un foyer en vient à contrôler les autres. Certaines
sociétés de classe complètement formées semblent s’être
développées de la façon mentionnée par Engels, à travers la
croissance immédiate de la propriété privée de la terre, des
récoltes et des animaux. Mais dans d’autres, les preuves désignent
une classe dirigeante qui a commencé à exploiter le reste de la
société sans qu’il y ait de propriété privée – d’une façon
que Marx et Engels désignaient (de façon passablement erronée)
sous le nom de « mode asiatique de production ».151
Dans ces cas, l’exploitation de classe était dissimulée sous les
vieilles formes communautaires d’organisation sociale, plutôt que
d’apparaître au grand jour sous la forme de la propriété privée.
C’était, malgré tout, une exploitation de classe pure et simple,
la vieille organisation « communautaire » de la
production étant en réalité complètement transformée par le
paiement obligatoire de tributs aux prêtres exploiteurs ou aux
bureaucrates. Les chefs des organisations communautaires (que ce soit
des villages, des groupes de lignage ou des foyers étendus) ne
servaient plus uniquement leurs propres besoins, mais devenaient de
plus en plus les instruments par lesquels les exigences de la classe
dirigeante étaient imposées à leurs populations.152
Les formes différentes sous lesquelles la société
de classe a émergé ne doivent pas nous faire oublier les énormes
similitudes existant d’une société à une autre. Il y avait
partout, au début, un communisme primitif. Partout, une fois que des
sociétés fixes de cultivateurs s’étaient formées, certains
lignages, dirigeants de lignages ou « grands hommes » ont
pu commencer à gagner du prestige à travers leur rôle dans la
redistribution du petit surplus existant dans les intérêts du
groupe dans son ensemble. Partout, en même temps que le surplus
s’accroissait, cette petite section de la société en est venue à
contrôler une part plus grande de la richesse sociale, ce qui la
mettait dans une position où elle pouvait commencer à se
cristalliser en tant que classe sociale.
De plus, même lorsqu’elle se stabilisait comme
classe sociale collective, elle pouvait, sur des centaines d’années,
donner naissance à des classes de possédants privés. C’est
certainement ce qui s’est passé en Mésopotamie153 et dans l’Inde ancienne,
« où non seulement on trouve des
preuves de l’existence de la propriété privée, mais aussi (...)
le rôle de la propriété privée change de façon significative au
cours des siècles »154,
et peut-être à Teotihuacan en Amérique centrale.155
Même en Egypte, où le pouvoir de la monarchie était énorme, il
existait une tendance pour les temples et les gouverneurs de province
(« nomes ») locaux à développer leur propre pouvoir
économique à la fin de l’ancienne dynastie (vers 2 000 av
JC) , et, à l’époque ptolémaïque, une nouvelle caste de
guerriers possédait à peu près la moitié des terres156.
L’ex-marxiste germano-américain Wittfogel a essayé de développer
une théorie globale du « despotisme oriental »
applicable à toutes ces sociétés, dans laquelle le pouvoir
économique est complètement entre les mains d’une classe
dirigeante collective toute-puissante ; mais ses propres études
antérieures sur la Chine suggèrent une situation différente, dans
laquelle une bureaucratie d’Etat, les hobereaux locaux et les
marchands étaient tous engagés, au 5ème siècle avant
notre ère, dans d’âpres batailles pour la domination.
Comment
les classes sont apparues
Jusqu’ici nous avons vu comment s’est opérée
la transition des chasseurs-cueilleurs aux sociétés urbanisées,
avec, en parallèle, le passage du communisme primitif aux sociétés
de classe. Sur la réalité de cette transition il ne peut y avoir
aujourd’hui aucun doute. En soi, c’est une confirmation éclatante
de la justesse des vues d’Engels. Mais cela détruit aussi certains
des arguments antisocialistes les plus fondamentaux, selon lesquels
les humains sont par nature trop égoïstes pour qu’une communauté
fondée sur la coopération soit possible.
Reste un certain nombre de questions importantes
concernant les origines du pouvoir de classe et de l’Etat :
pourquoi les humains sont-ils passés de la chasse-cueillette à
l’agriculture, puis aux villes ? Pourquoi ont-ils accepté
l’établissement de classes dirigeantes ? Pourquoi ces
dirigeants en sont-ils venus à exploiter plutôt qu’à servir le
reste de la société ?
Ce sont
là des questions auxquelles Engels n’a pas répondu complètement.
Comme le fait remarquer Gailey, son explication, dans l’Origine,
semble parfois se limiter à blâmer la cupidité – certaines
personnes découvrirent qu’elles disposaient d’un surplus et
l’utilisèrent au détriment des autres.157 Dans l’Anti-Dühring
,
il développe davantage, mettant l’accent sur les avantages
initiaux apportés à la société par la mise de côté d’un
surplus destiné à n’être pas consommé immédiatement par les
producteurs. Malgré tout, il n’explique toujours pas pourquoi les
gens pourraient être motivés à le consommer eux-mêmes, ou
pourquoi les autres devraient accepter cela.158
Il y a un débat précisément sur cette question
chez les évolutionnistes académiques. E.R. Service a élaboré ce
qu’on pourrait appeler une théorie « fonctionnaliste »
de l’apparition de l’Etat (et, par suite, des classes). Les
dirigeants sont apparus parce que cela correspondait à l’intérêt
de tout le monde. « Ce développement réalisa les gigantesques
potentialités de la direction centralisée (...) » et fut le
résultat de « la simple tentative de dirigeants primitifs de
perpétuer leur domination sociale en organisant de tels bénéfices
pour leurs successeurs ».159 A l’inverse, Morton Fried
prétend que la formation de l’Etat ne
fut pas « fonctionnelle » pour toute la société, mais
faisait partie d’un processus par lequel une section de la société
exploitait et opprimait le reste.160
Mais cela n’explique pas pourquoi un groupe qui
n’avait jamais exploité ni opprimé devrait commencer à le faire,
ni pourquoi le reste de la société accepte ces exploitation et
oppression nouvelles.
La seule façon de répondre à cette question
réside dans l’importance accordée par Marx à l’interaction
entre le développement des rapports de production et les forces
productives.161
Les classes émergent des divisions qui s’opèrent dans la société
en même temps qu’apparaît une nouvelle manière d’assurer la
production. Un groupe découvre qu’il peut accroître la richesse
sociale totale s’il concentre les ressources entre ses propres
mains, organisant les autres pour qu’ils travaillent sous sa
direction. Il en vient à voir les intérêts de la société dans
son ensemble comme résidant dans son contrôle sur les ressources.
Il protège ce contrôle même lorsque cela apporte de la souffrance
aux autres. Il finit par considérer le progrès social comme
incorporé en lui-même et dans la protection de ses propres moyens
d’existence contre des accès de pénurie (dus à des mauvaises
récoltes, des parasites, la guerre, etc.) qui provoquent le malheur
de tous les autres.
Il n’est pas difficile de voir comment
l’extension de l’agriculture a mené à des pressions vers des
changements dans la production qui exigeaient une direction par en
haut. Les premières communautés de fermiers se sont probablement
établies dans des lieux où le sol était exceptionnellement
fertile. Mais lorsqu’elles se sont étendues, la survie vint à
dépendre de plus en plus des solutions apportées à des conditions
plus difficiles. Cela exigeait une réorganisation plus profonde des
rapports sociaux. Renfrew a écrit :
La population néolithique relativement
faible pouvait en fait sélectionner des sols tels que des zones
alluviales fertiles dont les potentialités était bien plus
importantes que les endroits mis plus tard en culture (...) Le fait
de s’installer dans des lieux où les récoltes étaient plus
vulnérables aux fluctuations dans les précipitations, par exemple,
approfondissait le besoin de mécanismes de redistribution qui
permettraient aux surplus locaux d’être utilisés pleinement.162
D.R. Harris a fait une observation similaire en ce
qui concerne l’agriculture tropicale en Afrique et en Asie du
sud-est. Au début elle était
d’échelle réduite et dépendait de la
manipulation de l’écosystème plutôt que de la création
d’écosystèmes artificiels par des transformations importantes
(...) Les techniques (...) étant normalement limitées au travail
humain employant des outils simples comme haches, couteaux, plantoirs
et houes. L’unité de travail était « la famille » et
il n’y avait nul besoin d’un niveau d’organisation sociale plus
complexe que celui de la simple tribu segmentaire.163
Mais l’agriculture qui produit davantage demande
aussi « des unités de travail plus grandes que la famille »
et un niveau « d’organisation sociale plus complexe »
qui est réalisé par l’intervention de « chefferies et
d’Etats stratifiés socialement avec une paysannerie dépendante ».164
Les groupes ayant acquis un prestige élevé dans
les sociétés sans classes précédentes se chargeaient de
l’organisation du travail nécessaire à l’expansion de la
production agricole en faisant des travaux d’irrigation ou en
défrichant de vastes étendues de terres nouvelles. Ils pouvaient en
venir à considérer leur propre contrôle du surplus – et en
utiliser une partie pour se protéger personnellement contre les
vicissitudes naturelles – comme étant conforme à l’intérêt
général. C’est ainsi que les premiers groupes utilisaient le
commerce à grande échelle pour accroître la variété des produits
de consommation disponibles. C’était également le cas pour les
groupes qui étaient les plus doués pour extorquer des surplus à
d’autres sociétés par le moyen de la guerre. De cette façon, le
progrès des forces productives dans chaque lieu transformait des
groupes et des individus qui jusque-là obtenaient du prestige en
remplissant des fonction redistributives ou cérémonielles en
classes qui imposaient leur exigence d’extraction du surplus au
reste de la société.
Dans de nombreuses parties du monde, des sociétés
ont été capables de prospérer jusqu’aux temps modernes sans
recourir aux méthodes de travail intensif comme l’usage de lourdes
charrues ou de travaux hydrauliques élaborés. C’est vrai d’une
grande partie de l’Amérique du Nord, des îles de l’océan
Pacifique, de la Papouasie-Nouvelle Guinée intérieure, et de
régions de l’Afrique et de l’Asie du sud-est. Mais sous d’autres
conditions la survie dépendait de l’adoption de nouvelles
techniques. Les classes dirigeantes ont émergé de l’organisation
de ces activités, de même que les villes, les Etats et ce que nous
appelons habituellement la civilisation. A partir de ce moment,
l’histoire de la société a certainement été l’histoire de la
lutte des classes.
Ces groupes ne pouvaient conserver le surplus
entre leurs mains, dans les moments où la société dans son
ensemble traversait de grandes épreuves, sans disposer d’un moyen
d’imposer leur volonté au reste de la société, sans avoir établi
des structures coercitives, des Etats, des codes de lois et des
idéologies pour les soutenir. Mais une fois que de telles structures
et idéologies étaient en place, elles perpétuaient le contrôle du
surplus par un certain groupe même lorsqu’il ne servait plus le
but de faire avancer la production. Une classe qui émergeait comme
force d’incitation à la production se maintenait même lorsqu’elle
avait perdu ce rôle. Et elle était protégée par une
superstructure militaire-judiciaire-idéologique qui constituait une
charge croissante sur la production de la société dans son
ensemble.
Ceci a été illustré de façon dramatique par
les premières grandes civilisations lorsque, après une période
plus ou moins longue, elles se sont effondrées dans des troubles
internes : les grandes crises de la société sumérienne au
début du second millénaire avant notre ère, la désintégration
temporaire de l’Egypte à la fin de l’ancienne dynastie aux
alentours de 1 800 av JC, l’effondrement des civilisations
crétoise et mycénienne dans la deuxième moitié du second
millénaire, celui de la civilisation de Teotihuacan, en Amérique
centrale, vers l’an 700 de notre ère. Cela a été démontré
régulièrement depuis, de la chute de l’Empire romain à la crise
actuelle du capitalisme mondial.
Le système de classe était alors, Marx et Engels
ont toujours insisté sur ce point, un développement nécessaire dès
lors que la société était confrontée à la pénurie. Mais, comme
ils l’ont aussi souligné, une fois qu’une classe s’était
installée au pouvoir, aller vers le progrès signifiait lutter
contre elle. Engels a écrit, à propos de la chute du communisme
primitif :
cette organisation était vouée à la
ruine (...) (elle) impliquait une production tout à fait
embryonnaire et, par suite, une population extrêmement clairsemée
sur un vaste territoire, donc un asservissement presque complet de
l’homme à la nature extérieure qui se dresse devant lui en
étrangère et qu’il ne comprend pas (...) La puissance de cette
communauté primitive devait être brisée (...) par des influences
qui nous apparaissent de prime abord comme une dégradation, comme
une chute originelle du haut de la candeur et de la moralité de la
vieille société (...) Ce sont les plus vils intérêts – rapacité
vulgaire, brutal appétit de jouissance, avarice sordide, pillage
égoïste de la propriété commune – qui inaugurent la nouvelle
société civilisée, la société de classes (...) Et la société
nouvelle elle-même (...) n’a jamais été autre chose que le
développement de la petite minorité aux frais de la grande majorité
des exploités et des opprimés, et c’est ce qu’elle est de nos
jours, plus que jamais.165
Nous ne pourrions pas retourner au communisme
primitif même si nous le voulions. Cela signifierait éliminer
99,9 % de l’humanité (la population de la France méridionale
il y a 30 000 ans était d'environ 400 personnes et celle du
monde entier il y a 10 000 ans d'environ 10 millions). Mais Marx
et Engels disaient avec insistance que ce n’était pas nécessaire.
Le capitalisme a créé tant de richesse que, pour la première fois
dans l’histoire humaine, il est possible de concevoir un communisme
non pas primitif mais « avancé ». De plus, si nous ne
prenons pas ce chemin, nous n’assisterons pas simplement à la
continuation de la société actuelle mais à une régression par
« la destruction mutuelle des classes en lutte ». Comme
le dit Engels à la fin de L’Origine de la famille, nous
atteignons « un stade de développement de la production dans
lequel l’existence de ces classes a non seulement cessé d’être
une nécessité, mais devient un obstacle positif à la
production ».166
III.
L’origine de l’oppression des femmes
L’origine de la famille n’était pas,
bien évidemment, seulement consacré à l’apparition des classes
et de l’Etat. Il traitait aussi des origines de l’oppression des
femmes. L’argument central est que les femmes n’étaient pas
subordonnées aux hommes avant l’apparition des classes, que « la
première opposition de classe qui se manifeste dans l’histoire
coïncide avec le développement de l’antagonisme entre l’homme
et la femme dans le mariage conjugal, et la première oppression de
classe, avec l’oppression du sexe féminin par le sexe masculin ».167
Sur ce point Engels avait incontestablement
raison. Les éléments de preuve, méticuleusement rassemblés par
Eleanor Leacock et d’autres, attestent qu’il n’y avait pas de
domination des hommes sur les femmes parmi les chasseurs-cueilleurs
nomades rencontrés par les explorateurs européens aux 17ème
et 19ème siècle.168 Il y avait une division du
travail entre hommes et femmes, les hommes
assumant la plus grande partie de la chasse et les femmes l’essentiel
de la cueillette. Mais dans la mesure où la cueillette procurait une
part plus importante de la ration alimentaire que la chasse, cela ne
menait pas nécessairement à une plus grande valorisation du travail
des hommes. L’anthropologue Ernestine Friedl reconnaît que dans
les rares sociétés, par exemple celle des aborigènes australiens,
où la viande était la composante essentielle de la ration, les
hommes étaient considérés comme supérieurs aux femmes.169
Mais, insiste-t-elle :
Les décisions individuelles sont
possibles pour les hommes comme pour les femmes en ce qui concerne
leurs activités quotidiennes (...) Les hommes comme les femmes sont
libres de décider comment ils vont passer leur journée : aller
chasser ou cueillir, et avec qui
Elle note que lorsque s’élève une discussion,
par exemple, sur la décision de lever le camp et de se déplacer
vers un nouveau territoire, les hommes et les femmes y prennent
part.170
Et les femmes exercent des pouvoirs énormes. Par exemple, chez les
aborigènes australiens, « les femmes âgées exercent une
influence sur leurs propres carrières maritales, et sur celles de
leurs fils et filles », et les femmes mariées ont souvent des
aventures avec des jeunes hommes célibataires – un état de choses
totalement opposé aux codes de conduite sexuelle de presque toutes
les sociétés de classe.171
Des anthropologues de l’école d’Eleanor
Leacock vont même plus loin. Ils rejettent les preuves, acceptées
par Friedl, censées établir le fait que les hommes ont un statut
plus élevé que les femmes, disant qu’elles ne font que refléter
les préjugés des observateurs occidentaux qui les ont rassemblées.172
Dans les sociétés basées sur l’horticulture,
les notions de la société de classe sur « la place des
femmes » sont également inconnues. Il y a parfois un début de
hiérarchie qui donne aux hommes une place plus élevée qu’aux
femmes, de la même manière qu’il peut exister une hiérarchie
entre lignages et foyers. Les hommes (ou certains hommes) peuvent
avoir plus de pouvoir de décision que les femmes. Mais il n’y a
pas d’oppression systématique des femmes. Les femmes conservent
leurs propres sphères de prise de décision, et peuvent s’opposer
à celles prises par leurs époux.
Il existe habituellement des structures qui
restreignent le choix du conjoint, et ceci a été interprété par
l’influente école d’anthropologie structuraliste, inspirée par
Claude Lévi-Strauss, comme signifiant que les femmes sont traitées
simplement comme des objets de négociation entre hommes. Mais, comme
Karen Sacks, Christine Gailey, Ernestine Friedl et autres l’ont
démontré, ce ne sont pas les hommes en tant que tels qui décident
qui pourra épouser qui, mais les lignages de parenté. Et les femmes
âgées de même que les hommes ont leur mot à dire dans ces
décisions.
C’est à l’évidence le cas des sociétés
décrites par les anthropologues comme « matrilinéaires »
ou « matrilocales ». Dans les sociétés matrilinéaires,
la descendance est établie dans la lignée féminine : les
liens les plus importants que peut avoir un individu ne sont pas avec
son père (qui appartient à un lignage différent) mais avec sa mère
et le frère de sa mère ; de la même façon, la première
responsabilité d’un homme n’est pas envers ses enfants
biologiques mais envers ceux de sa sœur. Dans les sociétés
matrilocales, un homme ne dirige pas le foyer lui-même, mais
s’installe dans un foyer dirigé par sa femme, les sœurs et la
mère de celle-ci.
Lorsque la société est à la fois matrilocale et
matrilinéaire, les hommes ont très peu d’autorité dans les
foyers dans lesquels ils vivent au quotidien. Les droits et
responsabilités formels d’un homme sont dans un autre foyer, qui
fait partie d’un autre lignage – celui de sa mère, de sa sœur
et des enfants de celle-ci. Là, ils jouissent d’une certaine
autorité – c’est la raison pour laquelle ces sociétés ne sont
pas des matriarcats, dirigés par des femmes. Mais leur absence de ce
foyer signifie qu’il s’agit d’une autorité limitée, pas plus
grande que celle des femmes.
Il est significatif que l’école structuraliste,
qui insiste sur le fait que les femmes sont partout l’objet
d’arrangements entre mâles, ne se réfère pratiquement jamais à
ces exemples.173
Toutes les sociétés matrilinéaires ne sont pas
matrilocales. Par exemple, chez les Ohaffia, un peuple ibo du Nigéria
oriental, la descendance est dans la lignée féminine, mais la
résidence du couple est chez les parents du mari. Mais même là,
les femmes ne sont pas subordonnées aux maris.174 Dans cette société,
« le divorce est habituellement accordé
à la demande de l’un des époux », « les filles sont
très appréciées », et « la relation (...) entre mari
et femme (...) semble être faite de respect mutuel et d’adaptation
l’un à l’autre ».175
Finalement, il y a des sociétés d’horticulteurs
dans lesquelles la descendance est dans la lignée masculine et la
résidence après le mariage est la famille du mari. Mais là encore,
les femmes ont beaucoup plus d’influence que ce qui est courant
dans les sociétés de classe. Celle-ci est exercée à travers les
lignages. Une épouse n’est pas juste une femme, une subordonnée
dans un foyer et un lignage étrangers. Elle est aussi une sœur,
quelqu’un qui a de l’influence sur les prises de décision dans
son propre lignage. Et les proches de son mari veulent maintenir de
bonnes relations avec ce lignage. Sa situation d’épouse donne aux
proches de son mari (y compris sa mère et sa sœur) un contrôle sur
sa productivité. Mais sa situation de sœur lui donne à son tour un
droit sur le produit de ses frères et de leur femme. Au cours de sa
vie, elle passera d’un état principal considéré comme
subordonné, comme « épouse » , à celui de « sœur »
et « mère ». Et en tant que telle elle est une
« contrôleuse » du « travail et des moyens de
production ».176
Ce n’est pas un monde de familles nucléaires
isolées dans lesquelles la femme individuelle est sujette aux
fantaisies de son partenaire. Ce n’est pas non plus un monde de
foyers patriarcaux dans lesquels les pères édictent la loi pour les
femmes, les enfants et les serviteurs. C’est un monde dans lequel
tout le monde, homme ou femme, est attaché à un réseau de droits
et de responsabilités mutuels qui varient d’un stade de la vie à
un autre, délimitant la liberté de chacun de diverses manières,
mais leur laissant plus d’autonomie que ce qu’on voit en général
dans les sociétés de classe.177
Le passage d’une femme d’un foyer (celui de
son père) à un autre (celui de son mari) est vu par les
structuralistes comme un « échange » de femmes entre
hommes. Mais la femme ne se déplace pas entre des hommes, mais entre
des lignages, chacun d’entre eux comportant des femmes. Sa position
est telle qu’elle est considérée comme une perte pour un foyer et
un gain pour un autre. Le père du mari devait souvent faire des
cadeaux au foyer parental pour compenser sa perte, une situation
typiquement différente de celle des sociétés qui accordent peu de
valeur aux femmes et où la famille d’une femme doit verser une dot
pour s’en débarrasser. Et en se mariant, la femme elle-même peut
obtenir « une amélioration de son statut individuel et de son
autonomie », comme le dit Gailey à propos des Tonga.178
Les structuralistes confondent les obligations
réciproques qui lient différents lignages dans les sociétés
antérieures aux classes avec l’échange de marchandises du
capitalisme, et ainsi se méprennent sur une situation dans laquelle
« les femmes vont et viennent en tant que personnes de valeur,
actives au sein des réseaux relationnels que créent leurs
mouvements », les réduisant à des marchandises virtuelles.179
La confusion est facilitée par l’intégration
des économies de presque tous les horticulteurs survivants à
l’économie mondiale et à l’usage de la monnaie.180 Le
besoin qu’ont les gens de monnaie pour acquérir des biens sur
le marché les amène à voir les vieilles relations d’obligations
réciproques de façon nouvelle, comme un moyen d’obtenir des
liquidités. C’est habituellement les hommes qui se relient
directement au marché hors du village et cela tend à leur donner un
pouvoir et un statut qu’ils n’avaient jamais eu. Le contact avec
le monde capitaliste amène les sociétés horticultrices à imiter
ses rapports sociaux – et les anthropologues occidentaux affirment
ensuite que les rapports sociaux typiques du capitalisme sont
universels dans toutes les sociétés.
Toute analyse scientifique des sociétés
agricoles primitives doit se détourner de telles distorsions.
Nous ne saurons peut-être jamais si la
descendance matrilinéaire a été autrefois universelle, comme le
suggère Eleanor Leacock, dans la mesure où nous n’avons aucun
moyen d’étudier en détail les sociétés sans écriture avant
l’impact de l’économie mondiale. Ce que l’on peut dire, malgré
tout, c’est qu’il n’y avait pas de situation universelle
d’oppression des femmes, et que celle-ci ne devint un aspect
systématique de la société qu’avec la division en classes et
l’apparition de l’Etat. De ce point de vue, Engels avait raison à
100 %.
Erreurs
mineures
Cela dit, Engels s’est trompé lourdement sur
une série de questions secondaires qu’il prenait tellement au
sérieux qu’on pourrait tirer des conclusions erronées de
L’origine de la famille si on ne le lisait pas de façon
critique.
Il fit sienne l’opinion de Morgan selon laquelle
les classifications de parenté qui existent dans les sociétés de
lignage (où, par exemple, toutes les femmes du lignage qui sont de
la même génération sont appelées « sœurs » , tous
les mâles de la génération des parents sont appelés
« oncles »,
etc.) remontent à une forme d’organisation sociale précédente
tout à fait différente.181 Le système de
classification des parents était, selon lui, un
« fossile social » permettant de déchiffrer l’histoire
de la famille. Il adopta aussi la conclusion de Morgan, selon
laquelle ces « fossiles » prouvaient qu’il avait existé
un stade de « mariage par groupe », où un groupe de
frères épousait un groupe de sœurs.182 Ceci, affirmait-il, était
caractéristique de « l’état
sauvage », alors que la « famille appariée » était
caractéristique de la barbarie.183
En fait, comme nous l’avons vu, la
chasse-cueillette nomade (« l’état sauvage ») n’est
pas caractérisée par des lignages forts, encore moins par des
mariages de groupe, mais par l’organisation flexible de couples et
de leurs enfants au sein de bandes.184 Engels voyait les
organisations de lignage comme des reliques d’une
époque où les relations sexuelles avaient un caractère de
« naïveté primitive ».185 En fait, elles étaient des
mécanismes complexes qui coordonnaient
la société dès lors que l’agriculture primitive avait permis la
formation de villages de centaines d’habitants – elles étaient,
en fait, une expression du développement des forces productives, et
non un vestige des vieux « rapports de production ».
Engels avait tort, non pas parce que sa méthodologie marxiste de
base était fausse, mais parce qu’il ne l’appliquait pas avec
suffisamment de rigueur.
Il avait également tort d’essayer de décrire
une forme encore plus ancienne de la famille, celle qu’il appelle
« une période de commerce sexuel sans entraves ». Il
affirmait qu’une telle étape avait du exister en même temps que
les primates ancestraux évoluaient vers l’humain, parce qu’elle
seule aurait pu empêcher la « jalousie du mâle » de
mettre en échec la coopération nécessaire pour faire face à la
nature. Pourtant, sa logique se brise une page plus loin, où il
note : « la jalousie est un sentiment qui s’est
développé relativement tard » – une conclusion que, nous
l’avons vu, la recherche sur les gorilles et les chimpanzés permet
de considérer comme correcte.186 Et sa conception de ce que
pouvait être le « commerce sexuel
sans entraves » manque de clarté, dans la mesure où à un
moment il suggère, et ce n’est pas très différent de ce que nous
appellerions aujourd’hui la « monogamie en série »,
que « des unions individuelles temporaires ne sont pas du tout
exclues ».187
En fait, Engels fait ici l’erreur de tomber dans
des spéculations aveugles au sujet d’une période très longue
(plus de 3 millions d’années) sur laquelle ni lui ni nous ne
savons grand-chose avec certitude. Nous ne savons pas si les primates
ancestraux étaient organisés en groupes centrés sur les mâles,
comme les chimpanzés communs, ou centrés sur les femelles comme les
bonobos, et nous ne savons certainement pas comment la forme
d’organisation caractéristique des chasseurs-cueilleurs nomades
modernes est apparue. Il est préférable de s’en tenir à ce que
nous savons – que les rapports entre hommes et femmes parmi les
chasseurs-cueilleurs survivants sont très différents de ceux que
l’on tient pour acquis dans les sociétés de classe et qui ont été
incorporés à la plupart des notions concernant la nature humaine.188
Il y a une autre erreur qu’Engels n’a pas
vraiment commise personnellement, mais qui lui est souvent attribuée
à la fois par ses partisans et ses opposants. Il s’agit de
l’utilisation du terme « matriarcat » d’une façon
qui implique une période de règne féminin antérieur à la
domination masculine. Ceux qui l’emploient supposent qu’il y a
toujours eu quelque chose de proche de la domination de classe et de
l’Etat, mais qu’à une époque c’était les femmes qui
l’exerçaient et non les hommes. Engels a rejeté explicitement
cette notion. Il a repris le terme « droit maternel » de
l’écrivain allemand Bachofen pour décrire la filiation féminine
qui, croyait-il, était universelle à une époque. Mais il ajoute :
« je garde cette dénomination pour sa brièveté ; mais
elle est impropre, car à ce stade de la société il n’est pas
encore question de « droit » au sens juridique du mot ».189 Il
est clair que la caractéristique à la fois des
chasseurs-cueilleurs et des sociétés d’agriculteurs primitifs est
le fait qu’aussi bien les hommes que les femmes prennent part aux
prises de décision, et non que les un-es exclut les autres.
L’argumentation
d’Engels revisitée
Engels est à son zénith lorsqu’il décrit
l’apparition de l’oppression des femmes, « la défaite
historique mondiale du sexe féminin », comme il l’appelle,
et qu’il la relie à la montée de la société de classe. Mais
parfois son argumentation est en défaut lorsqu’il essaie de
démonter les mécanismes à l’œuvre derrière cette défaite. Il
ne montre pas pourquoi ce sont nécessairement les hommes qui
dominent la nouvelle société de classe. Il dit que les hommes étant
venus à produire à la fois la nourriture et les outils de
production, cela leur a nécessairement donné des droits de
propriété et un contrôle sur le surplus190,
et qu’ils voulaient transmettre la propriété à leurs fils et non
aux parents de leurs femmes. Mais il ne montre pas pourquoi ils ont
subitement ce désir après des milliers d’années durant
lesquelles leurs relations les plus proches étaient avec les enfants
de leurs sœurs.191
Deux séries de tentatives ont été faites pour combler les lacunes
de son argumentation.
D’abord, il y a la version de ceux, comme
Eleanor Leacock et Christine Gailey, qui ont mis l’accent sur
l’impact de l’apparition de l’Etat dans la destruction des
anciens lignages au sein desquels les femmes exerçaient une
influence. L’Etat subordonne la société à la classe dirigeante
nouvelle. Mais cela signifie détruire « l’autonomie et
l’autorité relatives » des vieilles communautés de parenté.
La seule façon dont celles-ci peuvent survivre est de servir de
courroies de transmission aux exigences de l’Etat et de la classe
dirigeante envers la masse du peuple. Et cela implique de prendre des
décisions non seulement productives mais reproductives à l’écart
des membres de ces communautés. Les femmes, en tant que
reproductrices biologiques, sont les perdantes.192
Mais cette hypothèse n’explique pas davantage
que celle d’Engels pourquoi les femmes n’auraient pu avoir une
part égale du pouvoir et exercer une influence en même temps que
les hommes de la nouvelle classe dominante et de l’Etat – ni
pourquoi les femmes devraient, comme c’est généralement le cas,
être réduites à un rôle subordonné dans la classe exploitée.
Cela explique l’effondrement de l’ordre ancien, mais pas la
hiérarchie sexuelle qui règne dans le nouveau.
Une thèse alternative, présentée de différentes
façons par Gordon Childe et Ernestine Friedl, se penche sur la
fonction productive des femmes et sur le rôle joué par la biologie
à différents moments du développement historique.
Childe fait remarquer qu’aux débuts de la
période néolithique les femmes jouaient un rôle majeur dans la
production. Il y avait une division du travail, dans laquelle les
hommes s’occupaient des troupeaux. Mais la clé de la révolution
néolithique, affirme-t-il, était :
la découverte de plantes adaptées et de
méthodes pour leur culture, la mise au point d’outillages divers
pour labourer la terre, récolter et stocker les moissons, ainsi que
leur conversion en aliments (...) Toutes ces inventions et
découvertes furent, d’après les éléments de preuve
ethnographiques, l’œuvre des femmes. On peut également mettre à
l’actif de ce sexe la chimie de la poterie, les méthodes de
filage, la mécanique du tissage et la botanique du lin et du coton.193
Et, « du fait de la contribution des femmes
dans l’économie collective, la filiation est établie dans la
lignée féminine et le système du « droit maternel »
domine ».194
Tout ceci devait changer avec le remplacement de
la houe et du plantoir par la charrue comme instrument agricole
essentiel. La constitution des stocks était déjà une sphère
masculine, et la charrue y ajouta le labourage, réduisant
considérablement la place des femmes dans la production :
La charrue (...) a soulagé les femmes
d’une corvée épuisante mais les a privées de leur monopole sur
les récoltes céréalières et du statut social qu’il leur
conférait. Chez les barbares, alors que normalement les femmes
retournent la terre à la houe, ce sont les hommes qui labourent. Et
même dans les plus anciens documents sumériens et égyptiens les
laboureurs sont des hommes.195
Ernestine Friedl affirme que la position relative
des hommes et des femmes dans les sociétés horticoles dépend de
leur contribution à la production. Il y a, par exemple, des sociétés
horticoles dans lesquelles les femmes produisent les cultures de base
et les hommes celles qui peuvent être échangées, et d’autres
dans lesquelles les rôles sont inversés.196 C’est dans la première
catégorie que les hommes ont le statut le
plus élevé. « Le cas de domination masculine est le résultat
de la fréquence avec laquelle les hommes ont des droits plus
importants que les femmes pour distribuer des biens en dehors du
groupe domestique ».197
Elle signale que certaines activités tendent,
dans la plupart des sociétés, a être exercées plutôt par les
hommes que par les femmes. Dans certaines sociétés de
chasseurs-cueilleurs les femmes chassent, mais « sont exclues
de la chasse dans les derniers stades de la grossesse (...) (et)
après la naissance par la charge du transport de l’enfant ».198
Dans les sociétés agricoles primitives, les métiers peuvent être
exercés par un sexe ou l’autre, mais « le travail du métal
est presque entièrement une activité masculine ».199 Et
dans la plupart des sociétés – mais pas toutes – les hommes
sont les seuls guerriers.
Une interaction entre les impératifs biologiques
et les besoins sociaux sous-tend ces changements dans la division du
travail. L’espèce humaine doit se reproduire pour que la société
survive. Mais l’échelle de sa reproduction – combien chaque
femme doit mettre au monde d’enfants – varie énormément. Dans
les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, comme nous l’avons
vu, il y a une priorité à l’espacement des naissances pour
qu’aucune femme n’ait à s’occuper de plus d’un enfant à la
fois. A l’inverse, dans les sociétés agricoles, chaque enfant
est, potentiellement, un cultivateur de plus, et il y a le besoin de
compenser une mortalité plus élevée, résultat d’une plus grande
vulnérabilité aux maladies infectieuses, et des ravages de guerres
incessantes.200
Ainsi, plus le taux de natalité est élevé, plus grandes sont les
chances de succès de cette société. C’est de l’intérêt de la
société dans son ensemble (y compris des femmes) que les femmes ne
participent pas aux activités (comme la guerre, les longs voyages et
les tâches agricoles lourdes) qui les exposeraient à des risques de
mort, de stérilité ou d’avortement – ou qui exposent au danger
les enfants dépendants du lait de leur mère.
Cela expliquerait pourquoi les femmes produisent
la plus grande partie de la nourriture dans les sociétés qui
utilisent la houe et le plantoir, mais pas dans celles qui emploient
la charrue et élèvent des troupeaux. La première catégorie
d’activités nécessite un travail dur et fatigant, mais ne risque
pas de mettre en péril le taux de natalité comme dans la deuxième
catégorie. Les femmes de cette dernière ont une plus grande valeur
pour le village, le lignage ou le foyer domestique en ce qui concerne
la reproduction que les hommes – et donc sont éloignées des
activités qui pourraient les mettre en danger, elles ou leur
potentiel reproductif.
Le résultat est que les femmes ont un rôle
central dans la production, aussi bien que dans la reproduction, dans
les sociétés de chasseurs-cueilleurs et d’agriculture primitive.
Mais elles sont exclues des productions qui dégagent le plus grand
surplus avec l’arrivée de l’agriculture lourde, la révolution
urbaine, et le passage d’une société « communautaire »
ou « d’association de parenté » à la société
divisée en classes.
Mais le mettre au compte de la charrue et de
l’élevage n’est pas suffisant, puisque des classes sont apparues
dans le Nouveau Monde un millénaire et demi avant que la conquête
européenne n’introduise la charrue.201 Malgré tout, il y avait eu
un tournant vers une espèce différente
d’agriculture intensive avec la première mise en œuvre de réseaux
d’irrigation. Et il y avait eu une augmentation des autres
activités dont les femmes sont habituellement exclues par leur rôle
reproductif – le commerce sur de longues distances et la guerre.
Toutes ces activités accroissaient le surplus disponible d’une
société particulière. Toutes tendaient à être accomplies par les
hommes plutôt que par les femmes. Et toutes encourageaient la
transformation des groupes tenus en haute estime en une classe
dominante.
La plupart des hommes qui portaient la charge de
ces nouvelles activités productives n’étaient pas intégrés à
la classe dominante. Tous les laboureurs ne devenaient pas des
princes et tous les combattants des seigneurs de la guerre, et ni les
uns ni les autres ne constituaient le clergé qui formait souvent la
première classe dirigeante, et qui ne participait jamais à aucun
travail d’aucune sorte. Mais les nouvelles formes de production
encourageaient la rupture avec les vieilles formes communautaires
d’organisation basées sur le lignage, ce qui, selon Gailey et
Leacock, est l’élément déterminant.
Aussi longtemps que la production de nourriture
était assurée par les femmes, cela avait un sens pour tout le monde
que la terre et les autres moyens de production soient sous le
contrôle de lignages féminins. Cela garantissait la continuité de
la culture à travers les générations. Une femme, ses sœurs et
leurs époux pouvaient s’attendre à ce que leurs filles cultivent
la terre du lignage et les prennent eux-mêmes en charge dans leurs
vieux jours. Le fait que la terre ne passait pas au fils n’avait
aucune importance pour le père ou pour la mère, puisqu’il ne
serait pas responsable de la charge principale de la production de
denrées alimentaires.
Dès que les producteurs principaux de nourriture
devinrent les hommes, la situation changea. Un couple était
désormais dépendant de la production de la génération suivante de
mâles pour le temps où ils ne seraient plus capables physiquement
de s’occuper d’eux-mêmes. La survie de tout foyer était bien
plus subordonnée à la relation entre les mâles d’une génération
à l’autre qu’entre les femmes. S’appuyer sur les fils des
sœurs du père, qui travaillaient elles-mêmes sur des terres
contrôlées par d’autres lignages (ceux de leurs femmes), était
beaucoup moins sûr que de tenter de garder les fils du couple au
sein du foyer parental. La patrilinéarité et la patrilocalité
commencèrent à convenir, beaucoup mieux que la matrilinéarité et
la matrilocalité, à la logique de la production.
Le remplacement de l’agriculture sur brûlis par
la mise en valeur continue des mêmes terres encouragea ce
développement. Il nécessitait des mesures pour améliorer les sols
sur plus d’une génération, des mesures qui seraient prises
essentiellement par les hommes et seraient donc encouragées par un
accent nouveau mis sur les relations entre générations successives
de cultivateurs mâles, attachés au même lopin de terre.
Finalement, l’apparition des classes et de
l’Etat aux dépens des lignages encouragea la domination masculine
dans les classes inférieures une fois que les hommes furent les
principaux producteurs du surplus. C’est sur eux que les autorités
émergentes plaçaient la responsabilité de livrer une partie de la
récolte. Et c’est alors qu’ils imposèrent ces exigences sur le
foyer domestique dans sa totalité, commençant à diriger son
travail et contrôler sa consommation.
Les
classes, l’Etat et l’oppression des femmes
Le fait de savoir si oui ou non les relations
matrilinéaires-matrilocales étaient à l’origine universelles
importe peu dans ce schéma. Car même si elles n’avaient existé
que dans une minorité de cas, elles étaient remplacées presque
partout, dès que l’agriculture se fut développée au delà d’un
certain point, par des relations patrilinéaires. Et le développement
des classes et de l’Etat, à son tour, commençait à transformer
la patrilinéarité – la descendance par la ligne mâle, agrémentée
d’un réseau complexe de relations parentales – en patriarcat, la
domination du foyer par l’homme le plus âgé.
Mais le développement des classes et de l’Etat
ne s’est pas fait du jour au lendemain. C’est un processus étalé
sur des centaines, voire des milliers d’années. Ceux qui
constituèrent les premières classes dirigeantes étaient ceux dont
les ancêtres avaient acquis un statut élevé dans les sociétés
sans classes antérieures en concentrant entre leurs mains les
ressources, même si c’étaient des ressources à redistribuer au
reste de la société. Et comme ces sociétés avaient déjà
commencé leur transition vers la patrilinéarité, elles tendaient à
être masculines.
Ce ne fut pas un moment unique de transition, mais
un processus long, se développant de manière dialectique. Le
passage à la patrilinéarité encourageait l’émergence des hommes
comme les éléments essentiels du contrôle des ressources de la
société. Cela, à son tour, encourageait l’émergence du
patriarcat dans les unités domestiques. Et le patriarcat dans le
foyer encourageait alors la domination des mâles dans la classe
dirigeante et dans l’Etat. Ceux-ci commençaient à transformer
l’ancien contrôle des lignages sur les arrangements matrimoniaux à
leur propre avantage, de telle manière que les intermariages entre
lignages qui avaient autrefois assuré la cohésion de sociétés
entières par des liens de réciprocité furent transformés
consciemment en un « échange de femmes » destiné à
accroître le flux des ressources entre les mains de la lignée mâle
dominante.
Les femmes, qui avaient eu un rôle central dans
la production aussi bien que dans la reproduction, furent dès lors
soumises aux hommes à tous les niveaux de la société. Dans les
classes exploitées, elles continuaient à travailler. Mais même
dans les cas fréquents où elles produisaient plus que les hommes de
façon globale, elles ne produisaient ni ne contrôlaient les surplus
qui déterminaient la relation du foyer avec le reste de la société,
et restaient donc subordonnées aux hommes (ou, plus précisément, à
l’homme qui régnait à la fois sur les femmes et les jeunes hommes
dans le foyer patriarcal paysan ou artisan). Les seules exceptions
étaient les cas dans lesquels l’absence de l’homme du foyer
(comme dans les communautés de pêcheurs ou certains groupes
d’artisans dans lesquels le mari était mort prématurément) ou la
participation des femmes à certaines formes de commerce (comme dans
certaines parties de l’Afrique de l’ouest) leur donnaient un
contrôle sur le surplus. La femme, dans ces cas, devenait une espèce
de patriarche femelle. Mais c’était nécessairement l’exception
et non la règle. Et, bien sûr, dans les cas où la production était
basée sur le travail collectif des esclaves, il n’y avait ni foyer
ni domination masculine à la base de la société.
Dans les classes dominantes, les femmes connurent
une forme différente d’oppression. Elles devinrent des pions dans
les manœuvres entre différents dirigeants, utilisées pour
accroître le statut de l’un aux dépens d’un autre. Et même si
elles participaient à l’exploitation du reste de la société,
elles étaient rarement les égales des hommes de la classe
dirigeante, créant des évènements de leur propre chef. Dans des
cas extrêmes, elles étaient confinées à un monde fermé, le
purdah ou le harem, dans lequel la seule espèce de participation au
monde qu’elles pouvaient espérer était de nature éloignée, par
la manipulation de l’affection d’un mari ou d’un fils. Là
encore, il y avait des exceptions occasionnelles, comme une reine ou
une douairière qui prenait le pouvoir totalement entre ses mains.
Mais, une fois de plus, l’exception ne devint jamais la règle.
Ainsi, Engels peut s’être trompé dans son
explication de certains processus à l’œuvre dans l’apparition
de la famille patriarcale, mais il avait raison d’insister sur sa
nouveauté historique, et de la considérer comme « la grande
défaite historique du sexe féminin » , non pas simplement une
« révolution », mais « une des plus radicales
qu’ait jamais connues l’humanité ». Il avait également
raison d’ajouter qu’elle « n’eut pas besoin de toucher à
un seul des membres vivants » de la société.
La transformation de la réalité du haut en bas
de la société se refléta nécessairement dans la transformation de
l’idéologie. On trouve parmi les vestiges des sociétés
préhistoriques de la période du néolithique supérieur une
abondance de statuettes féminines, suggérant le culte de déesses,
alors que les sculptures phalliques sont inexistantes.202
Une fois que les sociétés de classe se développent, de plus en
plus d’importance est accordée au rôle des dieux, les grandes
religions qui ont dominé, depuis le 5ème siècle av. JC,
la plus grande partie de l’Eurasie étant caractérisées par
l’omnipotence d’un dieu mâle unique. Dirigeants et dirigés
adoptèrent une idéologie de domination masculine, même si des
figures féminines se voyaient parfois accorder un rôle secondaire.
Engels insistait aussi sur autre chose. Le
développement plus avancé des moyens de production apporta des
modifications subséquentes dans la forme de la famille et le
caractère de l’oppression des femmes. Ceci, affirmait-il, était
le résultat du remplacement de l’ancien mode de production servile
par la féodalité, qui, selon lui, fut accompagnée par le
remplacement du « foyer patriarcal » par la « famille
monogamique ». « La nouvelle monogamie (...) revêtit la
suprématie masculine de formes plus douces et laissa aux femmes une
position beaucoup plus considérée et plus libre, du moins en
apparence, que ne l’avait jamais connue l’antiquité
classique ».203
Les détails du changement ne nous concernent pas
ici. Ce qui est important dans l’investigation d’Engels, c’est
qu’il y a eu des variations, même à l’intérieur de la société
de classe, dans la nature de la famille et le caractère de
l’oppression des femmes. Le processus dans son ensemble ne saurait
être fondu dans la catégorie unique du « patriarcat »,
comme beaucoup de féministes modernes ont tenté de le faire. Il y a
toujours eu d’énormes différences entre les familles de la classe
exploiteuse et celles des classes exploitées : on ne peut
simplement mettre le signe égale entre la famille du propriétaire
d’esclaves romain et la famille de l’esclave romain, ni entre la
famille du seigneur féodal et celle du paysan, serf ou vilain. Et il
y a toujours des différences considérables dans la famille
lorsqu’on passe d’une classe dirigeante à une autre. Une société
dans laquelle les femmes de la classe dirigeante jouent un rôle
public mais subordonné – comme dans l’Europe féodale vue par
Chaucer ou Boccace – est différente à de nombreux égards de
celle où elles vivent dans le purdah. Une société dans laquelle on
trouve la dot apportée par l'époux est différente de celle dans
laquelle c'est l'épouse qui l'apporte. Cela ne veut pas dire qu’on
ignore l’oppression des femmes dans chaque cas, mais qu’on
insiste sur les changements qu’elle subit – une condition
essentielle pour reconnaître qu’elle n’est pas une expression
particulière de la nature humaine, mais le produit de développements
historiques concrets, qui peut être éliminé par d’autres
développements.
L’un des passages les plus importants de
L’origine de la famille s’emploie à souligner ces
développements. Engels signale que même sous le capitalisme les
femmes de la classe ouvrière intègrent la force de travail, et
ainsi obtiennent des revenus personnels – à une échelle inconnue
de toutes les précédentes sociétés de classe :
depuis que la grande industrie, arrachant
la femme à la maison, l’a envoyée sur le marché du travail et
dans la fabrique, et qu’elle en fait assez souvent le soutien de la
famille, toute base a été enlevée, dans la maison du prolétaire,
à l’ultime vestige de la suprématie masculine – sauf, peut-être
encore, un reste de la brutalité envers les femmes qui est entrée
dans les mœurs avec l’introduction de la monogamie. Ainsi, la
famille du prolétaire n’est plus monogamique au sens strict du
terme, même s’il y a, de part et d’autre, l’amour le plus
passionné et la fidélité la plus absolue (...) la femme a
effectivement reconquis le droit au divorce, et, si l’on ne peut
pas se souffrir, on préfère se séparer.204
Mais si l’entrée de la femme dans la main
d’œuvre salariée lui offre un potentiel de libération,
l’organisation permanente de la reproduction au sein de la famille
individuelle empêche la réalisation de ce potentiel :
la femme, si elle remplit ses devoirs au
service privé de sa famille, reste exclue de la production sociale
et ne peut rien gagner ; et que, par ailleurs, si elle veut
participer à l’industrie publique et gagner pour son propre
compte, elle est hors d’état d’accomplir ses devoirs familiaux.205
Ainsi, les femmes sont, dans la société
existante, dans une situation contradictoire. Elles peuvent voir la
possibilité d’une entière égalité et par conséquent remettre
en cause la domination masculine avec une confiance sans précédent
depuis la destruction de la production communautaire. Mais elles sont
toujours empêchées de réaliser cette égalité, à moins qu’elles
ne renoncent à avoir des enfants. Aucune législation ne peut
surmonter cette contradiction douloureuse, bien que, et Engels
insistait là dessus, toute législation était la bienvenue dans la
mesure où elle mettrait en évidence le besoin d’un nouveau
changement, révolutionnaire celui-là :
On verra alors que l’affranchissement
de la femme a pour condition première la rentrée de tout le sexe
féminin dans l’industrie publique et que cette condition exige à
son tour la suppression de la famille conjugale en tant qu’unité
économique de la société (...)
Les moyens de production passant à la
propriété commune, la famille conjugale cesse d’être l’unité
économique de la société. L’économie domestique privée se
transforme en une industrie sociale. L’entretien et l’éducation
des enfants deviennent une affaire publique.206
Cela transformera complètement les rapports entre
les sexes. Une fois débarrassés de l’obsession de la reproduction
et des droits de propriété, proclame Engels, les êtres seront
libres de se relier entre eux dans des formes nouvelles,
authentiquement libres. Nous ne pouvons que « conjecturer »
sur ce à quoi ressembleront les nouvelles relations :
Cela se décidera quand aura grandi une
génération nouvelle (...) Quand ces gens-là existeront, du diable
s’ils se soucieront de ce qu’on pense aujourd’hui qu’ils
devraient faire ; ils se forgeront à eux-mêmes leur propre
pratique et créeront l’opinion publique adéquate selon laquelle
ils jugeront le comportement de chacun – un point, c’est tout.207
Si d’autres sections de L’origine de la
famille souffrent de l’utilisation d’un matériel périmé,
et, à l’occasion, d’une argumentation circulaire, ces passages
brillent par leur modernité. Engels était, en fait, très en avance
sur son temps lorsqu’il les a écrits. Comme l’ont écrit Lindsey
German et d’autres, après avoir virtuellement aboli la famille
ouvrière dans les premiers stades de la révolution industrielle, le
capitalisme a cherché à imposer une forme de la famille bourgeoise
dans la seconde moitié du 19ème siècle comme le seul
moyen d’assurer la socialisation de la prochaine génération de
travailleurs.208
D’où les tentatives d’utiliser la loi et les sermons religieux
pour limiter l’entrée des femmes dans la force de travail. Depuis
la 2ème Guerre mondiale, cependant, la tendance effrénée
à l’accumulation du capital a partout brisé ces restrictions, de
telle sorte que même dans des pays dominés par la morale catholique
ou les codes musulmans, la proportion des femmes dans la force de
travail n’a cessé de croître, au point que dans certains endroits
les femmes sont aujourd’hui la majorité de la classe ouvrière
employée.
Pourtant, la reproduction demeure privée, même
si l’Etat est obligé de jouer un rôle bien plus important qu’à
l’époque d’Engels dans la mise en place de services sociaux et
d’éducation. La plupart des femmes sont salariées et ont des
attentes d’indépendance comme jamais auparavant, mais se trouvent
contraintes de battre en retraite dans le cadre exigu de la famille
nucléaire pour porter la charge du soin des enfants. C’est de
cette situation qu’est issue une résistance, aussi bien chez les
hommes que chez les femmes, à beaucoup de choses qu’on considérait
comme normales dans le passé – un salaire inégal, le traitement
du corps des femmes comme une marchandise, la violence domestique,
les mariages décevants ou désespérants. C’est une résistance
qui porte haut partout la vision d’une vie meilleure pour tous,
mais dans une société qui empêche cette vision de devenir une
réalité.
Conclusion
Peu d’écrits scientifiques centenaires
continuent à inspirer une recherche contemporaine. Cela n’est pas
surprenant, étant donné l’explosion d’axes de recherche, de
connaissances et de théories qui ont accompagné l’accumulation
frénétique du capital. Le rôle joué par le travail dans la
transformation du singe en homme et L’origine de la famille, de la
propriété et de l’Etat étaient des tentatives à la fois de
développer et de populariser les investigations scientifiques de
leur temps. C’est à mettre à l’immense crédit d’Engels et de
la méthode que Marx et lui ont développée au milieu des années
1840 que nous puissions y puiser les éléments qui sont absents de
tant d’écrits contemporains consacrés à l’évolution de notre
espèce et de la société. Ils contiennent beaucoup de choses qui
doivent être rejetées ou réévaluées sur la base des progrès
accomplis par la science depuis la mort d’Engels. Mais ce qui
demeure est d’une valeur inestimable. Cela forme un point de départ
sans égal pour quelqu’un qui veut s’orienter dans la masse du
matériel empirique produit quasi quotidiennement par les
archéologues et les anthropologues. C’est ainsi qu’il nous aide
aujourd’hui à réfuter l’absurdité des théories
« sociobiologiques » ou du type « singe nu »
lorsqu’elles proclament que le capitalisme est inévitable parce
qu’il repose sur les fondations d’une « nature humaine »
permanente.