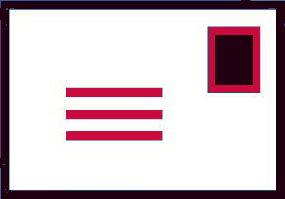Une
certitude sous-tendait les réactions des libéraux et des
sociaux-démocrates tout au long des turbulences des années
révolutionnaires. Ils étaient convaincus qu’après la crue le
fleuve de l’histoire retournerait dans son lit tranquille, pour une
éternité de béatitude social-démocrate – à condition qu'ils
puissent isoler et détruire les forces révolutionnaires. S’ils
contrôlaient le présent, ils pouvaient garantir l’avenir. C’est
la même conjecture qui permet aujourd’hui aux sociaux-démocrates
de conserver leur optimisme autosatisfait alors que la crise mondiale
fait rage alentour.
Dans
l’Europe des années 1920, une telle représentation reposait sur
des illusions de la plus incroyable magnitude. Elle considérait la
Première Guerre mondiale comme un accident de l’histoire que des
hommes de bonne volonté auraient pu éviter, et les forces
économiques liées à la guerre comme pouvant être pacifiquement
contrôlées dans une nouvelle ère de prospérité.
Il
est vrai que pendant les cinq années qui suivirent 1923 l’Europe
et l’Amérique jouirent d’un retour apparent de l’idylle
d’avant-guerre d’expansion économique et de taux de profit
élevés. Mais 1929 apporta des secousses économiques dont les
effets furent aussi terrifiants que les convulsions militaires de
1914. Les démons qu’on avait cru conjurés en 1923 réapparurent,
en même temps que, par millions, les gens ordinaires se retournaient
contre les sociaux-démocrates et les libéraux qui avaient tant
promis et si peu tenu.
La
troisième grande crise de l’Allemagne d’après-guerre prouva que
ceux qui, pendant les deux premières crises de 1918-20 et 1923,
avaient préservé l’ordre ancien n’avaient pas rendu service à
l’humanité.
Le
symptôme le plus évident était le retour en force du nazisme, et à
un niveau bien plus important qu’en 1923. En 1928, le parti de
Hitler ne recueillait que 2,6 % du vote populaire. En 1930, il
avait bondi à 18,3 %, doublant encore pour atteindre
37,3 %
en juillet 1932. Mais les élections n’étaient pas le seul terrain
de sa croissance : les effectifs des sections d’assaut passa
de 100 000 en 1930 à 400 000 en 1932.
Hitler
n’aurait jamais pu prendre le pouvoir s’il ne s’était appuyé
que sur les sections d’assaut. Il avait aussi besoin de la
collaboration active des forces qui, dans la société allemande,
s’étaient vu accorder un nouveau bail par les gouvernements
sociaux-démocrates de novembre-décembre 1918 et d’avril 1920 –
les généraux, les hauts fonctionnaires, les grands industriels et
les intérêts fonciers. Ces derniers avaient dominé tous les
gouvernements depuis 1923, avec un bref interlude social-démocrate
en 1928-30. En 1930-33 leurs fondés de pouvoir, Brüning, Papen et
Schleicher, étaient à la Chancellerie, gouvernant par décrets,
avec d’occasionnels recours au parlement.
Les
généraux et les industriels devaient toujours, cependant,
s’accommoder d’un puissant mouvement ouvrier dirigé par les
sociaux-démocrates. Pour conserver un minimum de bonne volonté de
la part de ces derniers, ils devaient s’arrêter juste avant une
attaque généralisée contre la classe ouvrière. Dans les années
1930-32, ils utilisèrent les nazis comme un contrepoids au mouvement
ouvrier, gardant leur liberté de manœuvre en permettant à chacun
des deux de neutraliser l’autre. Mais alors que la crise
s’éternisait, ils trouvèrent le prix à payer à la
social-démocratie – le maintien de certains gains réalisés par
les travailleurs dans le passé – trop élevé. Les généraux et
les industriels estimèrent, à la fin de 1932, que pour assurer leur
domination un mouvement nazi qui détruirait les organisations de la
classe ouvrière était préférable à un mouvement social-démocrate
qui s’efforçait d’acheter la passivité des travailleurs.
Le
premier test vint en juillet 1932. Le social-démocrate Severing
était encore installé confortablement au Ministère de l’Intérieur
prussien, avec sa police de 80 000 hommes armés jusqu’aux
dents. Le président de la république était Hindenburg – le même
Hindenburg qui, alors qu’il était dictateur du temps de guerre,
avait été discrédité par l’effondrement du front, puis
réhabilité par Ebert pour se joindre à l’effort commun contre le
« bolchevisme ».
Au
début de 1932, le soutien des sociaux-démocrates avait assuré la
réélection de Hindenburg comme président. Il rendit alors aux
sociaux-démocrates la monnaie de leur pièce. Il approuva la
déposition du gouvernement prussien social-démocrate (de droite),
démocratiquement élu dans les formes constitutionnelles, exactement
de la même façon qu’Ebert, neuf ans plus tôt, avait permis la
déposition du gouvernement social-démocrate (de gauche) de Saxe,
démocratiquement élu dans les formes constitutionnelles. Severing,
qui avait mis en route les Freikorps pour aller semer la terreur chez
les travailleurs de l’Allemagne centrale et de la Ruhr, fut
brutalement éjecté de son bureau par la Reichswehr qui avait été
constituée à partir des Freikorps.
Et
ce n’était que la répétition générale. A la fin de 1932,
Goebbels confia à son journal intime sa peur que les nazis n’aient
manqué leur chance ; ils avaient eu moins de voix que le total
combiné du KPD et du SPD dans la seconde élection législative de
1932, et des membres déçus des sections d’assaut passaient aux
communistes par milliers. L’avenir, écrivait Goebbels, « est
sombre et brumeux : toutes les perspectives et tous les
espoirs
complètement évanouis ».
Mais
à ce moment les vieux dirigeants de l’Allemagne mirent tout leur
poids derrière Hitler. Les industriels Thyssen et Krupp le
rencontrèrent et furent rassurés : il avait bien l’intention
d’agir dans le sens de leurs intérêts. L’ancien chancelier du
Parti « démocratique » du Centre, Papen, négocia avec
Hitler. Puis Hindenburg donna aux nazis le contrôle du gouvernement.
Ceux qui avaient été sauvés de la « socialisation »
par les sociaux-démocrates en 1919 collaboraient désormais avec
Hitler pour détruire le mouvement ouvrier social-démocrate.
Pourtant,
même après qu’Hitler ait été installé à la Chancellerie et
que ses sections d’assaut aient commencé à
« nettoyer »
Berlin, les sociaux-démocrates n’arrivaient pas à croire que les
liens de sang qu’ils avaient établis avec la classe dirigeante
entre 1918 et 1923 fussent définitivement dissous. Au Reichstag, des
porte-parole sociaux-démocrates déclarèrent qu’ils formeraient
une opposition loyale à ce que leur dirigeant, Breitscheid, appelait
« un gouvernement légal ».1
Des groupes de Jeunesses Socialistes de Berlin qui avaient commencé
à travailler dans la clandestinité furent exclus du parti.2
La direction syndicale envoya à ses membres des instructions leur
demandant de célébrer le Premier Mai aux côtés des nazis dans une
« journée nationale du travail »3
– mais cela n’empêcha pas les nazis de saisir les locaux
syndicaux le 2 mai et d’envoyer les dirigeants dans des camps de
concentration. Breitscheid mourut aux mains des nazis – de même
qu’Hilferding, le « marxiste » dont le prestige avait
été si précieux au capitalisme allemand pendant l’été
désespéré de 1923.
Ceux
qui avaient cru au capitalisme à visage humain, à la « marche
dans l’ordre vers la socialisation », à « l’ancrage
des conseils dans la constitution », n’avait fait que rendre
inévitable la sujétion de l’Europe à une barbarie médiévale
armée des engins les plus monstrueux produits par la technologie
moderne.
Ce
ne fut pas qu’en Allemagne que la défaite de la révolution
constitua une catastrophe pour l’humanité. Proche de l’Allemagne
s’étendait la masse gigantesque de l’ancien empire des tsars.
Ceux qui avaient dirigé la révolution qui y avait triomphé en 1917
pensaient que sa destinée était liée à celle du géant industriel
allemand. La propagation de la révolution de la Russie à
l’Allemagne n’était pas un rêve insensé. Comme nous l’avons
vu, il y eut un bref moment, en 1918, où les conseils ouvriers
furent le seul
pouvoir des monts Oural à la Mer du Nord. Il y eut un mouvement
mondial, avec ses Armées Rouges dans la Ruhr aussi bien qu’en
Sibérie, en Bavière comme dans le bassin du Don, ses conseils à
Turin et Brême comme à Tsaritsyne.
Mais
ce mouvement fut détruit à l’Ouest – en Allemagne, en Autriche
et en Italie – par l’influence et la politique du réformisme
social-démocrate. Au lieu que la révolution européenne se
précipite à la rescousse de la république ouvrière russe
assiégée, la social-démocratie européenne donna vie et espoir aux
forces qui voulaient détruire cette république.
Dans
de telles conditions, la démocratie ouvrière en Russie ne pouvait
rester longtemps en vie. Comme Rosa Luxemburg l’écrivait dès
1918 :
Tout ce qui se passe en Russie
s'explique
parfaitement : c'est une chaîne inévitable de causes et d'effets
dont les points de départ et d'arrivée sont la carence du
prolétariat allemand et l'occupation de la Russie par l'impérialisme
allemand.4
Ce
n’est pas ici le lieu pour traiter en détail de ce qu’il advint
en Russie : la classe ouvrière décimée à la suite de la
guerre civile et de l’intervention étrangère, la démocratie des
soviets à l’agonie, la bureaucratisation, la montée en puissance
d’une nouvelle classe capitaliste étatique, le stalinisme. Mais il
est nécessaire de le répéter : l’apparition d’une forme
nouvelle d’exploitation et d’oppression était inséparable de
l’isolement de la révolution. La social-démocratie à l’Ouest
engendra le stalinisme à l’Est. Le sang versé par Staline, comme
celui répandu par Hitler, rougit le seuil des sociaux-démocrates
(de droite) Ebert, Noske, Severing et Wels... comme celui du
social-démocrate (de gauche) Hilferding.
Cette
influence mutuelle est peut être le plus clairement démontrée par
le bref été indien de Moscou en 1923. En août et septembre de
cette année, les nouvelles de Berlin redonnèrent vie, brièvement,
à l’enthousiasme pour la révolution. A nouveau, il semblait que
l’interaction entre l’Allemagne et la Russie pouvait créer de
nouvelles perspectives pour l’humanité. Il y avait à l’Ouest
une lueur qui pouvait mettre de la chaleur jusque dans le cœur
bureaucratique froid d’un Staline. Mais bientôt cette chaleur se
transformait en déception glaciale. La défaite sans combat de
l’Allemagne produisit une démoralisation encore plus grande à
Moscou qu’à Berlin.
Pour
le bolchevik devenu bureaucrate, la perspective d’une humanité
libérée semblait à nouveau bien plus distante et irréelle que la
poursuite des objectifs de production et le cirage de bottes des
carriéristes ; pour les travailleurs russes, la révolution
était une fois de plus un mirage lointain, obscurci par la réalité
quotidienne de la pénurie, des bas salaires et d’un régime chaque
jour plus autoritaire.
Les
effets destructifs en Russie se retournèrent directement contre le
mouvement révolutionnaire en Allemagne. Les nouveaux bureaucrates
moscovites étaient habitués à une obéissance immédiate à leurs
ordres : ils imposèrent la même règle à leurs partisans de
l’étranger. Les effets des politiques suivies dans des pays donnés
en vinrent à avoir moins d’importance que ceux qui dictaient ces
politiques.
La
terminologie politique elle-même en fut corrompue. Serge raconte
comment
les
partis changeaient de visage et même de langage : un jargon
conventionnel s’imposait dans nos publications, et nous l’appelions
« le sabir de l’agit-prop ». Il n’était question que
de « l’approbation cent pour cent de la ligne juste de
l’Exécutif », de « monolithisme
bolchevik’ »,
de « bolchevisation accélérée des partis frères’ ».5
La
discussion rationnelle au sujet de ce qu’il fallait faire fut
remplacée par des mots de code arbitrairement connectés destinés à
justifier les décisions après l’événement.
Le
Parti Communiste Allemand avait fait, dans les cinq premières années
de son existence, de nombreuses erreurs graves. Mais au moins,
lorsqu’on lit les procès-verbaux des congrès et des débats de
ces années-là, on se sent en présence d’êtres humains qui
essaient, même avec maladresse, de changer l’histoire. A
l’inverse, ce que l’on trouve dans les congrès et les débats à
partir de 1924, ce sont des manœuvres de coulisses sanctifiées par
une citation hors contexte et par un « fait » de pure
invention.
Au
moment où la troisième grande crise fondit sur l’Allemagne en
1929-1933, le Parti Communiste n’était plus un facteur positif,
montrant la voie à suivre comme il l’avait fait en 1918-1920 et en
1923. Le crétinisme bureaucratique l’avait transformé en un
facteur négatif
de l’histoire. Bien sûr, il était capable d’obtenir des
millions de suffrages des travailleurs, en particulier des
travailleurs sans emploi, qui ne voyaient aucun avenir dans la
social-démocratie. Mais il ne pouvait traduire cette audience en
défi à l’emprise des sociaux-démocrates sur le mouvement ouvrier
organisé, à cause d’un gauchisme dément, ordonné de Moscou, qui
faisait paraître insignifiant l’ultra-gauchisme de 1919-1921.
Moscou ayant décrété que la social-démocratie était la même
chose que le fascisme, les dirigeants communistes ignorèrent la
menace du vrai fascisme. Les effectifs du KPD n’étaient que de la
moitié du chiffre de 1923. Malgré ses cinq millions de voix, il se
positionnait en marge de l’histoire, refusant de mettre les
dirigeants du SPD au défi de montrer, par le test du front unique,
que les mots qu’ils utilisaient n’étaient pas seulement destinés
à tromper leurs partisans. Pendant que les nazis progressaient vers
le pouvoir, le KPD continuait à marmonner des phrases
inintelligibles sur les dangers du
« social-fascisme »,
endormant les travailleurs avec le slogan : « Après
Hitler, notre tour ».
La
dégénérescence avait atteint le point de non-retour. Le monde
entier dut en payer le prix.