1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
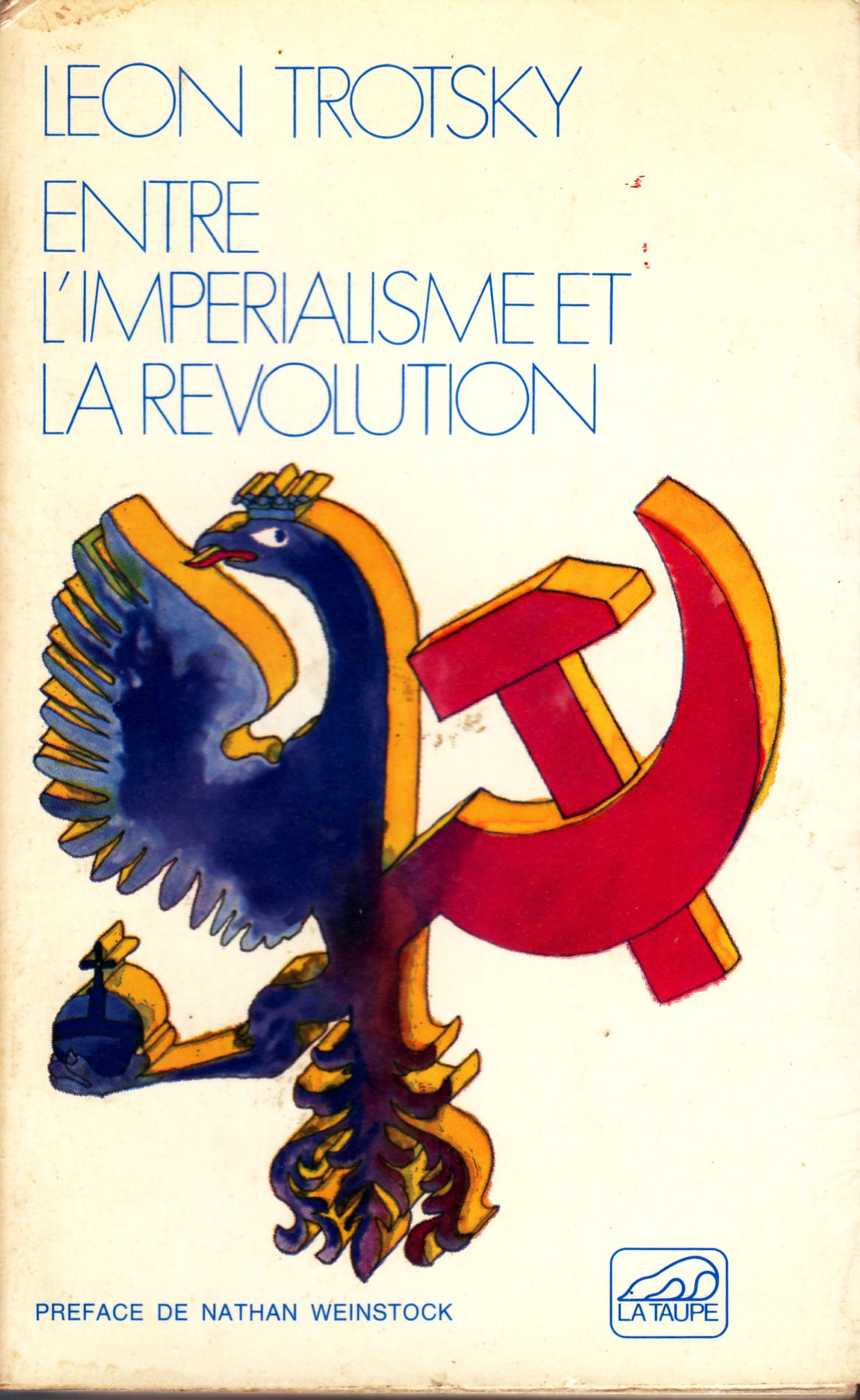
chapitre VI.
Fournissant à Wrangel des hommes et du matériel, la Géorgie fut en même temps, durant toute l’année 1920, un nid de conspiration pour les gardes-blancs russes, et particulièrement pour les gardes-blancs caucasiens de différentes tendances. Elle servit d’intermédiaire entre Pétliura, l'Ukraine, le Kouban, le Daghestan et les montagnards réactionnaires. Après leur défaite, les blancs trouvent asile chez les mencheviks ; chez eux, ils organisent leurs états-majors et développent leur activité. De la Géorgie ils dirigent des détachements d’insurgés sur le territoire du pouvoir soviétique par les voies suivantes : 1° Soukhoum-Kalé-col de Marouch et sources du Kouban et de la Laba ; 2° Soukhoum-Kalé-Gagri, Adler-Krasnaïa Poliana, col d’Aïchka-sources de la Laba ; 3° Koutaïs-Oni-Naltchik.
Ils agissent plus ou moins en secret, de façon à sauver tout juste les apparences pour la diplomatie ; néanmoins, la police spéciale géorgienne est parfaitement au courant de leurs agissements. « Durant mon séjour en Géorgie — écrit, le 12 novembre 1920, à la police spéciale un lieutenant garde-blanc — je ne ferai absolument rien qui soit susceptible de provoquer des désagréments avec la mission soviétique, car mon travail s’effectuera d’une façon encore plus clandestine qu’auparavant. Si l’on exige de moi des répondants, je puis en présenter une quantité suffisante parmi les hommes d’État géorgiens. » Ce document, avec beaucoup d’autres, a été trouvé dans les archives mencheviques par la commission de l’Internationale Communiste. Les organisations des conspirateurs sont en liaison étroite avec les missions de l’Entente et en particulier avec les sections de contre-espionnage de ces derniers. Si Henderson avait là-dessus de moindre doute, il n’aurait qu’à se renseigner aux archives du contre-espionnage britannique. Nous aimons à croire que son stage patriotique lui facilitera l’accès de ce sanctuaire.
Batoum était à cette époque le centre le plus important des intrigues et des complots de l’Entente et de ses vassaux. En juillet 1920, l’Angleterre remit Batoum directement aux mains de la Géorgie menchevique, qui, pour gagner les sympathies de la population de l’Adjar, dut immédiatement employer l’artillerie. Évacuant Batoum, après la destruction préalable de ses ouvrages de défense maritime, le commandement britannique témoignait par là même de son entière confiance dans les intentions de la Géorgie à l’égard de Wrangel. La défaite de ce dernier changea du coup la situation. Les généraux et les diplomates de l’Entente connaissaient trop bien le caractère véritable des rapports mutuels de la Géorgie, de Wrangel et des républiques soviétiques pour ne conserver aucun doute sur la situation désespérée dans laquelle la liquidation du front de Wrangel mettait les mencheviks géorgiens. Il est à croire d’ailleurs que ces derniers également élevèrent la voix pour réclamer des « garanties ». Dans les sphères dirigeantes anglaises, la question se posa d’une nouvelle occupation de Batoum sous forme d’affermage, de création d’un port franc ou sous toute autre de ces enseignes qui existent en aussi grand nombre chez les diplomates que les fausses dés chez les cambrioleurs. La presse dirigeante géorgienne parlait de l’occupation projetée avec une satisfaction ostensible plutôt qu’avec inquiétude. Il s’agissait, à n’en pas douter, de la création d’un nouveau front contre nous. Nous déclarâmes que nous considérerions l’occupation de Batoum par les Anglais comme l’ouverture des hostilités.
A peu près à cette époque, la protectrice attitrée des faibles, la France de M. Millerand, s’intéressa particulièrement au sort de la Géorgie indépendante. Arrivé en Géorgie, le « Commissaire général pour la Transcaucasie », M. Abel Chevalley, sans perdre de temps, déclara, par l’intermédiaire de l’Agence télégraphique géorgienne : « Les Français aiment d’un amour fraternel la Géorgie et je suis heureux de pouvoir le déclarer publiquement. Les intérêts de la France concordent entièrement avec ceux de la Géorgie… » Les intérêts de la France, qui avait encerclé la Russie par le blocus de la famine et lâché sur elle toute une meute de généraux tsaristes, « concordaient entièrement » avec les intérêts de la Géorgie démocratique ! Après force discours lyriques et quelque peu niais sur l’amour ardent des Français pour les Géorgiens, M. Chevalley, il est vrai, comme il sied à tout bon représentant de la Troisième République, expliqua que « les États du monde entier avaient besoin actuellement de matières premières et de produits fabriqués ; or, la Géorgie était la grande voie naturelle entre l’Orient et l’Occident ». En d’autres termes, ce qui attirait les amis de M. Millerand ce n’était pas seulement leur amour pour la Géorgie, mais aussi l’odeur du naphte de Bakou.
Peu après l’arrivée de M. Chevalley, l’amiral français Dumesnil débarqua en Géorgie. Sa tendresse pour les compatriotes de Noé Jordania ne le cédait en rien à celle de son collègue, le diplomate. L’amiral déclara que la France « ne reconnaissant pas la mainmise sur la propriété d’autrui » ( qui l’eût cru ? ), lui, Dumesnil, tant qu’il se trouverait sur le territoire de la Géorgie « indépendante », ne permettrait pas au gouvernement soviétique de s’emparer des navires russes qui se trouvaient dans le port géorgien et qui étaient destinés à être transmis à Wrangel ou à ses successeurs éventuels. Les voies par lesquelles triomphe le droit sont parfois vraiment impénétrables !
La collaboration des représentants de la démocratie française avec les démocrates de Géorgie prit un développement extraordinaire. Le torpilleur français Saquiart bombarda et brûla la goélette russe Zeïnab. Avec le concours des agents de la Police Spéciale géorgienne, les contre-espions français attaquèrent le courrier diplomatique des soviets et le dévalisèrent. Les torpilleurs français protégèrent le départ pour Constantinople du bateau russe Printsip, ancré dans le port géorgien. L’organisation des insurrections dans les républiques soviétiques et dans les régions voisines de la Russie redoubla d’intensité. La quantité de l’armement amené de la Géorgie dans ces régions augmenta sensiblement. Le blocus de famine de l’Arménie, qui, à cette époque, avait déjà adopté le régime soviétique, continua. Mais Batoum ne fut pas occupé. Il est possible qu’à cette époque, Lloyd George ait renoncé à la pensée d’un nouveau front. Il est possible également que l’amour ardent que nourrissaient les Français pour la Géorgie ait empêché les Anglais de manifester le même sentiment. Notre déclaration relative à Batoum ne resta pas naturellement non plus sans effet. Après avoir, au dernier moment, payé les services de la Géorgie par cette lettre de crédit fictive que constituait la reconnaissance de jure de l’État géorgien, l’Entente décida de ne rien construire sur le fondement instable de la Géorgie menchevique. Après la lutte acharnée qu’ils avaient menée contre nous, les mencheviks géorgiens étaient persuadés, au printemps de l’année 1920, que nos troupes parachèveraient leur victoire sur Dénikine, arriveraient à étapes forcées jusqu’à Tiflis et Batoum et balayeraient comme un fétu de paille la démocratie menchevique… Mais nous, qui n’attendions d’un coup d’État en Géorgie, aucune conséquence révolutionnaire importante, nous étions prêts à tolérer à nos côtés la démocratie menchevique, à condition qu’elle consentit à former avec nous un front commun contre la contre-révolution russe et l’impérialisme européen.
Mais notre attitude, dictée par des considérations politiques, fut interprétée à Tiflis comme une marque de faiblesse. Nos amis de Tiflis nous écrivaient alors que, tout d’abord, les dirigeants mencheviques ne pouvaient arriver à comprendre les motifs de notre conduite pacifique : ils se rendaient parfaitement compte que nous aurions pu occuper la Géorgie sans coup férir. Bientôt ils imaginèrent une explication fantaisiste : l’Angleterre ne consentait, soi-disant, à entrer en pourparlers avec nous que si nous nous engagions à ne rien entreprendre contre la Géorgie. Quoi qu’il en soit, la peur du début fait bientôt place à l’insolence chez les mencheviks, qui cherchent à nous provoquer de toutes les façons. Lors de nos revers sur le front polonais et de nos embarras sur le front de Wrangel, la Géorgie se range ouvertement du côté de nos ennemis. Sans envergure révolutionnaire, sans largeur de vues politiques, sans perspective aucune, cette misérable démocratie petite-bourgeoise qui, après avoir rampé la veille devant les Hohenzollern, était prête maintenant à s’aplatir devant Wilson, qui, tout en soutenant Wrangel, était prête à le renier au moment critique, qui, tout en concluant un accord avec la Russie soviétique, n’avait pour but que de tromper cette dernière, qui, lâche et poltronne, s’était à la fin complètement empêtrée dans le filet de ses propres machinations, avait elle-même prononcé son arrêt de mort.
Quoique nous en eussions entièrement le droit, nous ne considérions pas, comme nous l’avons dit plus haut, qu’il fut de notre intérêt politique de liquider par la force des armes la Géorgie menchevique. Surtout, nous savions bien que si l’on s’avisait de leur marcher sur le pied, les politiciens mencheviques allaient pousser les hauts cris dans toutes les langues des démocraties civilisées. Ces gens-là ne sont pas les ouvriers de Rostov, de Novotcherkask ou d’Ekatérinodar, que les partisans de Dénikine, soutenus par la « neutralité » amicale et le concours effectif des mencheviks géorgiens, massacraient par centaines et par milliers et qui périssaient obscurément sans même que l’Europe en eût connaissance. Les politiciens mencheviques géorgiens sont tous des intellectuels, d’anciens étudiants des universités d’Europe, les généreux amphitryons de Renaudel, de Vandervelde et de Kautsky. Dans ces conditions, n’était-il pas facile de prévoir qu’ils allaient rallier les sympathies de tous les organes de la société démocratique, du libéralisme et de la réaction ? N’était-il pas clair que tous les politiciens qui s’étaient déshonorés en soutenant le carnage impérialiste, que tous les traîtres et les banqueroutiers du socialisme officiel, en réponse aux lamentations de leurs confrères géorgiens offensés, allaient pousser des clameurs d’indignation pour attester leur attachement à la justice et leur dévouement à l’idéal démocratique ? D’autant plus qu’il n’y aurait aucune dépense à supporter. Nous connaissions trop bien les mencheviks pour douter qu’ils laisseraient passer une si belle occasion d’adopter des résolutions, de lancer des manifestes, des appels, des déclarations, de composer des mémorandums, des articles et de prononcer des discours grandiloquents et pathétiques avec l’approbation de la bourgeoisie et avec l’appui de leurs gouvernements. Si même nous n’en avions pas eu d’autres plus sérieuses, cette seule raison, c’est-à-dire le désir de ne pas donner un prétexte commode à la démocratie internationale de battre le rappel, eût suffi pour nous décider à ne pas toucher aux chefs mencheviks de la contre-révolution dans leur refuge géorgien. Nous voulions un accord. Nous proposâmes aux mencheviks une action commune contre Dénikine. Ils refusèrent. Nous conclûmes avec eux un traité qui portait beaucoup moins atteinte à leur indépendance que le protectorat de l’Entente. Nous insistâmes sur l’exécution du traité ; dans une série de notes et de protestations, nous dénonçâmes la conduite hostile à notre égard des mencheviks géorgiens. Par une pression des masses laborieuses de la Géorgie elle-même, nous nous efforçâmes d’avoir dans ce pays un voisin susceptible de devenir pour nous un intermédiaire avantageux entre la Fédération soviétique et l’Occident capitaliste. C’est dans ce sens qu’était orientée toute notre politique envers la Géorgie. Mais les mencheviks ne pouvaient plus faire volte-face. En étudiant l’histoire documentaire de nos rapports avec le gouvernement des mencheviks, je me suis maintes fois étonné de notre longanimité et j’ai rendu en même temps justice à cette gigantesque machine bourgeoise de falsification et de mensonge au moyen de laquelle le coup d’État soviétique, inévitable en Géorgie, était représenté comme une agression militaire soudaine et sans motif aucun, comme l’agression du méchant loup soviétique contre le pauvre petit Chaperon Rouge du menchevisme. O poètes de la Bourse, fabulistes de la diplomatie, mythologues de la grande presse, ô canailles à gages du Capital !
Avec la perspicacité dont il a le secret, Kautsky découvre la mécanique diabolique du coup d’État bolchevique en Géorgie : l’insurrection commença, non pas à Tiflis, comme cela eût dû arriver si elle fût partie des masses ouvrières, mais aux confins du pays, dans le voisinage des troupes soviétiques, et se développa de la périphérie au centre. N’est-il pas clair que le régime menchevique est tombé victime d’une agression militaire déclenchée de l’extérieur ? Ces considérations feraient honneur à un jeune juge d’instruction. Mais elle n’apportent rien pour la compréhension des événements historiques.
La révolution soviétique était partie des centres de Petrograd et de Moscou, et, de là, s’était répandue dans tout l’ancien empire des tsars. La révolution, à cette époque, n’avait pas d’armée. Ses propagateurs étaient des détachements d’ouvriers armés à la hâte. Ils pénétraient presque sans résistance dans les régions les plus retardataires et, soutenus par la sympathie illimitée des travailleurs, y instauraient le pouvoir soviétique. Lorsque la réaction, personnifiée par la bourgeoisie et les grands propriétaires fonciers, s’était emparée, comme au Don ou au Kouban, du centre de la région, l’insurrection allait de la périphérie au centre, très souvent avec le concours effectif des agitateurs et des militants arrivés des capitales.
Néanmoins, la contre-révolution, grâce au secours qu’elle avait reçu du dehors, réussit à reprendre pied dans les parties les plus arriérées du territoire russe et à s’y retrancher ; ainsi en fut-il au Don, au Kouban, au Caucase, dans la région de la Volga, en Sibérie, sur le littoral de la mer Blanche et même en Ukraine. En même temps que la contre-révolution, la révolution formait son armée. Bientôt ce furent des batailles rangées, des campagnes militaires en règle qui décidèrent du sort des frontières de la révolution soviétique. Mais comme les armées en présence n’avaient point été amenées « de l’extérieur », qu’elles avaient été créées par les classes qui luttaient à mort l’une contre l’autre sur toute l’étendue de l’ancien empire des tsars, c’était donc la lutte révolutionnaire des classes qui s’exprimait ainsi dans la langue des opérations militaires. La contre-révolution, il est vrai, était dans une large mesure soutenue par une force militaire venue du dehors. Mais cela ne fait que confirmer notre thèse. Sans Pétersbourg, Moscou, le rayon d'Ivanovo-Voznessensk, le bassin du Donetz, l’Oural, il n’y eût pas eu de révolution. D’elle-même la région du Don n’aurait jamais instauré le pouvoir soviétique. Un village du gouvernement de Moscou ne l’aurait pas fait non plus. Mais, comme le village du gouvernement de Moscou, la stanitza du Kouban ainsi que le steppe transvolgien formaient, depuis longtemps, partie intégrale d’un tout administratif et économique unique et avaient été entraînés avec lui dans le tourbillon de la révolution, ils tombèrent naturellement sous la direction révolutionnaire et de la ville et du prolétariat industriel. Ce n’est pas un plébiscite sur chaque point du pays, mais l’hégémonie incontestée de l’avant-garde prolétarienne dans tout le pays qui assura la diffusion et la victoire de la Révolution. Avec l’appui de la force armée du dehors quelques régions des confins de la Russie réussirent non seulement à échapper au tourbillon de la révolution, mais à maintenir, pour un temps assez long, le régime bourgeois. Les « démocraties » de Finlande, d’Esthonie, de Lettonie, de Lithuanie et même de Pologne doivent leur existence à la force militaire étrangère qui, durant la période critique de leur formation, prêta son appui à la bourgeoisie et écrasa le prolétariat. Dans ces pays touchant directement à l’Occident capitaliste la corrélation des forces fut faussée par l’introduction d’un élément extérieur : la force militaire étrangère, au moyen de laquelle la bourgeoisie put, par le massacre, l’emprisonnement et la déportation, décimer l’élite prolétarienne. De cette façon seulement la démocratie parvint à établir un équilibre temporaire sur des bases bourgeoises. Pourquoi, à propos, les bonnes âmes de la IIe Internationale ne préconiseraient-elles pas un programme comportant : en premier lieu, le retrait des armées bourgeoises formées en Finlande, en Estonie, en Lettonie, etc., avec l’appui des forces extérieures ; en second lieu, la libération de tous les prisonniers et l’amnistie pour tous les exilés (il est impossible, malheureusement, de ressusciter les morts) ; et enfin un référendum ?
La situation de la Transcaucasie était différente : entre elle et les centres de la révolution s’étendait la Vendée cosaque. Sans la Russie soviétique, la démocratie petite-bourgeoise de Transcaucasie eût été immédiatement écrasée par Dénikine. Sans les gardes-blancs du Don et du Kouban, elle se fût immédiatement dissoute dans la révolution soviétique. Elle vivait et s’alimentait de la guerre civile acharnée qui désolait la Russie et de la force militaire étrangère installée en Transcaucasie. Dès l’instant où la guerre civile se termina par la victoire de la République soviétique, l’effondrement du régime petit-bourgeois en Transcaucasie devint inévitable.
En février 1918 déjà, Jordania déplorait que les tendances bolcheviques eussent pénétré dans les campagnes et les villes et touché jusqu’aux ouvriers mencheviks eux-mêmes. Les insurrections paysannes se succédaient sans interruption en Géorgie. Alors qu’en Russie soviétique, jusqu’à l’insurrection des Tchéco-Slovaques (mai 1918) dirigée par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks, les journaux mencheviks paraissaient librement, en Géorgie au contraire le parti communiste avait été réduit à l’action clandestine, dès le début de février. Quoique les travailleurs de Transcaucasie, coupés de la Russie soviétique, fussent continuellement terrorisés par la présence des troupes étrangères, les insurrections révolutionnaires ont occupé dans la vie de la Géorgie une place beaucoup plus grande que les insurrections des blancs sur le territoire soviétique. L’appareil d’oppression du gouvernement géorgien fut incomparablement plus considérable que celui de la Russie soviétique.
Notre victoire sur Dénikine et, par la suite, sur la toute puissante Entente produisit une impression profonde sur les masses populaires de Transcaucasie.
Lorsque les troupes soviétiques approchèrent des frontières de l’Azerbeïdjan et de la Géorgie, les masses laborieuses de ces républiques qui avaient toujours été de cœur avec les travailleurs de la Russie, furent envahies par une puissante effervescence révolutionnaire. Leur état d’esprit pourrait se comparer à celui qui se manifesta chez les masses populaires de la Prusse Orientale et même, jusqu’à un certain point, de toute l’Allemagne, lors de notre offensive sur Varsovie, alors que la gauche de notre armée rouge arrivait aux frontières de l’Allemagne. Mais alors nous n’étions en présence que d’un épisode éphémère, tandis que la défaite des armées de Dénikine sous les yeux de l’Entente avait un caractère décisif ; aussi les masses laborieuses d’Azerbaïdjan, d’Arménie et de Géorgie ne doutaient-elles pas que le gouvernement soviétique au nord du Caucase reposât sur des bises fermes et que sa domination fut inébranlable.
En Azerbaïdjan, la révolution soviétique s’accomplit presque automatiquement lorsque nos troupes approchèrent des frontières de ce pays. Le parti dirigeant des moussavats, composé de bourgeois et de propriétaires fonciers, était loin d’avoir des traditions et une influence aussi fortes que les mencheviks géorgiens. Bakou, qui, en Azerbaïdjan, jouait un rôle incomparablement plus important que Tiflis en Géorgie, était une vieille citadelle du bolchevisme. Les partisans des moussavats s'enfuirent, abandonnant presque sans résistance le pouvoir aux communistes de Bakou. L’attitude des dachnaks arméniens ne fut pas beaucoup plus digne. En Géorgie, les événements se déroulèrent plus méthodiquement. Les tendances bolcheviques qui avaient été obligées de se dissimuler commencèrent à se manifester ouvertement. Le parti communiste fit des progrès rapides en tant qu’organisation et, en peu de temps, il réussit à conquérir !es sympathies des travailleurs. Le journal des socialistes-fédéralistes géorgiens, le Sakartvello, écrivait, le 7 décembre 1920 : « La force des communistes en Géorgie, il y a quelques mois, était tout autre que maintenant. Mors la Géorgie n’était pas encore entourée de bolcheviks. Nous avions pour voisins des États nationaux indépendants. Notre situation économique et financière était incomparablement meilleure qu‘aujourd’hui. Mais la situation a changé et ce changement s’est effectué au profit des bolcheviks. A l’heure actuelle, le parti bolchevik a ses organisations en Géorgie. En certains milieux ouvriers, comme par exemple dans le syndicat des ouvriers du Livre, il dispose même de la majorité. En somme, l’activité des bolcheviks a pris un développement considérable. A l’intérieur, la croissance des forces bolcheviques ; à l’extérieur, leur domination illimitée. Telle est la situation dans laquelle est tombée la Géorgie. »
Reflétant l’état de choses réel, ces plaintes d’un organe qui nous était résolument hostile ont pour nous une très grande importance : elles constituent une réfutation catégorique de Kautsky qui, constatant « l’entière liberté » accordée aux communistes en même temps que leur complète impuissance, se base là-dessus pour représenter la révolution soviétique, en Géorgie, comme un résultat de la violence, de la contrainte étrangère. Or, les mots de la gazette nationaliste : « A l’intérieur, la croissance des forces bolcheviques ; à l’extérieur, leur domination » sont la formule exacte du coup d’État soviétique qui allait se produire.
Sentant leur situation désespérée, les mencheviks géorgiens s’engagèrent dans la voie de la réaction ouverte. Le refus brutal et provocant du gouvernement de Jordania de s’allier à la Russie contre Dénikine avait déjà discrédité jusqu’à un certain point les mencheviks parmi les masses. Les infractions systématiques au traité conclu avec la Russie soviétique, infractions que nous prîmes soin de dénoncer, eurent un effet analogue. Concevant l’impossibilité d’exister par eux-mêmes, alors que le pouvoir soviétique avait triomphé sur tout le sud-est de l’ancien empire des tsars, les mencheviks firent des tentatives désespérées pour aider Wrangel et obtenir le concours militaire de l’Entente. Mais ce fut en vain. En Crimée, ce ne fut pas seulement le sort de Wrangel, ce fut aussi celui de la Géorgie menchevique qui se décida.
Nos effectifs au Caucase furent quelque peu augmentés durant l’automne 1920, au moment de la descente effectuée par Wrangel au Kouban, alors qu’il n’était bruit que d’une occupation de Batoum. Cette concentration de nos troupes avait un caractère purement défensif. La liquidation du front de Wrangel et l’armistice avec la Pologne renforcèrent les tendances soviétiques en Géorgie. La présence des régiments rouges aux frontières de ce pays signifiait qu’il n’y avait nullement lieu de craindre une intervention étrangère en cas de révolution soviétique. Ce n’est pas pour renverser les mencheviks qu’il fallait des soldats rouges, mais pour prévenir toute tentative de débarquement de troupes envoyées de Constantinople par l'Angleterre, par la France ou par Wrangel pour étouffer la révolution soviétique. Les mencheviks eux-mêmes, avec leur garde prétorienne populaire et leur armée nationale fictive, opposèrent une résistance insignifiante. Commencée au début de février, la révolution soviétique était déjà, vers le milieu de mars, terminée dans toutes les parties du pays.
Nous n’avons pas la moindre intention de dissimuler ou de rabaisser l’importance du rôle de l’armée soviétique dans la victoire des soviets au Caucase. En février 1921, cette armée prêta à la révolution un concours puissant, quoique beaucoup moindre que celui qu’avaient fourni, durant trois ans, aux mencheviks les armées turque, allemande, anglaise, sans parler des gardes-blancs russes. Si le Comité Révolutionnaire qui dirigeait l’insurrection ne commença pas ses opérations à Tiflis, centre de la garde populaire menchevique, mais dans les frontières, où il pouvait s’arc-bouter à l’armée rouge et rassembler ses forces, cela prouve uniquement qu’il avait un sens politique avisé, ce que l’on ne saurait dire de Kautsky, qui, après coup, cherche à dicter à la révolution géorgienne une tactique contraire à celle qui lui a donné la victoire. Que Kautsky garde ses leçons de stratégie pour lui ! Nous, nous voulons nous instruire et apprendre à battre l’ennemi. Les apôtres de la IIe Internationale, eux, enseignent l’art d’être battu.
Ce qui arriva fut ce qui, depuis longtemps déjà, se préparait et ne pouvait pas ne pas arriver. L’histoire des rapports entre la Géorgie et la Russie soviétique n’est qu’un chapitre du livre sur le blocus de la Russie, sur les interventions militaires, sur l’or français, sur les navires anglais, sur les quatre fronts qui dévorèrent l’élite de la classe ouvrière. Ce chapitre ne saurait être isolé du reste du livre. La Géorgie, telle que nous la représentent maintenant les capitaines mencheviques de la guerre civile, n’a jamais existé : il n’y a jamais eu de Géorgie démocratique, pacifique, autonome, neutre. Ce qu’a été la Géorgie, c’est une place d’armes de la guerre de classes pan-russe Cette place d’armes est maintenant aux mains du prolétariat victorieux.
Et, après que les dirigeants mencheviques de la Géorgie ont aidé à massacrer, à pendre et à faire mourir de froid des dizaines de milliers de soldats rouges, des milliers de communistes et à nous porter des blessures que nous mettrons de longues années à guérir ; après que, malgré toutes nos pertes et tous nos sacrifices, nous sommes sortis vainqueurs de la lutte ; après que les masses laborieuses de la Géorgie ont, avec notre concours, jeté leurs dirigeants par-dessus bord à Batoum, ceux-ci viennent nous proposer de considérer la partie comme nulle et de recommencer le jeu. Aux mencheviks qui se sont compromis avec les officiers russes, turcs, prussiens et britanniques, Macdonald, Kautsky, Mrs. Snowden et autres savants accoucheurs et sages-femmes de la IIe Internationale se chargeront de refaire une virginité démocratique, après quoi, sous la protection de la flotte britannique, avec les subsides des rois du naphte et du manganèse, aux applaudissements du Times et avec la bénédiction du nouveau pape, la Géorgie menchevique, le pays le plus démocratique, le plus libre, le plus neutre du monde, sera restaurée, dans sa splendeur première.