1922 |
Entre l'impérialisme et la révolution
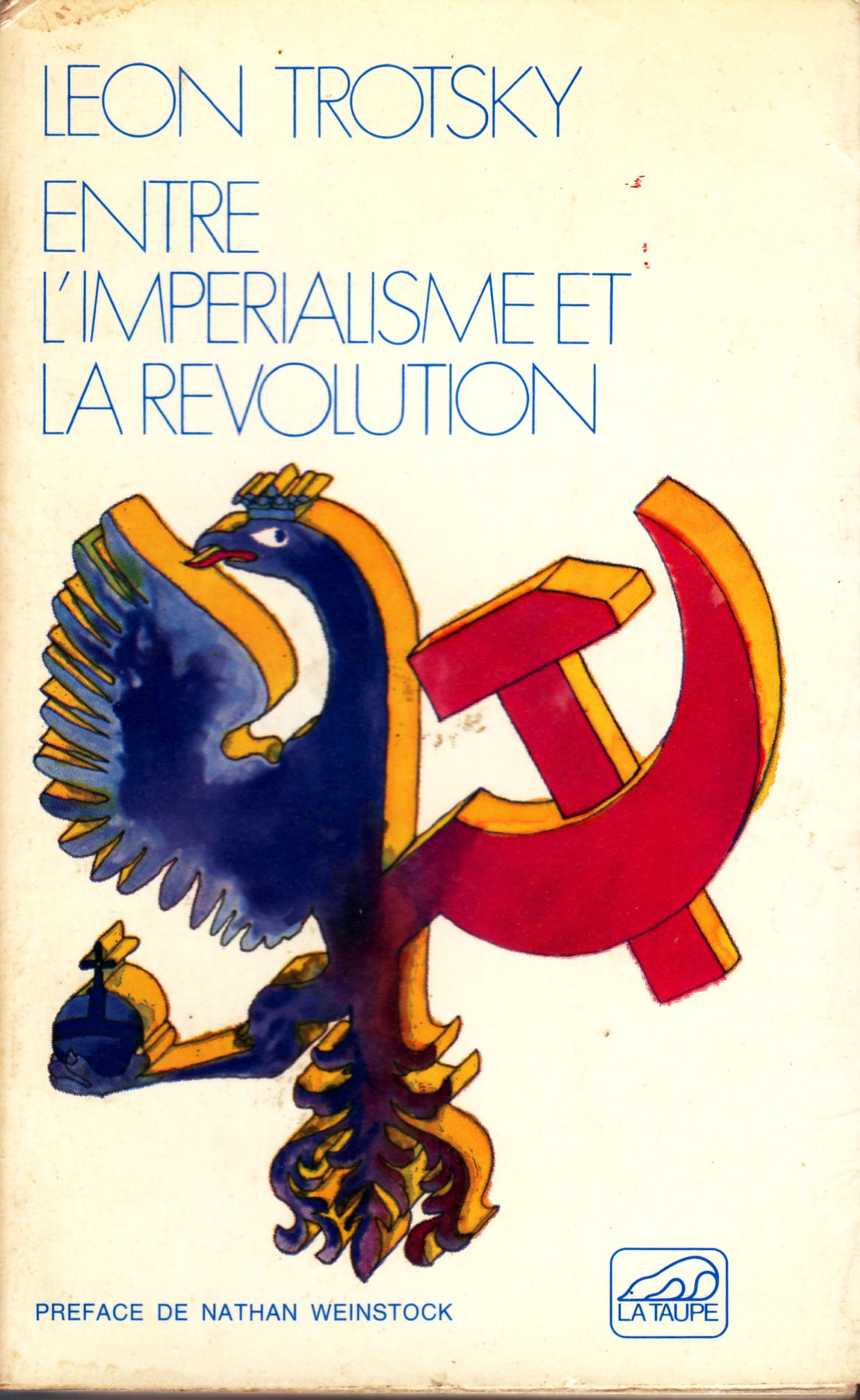
chapitre VII.
La Géorgie a joué, dans l’histoire du menchevisme russe, un rôle des plus importants. C’est en Géorgie que le menchevisme a revêtu la forme la plus évidente, la plus marquée de l’adaptation du marxisme au besoins de la classe intellectuelle, chez un peuple arriéré qui, dans son développement, n’en était encore, à tout prendre, qu’à sa période pré-capitaliste. L’industrie faisant défaut, la bourgeoisie nationale, au sens véritable du mot, n’existait pas. Le capital commercial se trouvait concentré presque exclusivement entre les mains des Arméniens. La culture intellectuelle était l’apanage des petits propriétaires fonciers, nobles pour la plupart. Le capitalisme qui commençait à pénétrer la vie nationale n’avait pas encore créé sa culture, mais il avait déjà engendré des besoins que la noblesse géorgienne, dont tout l’avoir consistait en vignes et en troupeaux de moutons, était impuissante à satisfaire. Le mécontentement contre l’administration russe et le tsarisme s’alliait à la haine du capitalisme représenté par le marchand et l’usurier arméniens. L’incertitude du lendemain et le désir de trouver une issue à sa situation amenèrent naturellement la nouvelle génération des intellectuels, nobles et petits-bourgeois, à adhérer à l’idéologie démocratique et à se chercher un appui parmi les travailleurs. Mais, à cette époque (fin du siècle dernier), le programme de la démocratie politique, sous son ancienne forme jacobine ou « manchestérienne », était déjà depuis longtemps condamné par la marche de l’évolution historique et, dans la conscience des masses opprimées d’Europe, avait cédé le pas à différentes théories socialistes qui, à leur tour, perdaient de plus en plus de terrain devant le marxisme. Les aspirations de la noblesse des campagnes et des villes à un champ plus large d’activité dans les domaines littéraire, politique et autres, aspirations marquées d’une sorte d’aversion envieuse pour le capitalisme ; les premiers mouvements des artisans et des ouvriers industriels, peu nombreux encore, qui s’éveillaient à la vie politique ; le mécontentement sourd de la classe paysanne opprimée trouvèrent leur expression dans l’adaptation menchevique du marxisme, laquelle simultanément habituait à la reconnaissance du caractère inévitable du développement capitaliste, remettait en honneur les idées de la démocratie politique discréditée en Occident et prédisait pour un avenir indéterminé et lointain la domination de la classe ouvrière qui devait surgir, organiquement et sans douleur, de la démocratie.
Nobles d’origine, petits-bourgeois par leur genre de vie et leur tour d’esprit, avec un faux passeport marxiste en poche, tels étaient les chefs du menchevisme géorgien lorsqu’ils entrèrent dans la politique révolutionnaire. Méridionaux impressionnables et souples, ils devinrent, en beaucoup de cas, les chefs des étudiants et du mouvement démocratique ; la prison, la déportation et la tribune de la Douma d’Empire consolidèrent leur autorité politique et leur donnèrent en Géorgie une certaine réputation.
L’inconsistance petite-bourgeoise du menchevisme, et particulièrement de sa fraction géorgienne, apparaissait de plus en plus nettement à mesure que la révolution prenait plus d’ampleur et que ses tâches intérieures et internationales devenaient plus compliquées. La poltronnerie politique est un trait important du menchevisme ; or, la révolution n’admet guère la poltronnerie. Durant les grands événements, un menchevik fait piètre figure. Ce trait de son caractère s’explique par la crainte sociale du petit-bourgeois devant le grand, de l’intellectuel, simple « pékin », devant un général, du petit avocat devant un véritable diplomate, du provincial méfiant et vaniteux devant un Français ou un Anglais. La poltronnerie devant les représentants attitrés du Capital a pour pendant obligatoire la hauteur envers les ouvriers. Dans la haine de Tsérételli pour la Russie soviétique il y a une révolte organique contre la tentative de l’ouvrier de se mettre lui-même à l’œuvre que seul, lui, le petit-bourgeois instruit est de taille à accomplir, et encore avec la permission du grand bourgeois.
Lorsque Tchkenkéli ou Guéguetchkori parlent du bolchevisme, ils empruntent leurs épithètes aux charretiers non seulement de Tiflis, mais de toute l’Europe. Mais quand ils « conversent » avec le général tsariste Alexéiev, ou bien avec le général allemand von Kress, ou encore avec le général anglais Walker, ils s’efforcent d’atteindre à la noblesse de langage des maîtres d’hôtel suisses. C’est surtout des généraux qu’ils ont peur. Ils leur donnent des gages, ils cherchent à les convaincre, ils leur expliquent avec déférence que le socialisme géorgien est quelque chose de tout à fait différent des autres formes du socialisme, qui ne visent qu’à la destruction et au désordre, tandis que leur socialisme, à eux, est une garantie d’ordre. L’expérience politique rend les petits-bourgeois plus cyniques, mais ne leur apprend rien.
Nous avons ouvert plus haut, devant nos lecteurs, le journal de Djoughéli et nous avons vu tel qu’il se représente lui-même un des chevaliers du menchevisme. Il brûle les villages ossètes et, dans un style de collégien dépravé, exprime dans son journal son admiration pour la beauté de l’incendie et ses affinités avec Néron. Les bolcheviks, qui ne taisent pas les faits de la guerre civile et les mesures de rigueur qu’ils emploient pour mater leurs ennemis, en imposent incontestablement à ce répugnant cabotin. Comme ses maîtres, Djoughéli est absolument incapable de comprendre que, derrière cette politique ouverte et intrépide de violence révolutionnaire, il y a la conscience d’un droit historique, d’une mission révolutionnaire, conscience qui n’a rien de commun avec le cynisme éhonté d’un satrape « démocratique » provincial incendiant les villages et se regardant avec complaisance dans la glace pour bien se convaincre de sa ressemblance avec le dégénéré romain au front ceint d’une couronne impériale.
Djoughéli n’est pas une exception ; ce qui le prouve mieux que tout, c’est la préface on ne peut plus élogieuse écrite pour son livre par le ministre des Affaires étrangères, Guéguetchkori. A la suite de Jordania, le ministre de l’Intérieur, Ramichvili, se référant à Marx, proclamait avec emphase le droit de la démocratie à la terreur implacable. De Néron à Marx… Le cabotinage de ces bourgeois de province, leurs procédés superficiels, leur imitation purement simiesque sont le témoignage criant de leur nullité, du vide de leur esprit.
Constatant eux-mêmes la complète impuissance de la Géorgie « indépendante », obligés, après l’effondrement de l’Allemagne, de chercher la protection de l’Entente, les mencheviks dissimulèrent de plus en plus soigneusement leur Police Spéciale et, au lieu du masque bon marché modèle Djoughéli-Néron, revêtirent le masque Jordania-Tsérételli-Gladstone, pour imiter ce déclamateur fameux, amoureux des lieux communs à la sauce libérale.
Les mencheviks géorgiens, surtout dans leur jeunesse, avaient besoin d’un marxisme frelaté, dans la mesure où il justifiait leur position essentiellement bourgeoise. Leur poltronnerie politique, leur phraséologie démocratique, assemblage de lieux communs pathétiques, leur répulsion instinctive pour tout ce qui est précis, achevé, tranché dans le domaine des idées, leur vénération envieuse des formes extérieures de la civilisation bourgeoise donnaient par leur amalgame un type diamétralement opposé au type marxiste.
Lorsque Tsérételli traite de la « démocratie internationale », que ce soit à Saint-Pétersbourg, à Tiflis ou à Paris, il est absolument impossible de savoir s’il parle de la mythique « famille des peuples », de l’Internationale ou bien de l’Entente. En fin de compte, c’est toujours à cette dernière qu’il s’adresse, mais il s’exprime de telle façon qu’on peut croire qu’il s’agit également du prolétariat mondial. Ses idées délayées, ses conceptions amorphes facilitent on ne peut plus cette confusion. Lorsque Jordania, le chef du clan, parle de la solidarité internationale, il allègue, à l’appui de son argumentation, l’hospitalité des rois géorgiens. « L’avenir de l’Internationale et de la Société des Nations est assuré », annonce Tchkenkéli à son retour d’Europe. Préjugés nationaux et bribes du socialisme, Marx et Wilson, emballements purement littéraires et étroitesse petite-bourgeoise, pathos et bouffonnerie, l’Internationale et la Société des Nations, une certaine dose de sincérité, beaucoup de charlatanisme et, par-dessus tout, satisfaction béate d’un apothicaire de province ; telle est la mixture qui forme l’âme d’un menchevik géorgien.
Les mencheviks géorgiens acclamèrent avec enthousiasme les quatorze points de Wilson. Ils acclamèrent la création de la Société des Nations. Auparavant, ils avaient acclamé l’entrée des troupes du kaiser en Géorgie. Puis ils avaient acclamé leur départ. Ils acclamèrent l’arrivée des troupes anglaises. Ils acclamèrent la déclaration amicale de l’amiral français. Ils acclamèrent, il va de soi, Kautsky, Vandervelde, Mrs. Snowden et sont prêts, à chaque instant, à acclamer l’archevêque de Cantorbéry si celui-ci veut bien « se fendre » de quelques nouvelles malédictions à l’adresse des bolcheviks. C’est de cette façon que ces messieurs démontrent qu’ils sont les enfants véritables de la « civilisation européenne ».
Le mémorandum présenté par la délégation géorgienne à la Société des Nations à Genève nous dévoile, d’une façon saisissante, l’essence du menchevisme géorgien.
« Rangé sous le drapeau de la démocratie occidentale — est-il dit dans la conclusion du mémorandum — le peuple géorgien, tout naturellement, ressent une sympathie exclusive pour Vidée de la formation d’un système politique, qui, conséquence directe de la guerre, sert en même temps de moyen pour paralyser la possibilité de nouvelles guerres dans l’avenir. La Société des Nations, qui incarne ce système, représente, par la fécondité de ses résultats, l’acquisition la plus remarquable de l’humanité dans sa voie vers l’unité future. Priant de l’admettre dans la Société des Nations… le gouvernement géorgien estime que les principes mêmes appelés à régler la vie internationale dirigée désormais vers la solidarité et la collaboration, exigent l’admission dans la famille des peuples libres européens du peuple antique qui fut autrefois l’avant-garde du christianisme en Orient et qui est devenu maintenant l’avant-garde de la démocratie, du peuple qui n’aspire qu’au travail libre, opiniâtre, dans la maison qui est son héritage légitime et incontestable. »
Après cela, il n’y a plus qu’à tirer l’échelle. Voilà un document classique de la bassesse. Il peut servir de critérium sûr ; le socialiste chez lequel ce mémorandum ne provoquera pas un haut-le-cœur doit être exclu ignominieusement et pour toujours du mouvement ouvrier.
La conclusion principale que Kautsky tire de son étude sur la Géorgie est que, contrairement à la Russie, avec ses fractions, ses scissions et ses luttes intestines, contrairement à tout ce monde coupable, qui sous ce rapport ne vaut pas mieux que la Russie, c’est dans les montagnes de la Géorgie seulement qu’il a trouvé le règne du marxisme véritable, du marxisme authentique. Pourtant, Kautsky ne cache pas qu’il n’y a, en Géorgie, ni grande ni moyenne industrie et, par suite, pas de prolétariat au sens actuel du mot. La grande masse des députés mencheviks de l’Assemblée Constituante géorgienne était composée de professeurs, de médecins, d’employés. La masse des électeurs était représentée par les paysans. Néanmoins, Kautsky ne se donne pas la peine d’expliquer ce prodige historique, lui, qui, avec tous les mencheviks, nous accuse de représenter les côtés arriérés de la Russie comme des supériorités, découvre le modèle idéal de la social-démocratie dans le coin le plus retardataire de l’ancienne Russie. En réalité, si le « marxisme » en Géorgie n’a pas connu les scissions et une lutte de fraction aussi intense que dans les autres pays moins favorisés, cela prouve uniquement que le milieu social y était plus primitif, le processus de différenciation de la démocratie bourgeoise et de la démocratie prolétarienne y étant considérablement en retard, et, par suite, que le menchevisme géorgien n’avait rien de commun avec le marxisme. Au lieu de répondre à ces questions fondamentales, Kautsky déclare du haut de sa grandeur qu’il connaissait déjà les vérités du marxisme, alors ¦ que beaucoup d’entre nous n’étaient encore qu’au berceau. Nous ne chercherons pas à contester à Kautsky cette supériorité. Le sage Nestor — celui de Shakespeare et non celui d’Homère — se considérait comme supérieur à son ennemi plus jeune que lui parce que la femme qu’il aimait avait été autrefois plus belle que la grand-mère de ce dernier. Chacun se console comme il peut. Mais peut-être est-ce parce que Kautsky a, depuis trop longtemps, étudié l’alphabet du socialisme qu’il n’a pas su, quand il s’agissait de la Géorgie, en lire les premières lettres. Pour lui la stabilité et la durée relatives de la domination du menchevisme géorgien sont le fruit d’une sagesse tactique supérieure ; il ne voit pas qu’elles s’expliquent par le fait que l’ère du socialisme révolutionnaire pour la Géorgie arriérée a commencé plus tard que pour les autres parties de l’ancienne Russie. Profondément blessé par le cours de l’histoire, Karl Kautsky, aux derniers jours de l’ère menchevique, est arrivé à Tiflis pour y apaiser sa soif spirituelle. Trois quarts de siècle après que Marx et Engels avaient écrit leur Manifeste, Mrs. Snowden s’est empressée également d’y courir pour aérer son bagage spirituel. La chose, en effet, s’imposait. L’Évangile de Jordania est raisonnable, organique, véritablement dans l’esprit « fabien » ; il va du roi géorgien Vakhtanga à M. Huysmans ; il a été créé par le ciel lui-même pour la satisfaction des besoins les plus nobles du socialisme britannique.
Que la bêtise est vivace, lorsqu’elle a des racines sociales !