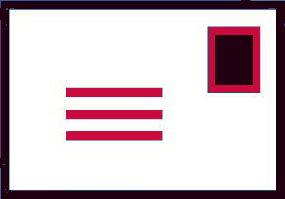Ce
sont sans doute les analyses de Trotsky sur le nazisme et les
perspectives mondiales ouvertes par sa victoire en Allemagne qui lui
ont valu cette réputation de prophète qui explique la
présence de ce terme dans plusieurs ouvrages consacrés
à lui-même ou à ses disciples. Nous croyons avoir
montré que, s'il a fait très souvent des prédictions
qui se sont révélées correctes, et sur des
questions importantes, il n'en a pas moins commis un certain nombre
d'erreurs de prévision. Ces données, et la façon
dont il concevait son activité intellectuelle, celle d'un
militant qui tentait de faciliter l'action pour changer le monde,
interdisent de lui reconnaître la qualité de prophète.
Sous
cet angle, il y a quelque logique chez les commentateurs de Trotsky
et une certaine cohérence dans le fait que des hommes
d'orientations aussi différentes que Boris Souvarine et Isaac
Deutscher se soient en définitive trouvés d'accord pour
déplorer que Trotsky ait cru devoir poursuivre son action
militante au niveau des « groupuscules », au
lieu de se consacrer à l'observation, au commentaire et... aux
prophéties.
Aurait-il
dû, comme finalement Marx et Engels l'avaient plus ou moins
fait pendant un temps, se retirer dans le « royaume des
idées » et y travailler non pas pour l'immédiat,
mais pour l'avenir lointain et les générations
futures ? Je pense que ce n'est pas le rôle d'un biographe
que de répondre à une telle question, mais seulement de
prendre acte de ce que son personnage rejetait catégoriquement
une telle possibilité et qu'il a voulu rester jusqu'au bout
sur le terrain du militant, y compris pendant la période de
Prinkipo.
Trotsky,
en tout cas, n'était pas en dehors de son siècle quand
il écrivait dans son asile turc un article d'analyse intitulé
« Qu'est-ce que le national-socialisme2 »
qui permet de mesurer, mieux que tout autre peut-être, en quoi
Trotsky se révéla « prophète »
et en quoi le prophète fut démenti par le développement
historique.
Achevée
le 10 juin 1933, dans les derniers jours du séjour à
Prinkipo, cette étude esquisse un tableau de la réalité
du national-socialisme et de ses conséquences dont aucun
contemporain n'a produit l'équivalent, bien que Trotsky n'ait
pas eu à l'époque la possibilité d'observer de
près la vie dans les villes et les campagnes allemandes3…
Il
part des conditions générales, le développement
rapide et tardif de l'impérialisme allemand, le mur dressé
par la défaite de 1918 devant son expansion, le chaos de
l'après-guerre qui frappe la petite bourgeoisie au même
titre que le prolétariat et démolit du même coup
croyances officielles et « illusions démocratiques ».
Il est l'un des premiers à voir en Allemagne ce qu'Antonio
Gramsci appelait en Italie « la révolte des
singes », l'insurrection de la petite-bourgeoisie :
« Dans l'atmosphère
chauffée à blanc par la guerre, la défaite, les
réparations, l'inflation, l'occupation de la Ruhr, la crise,
le besoin et la rancune, la petite-bourgeoisie se rebella contre tous
les vieux partis qui l'avaient trompée4. »
Il
saisit parfaitement les hommes qui ont levé le drapeau de
cette rébellion, ce type humain fabriqué par la guerre,
et explique :
« Le drapeau du
national-socialisme fut brandi par des hommes issus des cadres moyens
et subalternes de l'ancienne armée. Couverts de décorations,
les officiers et les sous-officiers ne pouvaient admettre que leur
héroïsme et leurs souffrances aient été
perdus pour la patrie et surtout qu'ils ne leur donnent aucun droit
particulier à la reconnaissance du pays. D'où leur
haine pour la révolution et pour le prolétariat. Ils ne
voulaient pas prendre leur parti du fait que les banquiers, les
industriels, les ministres, les reléguaient à des
postes insignifiants de comptables, d'ingénieurs, d'employés
de postes et d'instituteurs. D'où leur "socialisme".
Pendant les batailles de l'Yser et de Verdun, ils ont appris à
risquer leur vie et celle des autres, et à parler la langue du
commandement qui en impose tant aux gens de l'arrière. C'est
ainsi que ces hommes sont devenus des chefs5. »
Parmi
ces hommes, Adolf Hitler ne se distinguait « peut-être
que par un tempérament plus énergique, une voix plus
forte, une étroitesse d'esprit plus sûre d'elle-même.
[...] On trouvait dans ce pays suffisamment de gens qui se ruinaient,
qui se noyaient, qui étaient couverts de cicatrices et
d'ecchymoses encore toutes fraîches. Chacun d'eux voulait
frapper du poing sur la table. Hitler le faisait mieux que les
autres ». Le chef nazi s'est ainsi formé, à
l'écoute et à la remorque de ses auditoires enragés :
« De ses premières
improvisations, l'agitateur ne conservait dans sa mémoire que
ce qui rencontrait l'approbation. Ses idées politiques étaient
le fruit d'une acoustique oratoire. C'est ainsi qu'il choisissait ses
mots d'ordre. C'est ainsi que son programme s'étoffait. C'est
ainsi que d'un matériau brut se formait un chef6. »
Au
moment où les nazis vainqueurs dansent la joie de leur
victoire autour des brasiers qui consument des livres dans les rues
des villes allemandes, Trotsky poursuit :
« Les bûchers, sur
lesquels brûle la littérature impie du marxisme,
éclairent vivement la nature de classe du national-socialisme.
Tant que les nazis agissaient en tant que parti et non en tant que
pouvoir d'État. l'accès à la classe ouvrière
leur était presque entièrement fermé. D'autre
part, la grande bourgeoisie, même celle qui soutenait
financièrement Hitler, ne les considérait pas comme son
parti. La "renaissance" nationale s'appuyait entièrement
sur les classes moyennes - la partie la plus arriérée
de la nation, fardeau pesant de l'histoire. L'habileté
politique consistait à souder l'unité de la
petite-bourgeoisie par la haine contre le prolétariat. Que
faut-il faire pour faire mieux ? Avant tout, écraser ceux
qui sont en bas. La petite-bourgeoisie, impuissante face au grand
capital, espère désormais reconquérir sa dignité
sociale en écrasant les ouvriers7. »
Trotsky
s'attache ensuite à démontrer le caractère
réactionnaire, au sens littéral du terme, du
national-socialisme, calqué sur les aspirations de la
petite-bourgeoisie. Hostiles au développement économique
comme au matérialisme, qui ont entraîné la
victoire du grand capital sur le petit, les chefs du mouvement s'en
prennent à ce qu'ils appellent
« l'intellectualisme »,
par refus d'admettre qu'une pensée « soit poussée
jusqu'à son terme » :
« Le petit-bourgeois
a besoin
d'une instance supérieure, placée au-dessus de la
matière et de l'histoire, protégée de la
concurrence, de l'inflation, de la crise et de la vente aux enchères.
Au développement, à la pensée économique,
au rationalisme - aux XXe, XIXe
et XVIIIe
siècles s'opposent l'idéologie nationaliste, en tant
que source du principe héroïque. La nation de Hitler est
l'ombre mythique de la petite-bourgeoisie elle-même. son rêve
pathétique d'un royaume millénaire sur la terre8. »
C'est
ici qu'intervient « la race », moyen d'élever
la nation au-dessus de l'histoire, puisque ses qualités sont
indépendantes des conditions sociales, changeant avec
l'histoire. Trotsky a cette formule :
« Rejetant la
"pensée
économique" comme vile, le national-socialisme descend un
étage plus bas : du matérialisme économique,
il passe au matérialisme zoologique9. »
C'est
avec une particulière âpreté qu'il souligne que
la faiblesse insigne de la théorie de la race,
particulièrement « lamentable à la lumière
de l'histoire des idées », n'a pas empêché
le ralliement de la science universitaire et de ce qu'il appelle
« la
racaille professorale ». Et de rappeler qu'Einstein a dû
chercher refuge ailleurs...
« Sur le plan
politique,
assure-t-il, le racisme est une variété hypertrophiée
et vantarde du chauvinisme associé à la phrénologie.
[... ] Il a fallu l'école de l'agitation nationaliste barbare
aux confins de la culture pour inspirer aux "chefs" les
idées qui ont trouvé par la suite un écho dans
le cœur des classes les plus barbares de l'Allemagne10. »
L'analyse
de la politique économique du nazisme permet à Trotsky
de démontrer que, selon sa formule, « le racisme,
débarrassé des libertés politiques, revient au
libéralisme économique par la porte de derrière11 ».
La chasse au capital usurier et bancaire permet de faire la jonction
entre le racisme et la « théorie
économique » :
« Le pogrom devient la preuve supérieure de la
supériorité raciale12. »
Tout
le talent d'écrivain et d'analyste de Trotsky se trouve dans
ce résumé du programme du national-socialisme dans sa
marche au pouvoir :
« Des souvenirs sur
le "temps
heureux" de la libre concurrence et des légendes sur la
solidité de la société divisée en états ;
des espoirs de renaissance de l'empire colonial et des rêves
d'économie fermée ; des phrases sur l'abandon du
droit romain et le retour au droit germanique et des proclamations
sur le moratoire américain ; une hostilité
envieuse pour l'inégalité que symbolisent l'hôtel
particulier et l'automobile et une peur animale devant l'égalité,
sous l'aspect de l'ouvrier en casquette et sans col ; le
déchaînement du nationalisme et sa peur devant les
créanciers mondiaux... Tous les déchets de la pensée
politique internationale sont venus remplir le trésor
intellectuel du nouveau messianisme allemand13. »
Le
pamphlétaire se déchaîne devant l'arrivée
au premier plan de la politique, dans le sillage du fascisme, de ce
qu'il appelle « les bas-fonds de la société »
avec ses « réserves inépuisables
d'obscurantisme, d'ignorance et de barbarie » à qui
le fascisme a donné un drapeau. Il conclut sur ce point :
« Tout ce qu'un
développement
sans obstacle de la société aurait dû rejeter de
l'organisme national sous la forme d'excréments de la culture
est maintenant vomi : la civilisation capitaliste vomit une
barbarie non digérée. Telle est la physiologie du
national-socialisme14. »
Les
quelques mois de pouvoir du nazisme ont cependant révélé
selon lui, de façon indiscutable, que le fascisme au pouvoir
« n'est rien moins que le gouvernement de la
petite-bourgeoisie », qu'il est au contraire « la
dictature la plus impitoyable du capitalisme monopoliste ».
C'est là-dessus qu'il conclut :
« La concentration
forcée
de tous les forces et moyens du peuple dans l'intérêt de
l'impérialisme, qui est la véritable mission historique
de la dictature fasciste, implique la préparation de la
guerre ; ce but, à son tour, ne tolère aucune
résistance intérieure et conduit à une
concentration mécanique ultérieure du pouvoir. Il est
impossible de réformer le fascisme ou de lui donner son congé.
On ne peut que le renverser. L'orbite politique du régime nazi
bute contre l'alternative : la guerre ou la révolution15 ? »
Le
2 novembre, dans un post-scriptum, il complète le texte daté
du 10 juin :
« Le temps nécessaire
à
l'armement de l'Allemagne détermine le délai qui sépare
d'une nouvelle catastrophe européenne. Il ne s'agit pas de
mois, ni de décennies. Quelques années suffisent pour
que l'Europe se retrouve de nouveau plongée dans la guerre16… »
A
qui n'a jamais été tenté de qualifier Trotsky de
« prophète », il paraît surprenant
qu'il ne lui ait pas été donné acte de cette
prophétie sur un point, particulier certes, mais intéressant
l'ensemble de l'humanité, et même un peu scandaleux que
des commentateurs s'empressent de démontrer qu'il s'est trompé
en prévoyant la révolution, alors que s'est
malheureusement réalisée la possibilité qu'il
lui opposait dans l'alternative historique : la Seconde Guerre
mondiale.
Sans
doute est-ce à ce moment de la réflexion qu'il importe
de se souvenir de la formule de Spinoza, si souvent citée par
Trotsky : « Ni rire ni pleurer, mais
comprendre. »
Il
ne nous paraît pas en effet que ce soit un hasard si, de même
que l'historiographie passe sous silence la « révolution
manquée » d'Allemagne en 1923, sans même en
discuter, elle est non moins avare d'éléments sur
l'analyse et les perspectives du nazisme par Trotsky.
Des
auteurs comme Kater, Hamilton, Turner, présentés
aujourd'hui aux Etats-Unis comme les rénovateurs de l'histoire
du nazisme, polémiquent pendant des pages contre une
interprétation du nazisme qu'ils baptisent
« marxiste »
et qui est en réalité une conception mécaniste
du national-socialisme manipulé par le Grand Capital et
instrument docile de sa politique17.
Mais les mêmes auteurs ne daignent pas accorder une mention à
la seule analyse contemporaine qui ait survécu au temps et qui
survivra même à leurs découvertes !
Laissons
de côté les auteurs, universitaires ou non, qui,
écrivant avant l'ère Gorbatchev, n'osent pas dépasser
l'horizon d'alors des censeurs de Moscou. Mais que penser de ce
spécialiste de qualité qui, dans un ouvrage consacré
aux interprétations du nazisme, explique que Trotsky
« n'envisage le fascisme allemand que comme exemple
typique des erreurs des staliniens, dont la plus grave à ses
yeux est la sous-estimation de l'adversaire18 » ?
Comment interpréter cette unique allusion à Trotsky,
dans un ouvrage qui affirme par-dessus le marché que Daniel
Guérin, disciple de Trotsky (sic), "reprit et
amplifia" ses remarques19 ?
La censure décidée en ces années lointaines par
Joseph Staline continue à exercer aujourd'hui ses effets sur
des hommes qui n'en ont même pas conscience et s'en défendront
en toute bonne foi. Mais qu'ont-ils lu, et comment ?
On
pourrait faire les mêmes remarques à propos du bloc des
oppositions de 1932 que d'autres chercheurs ont aperçu sans le
reconnaître, faute d'un outil chronologique suffisant ou du
fait de préjugés solides et d'idées préconçues.
Comment expliquer la difficulté à donner à cette
découverte la publicité qu'elle méritait ?
Le premier écho à l'article de 1980 où je
mentionnais le bloc et reproduisais les documents qui l'attestent20
est de l'Américain Arch J. Getty et date de 198521.
L'affaire
du bloc des oppositions a déjà commencé pourtant
à commander une révision des histoires classiques de la
Russie soviétique. Elle modifie passablement en effet l'image
pathologique de Staline comme clé du développement et
nous ramène aux difficultés économiques, aux
conflits sociaux et politiques, à la lutte pour le pouvoir, au
lieu de la seule soif de sang du « tyran ». Et
cela n'enlève rien à la paranoïa du dictateur
telle qu'il l'a manifestée à travers la sauvagerie de
la répression qu'il a déchaînée contre son
propre peuple, méritant ainsi la comparaison que fait Trotsky
avec Néron.
Ces
réflexions ramènent irrésistiblement au thème
formulé pour la première fois sous forme de critique
voilée par Boris Souvarine dans sa correspondance avec Trotsky
en 1929 et reprise plus ou moins consciemment par nombre d'auteurs.
Il écrivait en effet le 8 juin 1929 :
« Savoir attendre est
aussi
nécessaire que pouvoir combattre et il est même possible
de se taire sans perdre la faculté d'agir, comme on peut se
donner l'illusion de l'action en s'épuisant en paroles22. »
Vingt
ans après ces affirmations de Souvarine, Deutscher assurait
que « la force durable » de Trotsky se trouvait
désormais dans « le royaume des idées
théoriques » et que « sa passion de
l'action était maintenant sa faiblesse23 ».
De
telles formulations sont acceptables pour des couches et milieux
divers, même quand elles ne correspondent pas à la
vérité historique. La volonté de
« marginaliser » Trotsky était celle de
forces sociales et politiques dont l'appareil stalinien n'était
que la plus visible. Et leur pression était suffisante pour
convaincre bien des auteurs. Le conservatisme d'écrivains qui
se répètent les uns les autres, le souci de n'être
pas étiqueté comme « trotskyste »
par les critiques et dans les comptes rendus, celui d'avoir accès
au « grand public » et aux gros tirages, la
paresse intellectuelle - s'agit-il seulement de cela ?
On
approcherait certainement d'une réponse juste en étudiant
avec attention les opinions exprimées au cours de ces années
au sujet de Trotsky par quelques-uns des représentants les
plus autorisés des classes dirigeantes de la vieille Europe.
Aucun auteur n'a, par exemple, manifesté contre Trotsky plus
de haine ou de mauvaise foi, accumulé d'injures plus
venimeuses et d'accusations plus basses que Winston Churchill, lequel
n'a jamais dissimulé ses préférences en matière
de « choix de société » et de
maintien de « l'ordre impérial », et
n'avait pas l'habitude d'être fair play avec ses
ennemis
de classe.
Les
âmes conformistes seraient-elles choquées que j'écrive
ici qu'au fond Churchill, Staline et Hitler coïncidaient dans
leur haine de Trotsky et leur désir de le réduire à
l'impuissance ? On peut leur concéder que chacun l'a fait
à sa manière. Il reste que les grands du monde, devenu
« planète sans visa » pour l'illustre
exilé, ont pesé de toute leur influence pour donner de
lui une appréciation qu'il ne faudrait surtout pas confondre
avec le jugement de l'Histoire. Et qu'un Trotsky qui aurait accepté
de se taire et d'attendre, pour se réfugier dans le royaume
des idées, n'aurait plus été Trotsky.
*
* *
Que
signifie pour Trotsky en juillet 1933 son départ pour la
France, l'un des pays qu'il chérit le plus ? Le visa
obtenu grâce à Parijanine et Guernut est sans doute une
magnifique et excellente surprise qui explique partiellement
l'allégresse relevée dans le ton de l'article écrit
sur le bateau, malgré la souffrance que lui vaut un lumbago
très douloureux.
Les
pages de son Journal qui traitent du départ de
Prinkipo
laissent percer une pointe de regret très humaine. Mais
Trotsky n'a pas attendu vingt-quatre heures pour organiser son
départ. Le gouvernement français ne lui a finalement
posé aucune condition d'ordre géographique pour sa
résidence, et il a notamment abandonné la solution un
instant envisagée de lui accorder l'asile... en Corse. Pour
l'exilé, cela signifie la possibilité de jouir d'une
grande liberté de mouvement.
Bien
entendu, cela veut dire aussi qu'il lui faudra prendre toutes les
précautions nécessaires pour se protéger de la
surveillance et des attentions du G.P.U. Mais il pense avoir enfin la
possibilité de rencontrer des camarades, connus ou inconnus,
jeunes ou vieux, et de participer directement à la tâche
qu'il vient de déterminer, la préparation de la IVe
Internationale, à laquelle, évidemment, sa contribution
personnelle peut être tout à fait décisive du
fait du prestige qu'il a conservé aux yeux de tant de
militants. Du séjour en France, il attend donc la possibilité
d'agir autrement que par sa plume et c'est sans doute à ses
yeux un acquis extrêmement important.
Le
passeport dont il est muni indique qu'il exerce la profession
d'écrivain. C'est en tout cas de ses droits d'auteur qu'il
tire ses revenus depuis son exil. Le grand élan qui l'a
conduit à écrire coup sur coup Ma Vie et
l'Histoire de la Révolution russe s'est
momentanément
interrompu. A la fin de 1932 et au début de 1933, il a
différents projets : un travail sur la situation
économique mondiale, un ouvrage qu'il voudrait appeler Le
Roman d'une amitié, sur les relations entre Marx et
Engels, une Histoire de l'Armée rouge devenue
ensuite
un projet d'Histoire
de la
Guerre civile. Il a préparé des dossiers, mais
encore rien engagé sérieusement.
En
d'autres temps, le voyage vers la côte française de la
Méditerranée aurait été une véritable
fête, et l'un de ses premiers soucis aurait été
de rencontrer les Rosmer. Ce n'est plus possible désormais :
le silence s'est installé entre eux, même si Marguerite
a écrit une lettre affectueuse - restée sans réponse
- après la mort de Zina. En France cependant, il y a Ljova,
qu'il a revu en novembre, dans le train, en traversant ce pays au
cours du voyage de retour de Copenhague, après une longue
séparation de plus de vingt-deux mois. La perspective de
retrouver, comme il dit, l'un des siens, l'emplit
de joie. Il
va retrouver aussi les hommes et les femmes qui lui ont rendu visite
à Prinkipo : Pierre et Denise Naville, Gérard
Rosenthal, Raymond Molinier, Pierre Frank, ceux aussi, moins
familiers, qu'il a connus à Copenhague. Il va rejoindre Jan
Frankel et Otto Schüssler, tous deux réfugiés en
France, après un bref séjour clandestin en Allemagne
nazie. Il pense aussi qu'il va être amené à
rencontrer quelques-unes de ses connaissances de l'époque des
congrès de l'Internationale communiste, que ses camarades
fréquentent dans le cadre des perspectives de regroupement,
parmi lesquelles, Jakob Walcher, son informateur de 1923, Sneevliet,
qu'il a combattu sous le nom de Maring, à propos de l'entrée
du P.C. chinois dans le Guomindang, un des deux hommes qu'il tutoie,
l'autre étant Rakovsky. Il va connaître, pour la
première fois, nombre de ses correspondants, militants, mais
aussi écrivains et journalistes. Il se déplace avec ses
collaborateurs, Van, Rudolf Klement, Sara Weber qui tous, dans un
premier temps, resteront autour de lui.
Nous
l'avons relevé, l'homme qui quitte Prinkipo n'est plus tout à
fait celui qui y est arrivé quatre années auparavant.
La mort de Zina, après celle de Nina, lui a porté un
coup d'autant plus rude qu'il ne peut pas ne pas mesurer sa propre
responsabilité dans cette tragédie. Il porte aussi sur
ses épaules la tragédie allemande, l'horreur des récits
qui lui parviennent sur les violences et la brutalité des
S.A., les tortures infligées aux militants... La séparation
d'avec sa famille et ses amis d'Union soviétique pèse
d'un poids particulièrement lourd. Son angoisse s'exprime à
travers les revendications réitérées qu'il
présente pour avoir des nouvelles de Rakovsky. Khristian
Georgévitch a disparu de Barnaoul, et son beau-fils, le
docteur Codreanu, qui poursuit ses études à Paris, n'a
plus aucune nouvelle de lui. Des informations d'origines diverses
assurent qu'il aurait été transféré à
Moscou et hospitalisé. Une source oppositionnelle parle de sa
mort ; on murmurera ensuite qu'il a tenté de s'évader
par la Chine, a été repris et blessé. Les
autorités soviétiques lâchent qu'il exerce la
médecine en Yakoutie. Au mois de mai, lors d'une escale, à
Istanbul, du Jean Jaurès où Maxime Gorky se
repose, Trotsky envoie Van et Pierre Frank à bord du bateau
pour réclamer des nouvelles de son ami. Le fils de Gorky les
reçoit poliment, assure que son père ne sait rien24.
Personne ne saura - ou tout au moins ne dira - la vérité
sur cet épisode de la vie de Rakovsky, que Trotsky mentionne à
l'époque aussi souvent que possible.
Trotsky
a maintenant cinquante-quatre ans. Il se plaint de vieillir, de
perdre le sommeil et d'avoir besoin de somnifères. Il souffre
tout particulièrement de perdre la mémoire des visages
connus. Il va écrire à Natalia cette phrase
déchirante :
« La jeunesse s'est
enfuie
depuis longtemps... mais j'ai remarqué soudain que le souvenir
même que j'en avais s'est enfui, le souvenir vivant des
visages25… »
Il
sait que les années de persécution pèsent sur
son système nerveux et sa mémoire. Mais il s'en
console :
« En même temps, je
ne
me sens ni fatigué ni affaibli mentalement. Certes le cerveau
est devenu parcimonieux, économe ; et il écarte le
passé pour venir à bout des nouvelles tâches26… »
Pourtant,
bientôt, le médecin - un bon camarade venu de
Tchécoslovaquie le docteur Breth, oncle de Kopp - va lui
conseiller « une manière de vie plus tranquille »,
la réduction des entretiens, des rendez-vous. Il se demande si
le sentiment de vieillesse qu'il éprouve est
« définitif »
ou temporaire, s'il connaîtra une remontée... jusqu'à
un certain point, s'empresse-t-il d'ajouter. Il a parfois le
sentiment, au milieu des jeunes qui l'entourent, d'être
vraiment « le Vieux » comme ils disent,
« sans
amertume, plutôt avec une certaine chaleur, légèrement
mêlée de tristesse27 ».
C'est
à l'occasion d'une absence de Natalia Ivanovna peu après
son arrivée en France, que nous avons eu connaissance de ces
confidences et des angoisses secrètes qu'elles trahissent.
Pour les autres, qu'il soit malade ou bien portant, L.D. est toujours
le devoir incarné du combattant révolutionnaire, sans
phrases ni emphase. Un cheminot français, qui le rencontre,
raconte :
« Il nous développa
sa
conception du nouveau parti et de la IVe Internationale. Je lui
posai la question :
- « En somme, vous
proposez de
tout recommencer ?
- C'est cela même »,
répondit-il. »
C'était
bien simple: « Tout recommencer28. »