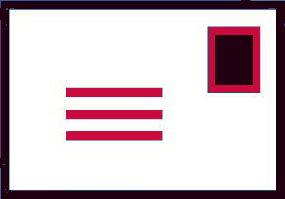Le prolétariat allemand
possédant la
conscience de classe (...) élève une protestation passionnée
contre cette machination criminelle des fauteurs de guerre. (...) Pas
une goutte du sang d'un seul soldat allemand ne doit être sacrifiée
à la soif de pouvoir des dirigeants autrichiens, au intérêts des
profits impérialistes.1
Pour notre peuple et son
développement
pacifique beaucoup, sinon tout, est en jeu dans l’éventualité
d’une victoire du despotisme russe (...). Il s'agit d’éloigner
ce danger, de sauvegarder la civilisation et l’indépendance de
notre pays. (...) Nous ne laisserons pas notre propre patrie en
difficulté à l’heure du danger.2
Dix
jours séparent ces deux déclarations du Parti Social-démocrate
Allemand, dix jours qui ont vu la menace autrichienne d’écraser la
Serbie se transformer en guerre mondiale, dix jours qui ont commencé
avec l’organisation par les sociaux-démocrates de 27 meetings
contre la guerre dans la seule ville de Berlin, et qui se sont
achevés avec la déclaration du vice-président du parti, Hugo
Haase, proclamant au Reichstag que son parti voterait les crédits de
guerre du gouvernement.
Haase
lui-même, ainsi que 13 autres des 92 députés du SPD au Reichstag,
s’était opposé, dans une réunion fermée de la direction du
parti, au vote des crédits de guerre. Mais leur conviction que le
SPD était l’organisation par excellence de la classe ouvrière les
conduisit à se comporter de façon disciplinée – et, dans le cas
de Haase, à aller jusqu’à lire la déclaration de la majorité.
Ce n’est qu’en novembre qu’un membre isolé du parti, Karl
Liebknecht, se décida à défier la discipline du parti et à
montrer publiquement qu’il existait une opposition à la guerre en
votant contre les crédits.
Hors
du parlement, ceux qui s’étaient entassés dans les meetings
contre la guerre furent, soit emportés par la vague de chauvinisme
exacerbé qui déferlait, soit relégués dans les marges de la vie
politique par son impact. Il régnait dans les rues une excitation
frénétique. La foule braillait des chants patriotiques. De folles
rumeurs étaient répandues par des groupes hystériques, qui
partaient à la chasse des « espions russes » ou des
« poseurs de bombes français ». Les jeunes gens
étaient
dévorés d’impatience de partir au front.
Les
rares socialistes qui persistaient à s’opposer à la guerre se
retrouvèrent isolés et pleins de confusion, ne sachant pas qui
était d’accord avec eux, ayant peur d’exprimer leur opinion dans
l’atmosphère de lynchage ambiante et face aux nouveaux décrets
relatifs aux paroles « séditieuses ». Dans les
organisations de la classe ouvrière, les éléments les plus
chauvins donnaient le ton. Le vote des crédits par le SPD fut
accompagné de la proclamation d’une « trêve sociale »
par les syndicats. La plupart de ceux qui avaient des doutes sur la
guerre les gardaient pour eux, ou tentaient de formuler une
distinction entre une guerre « de défense
nationale »,
qu’ils soutenaient, et des visées expansionnistes, auxquelles ils
s’opposaient. Ceux qui contrastaient le plus complètement avec le
bellicisme des dirigeants du SPD – Rosa Luxemburg, Clara Zetkin,
Karl Liebknecht, l’historien marxiste vieillissant Franz Mehring,
et une poignée d’autres – se retrouvaient sans partisans ou sans
moyens de faire connaître leur opinion.
Rosa Luxemburg et Clara Zetkin
souffrirent toutes deux d’une prostration nerveuse et furent à un
moment proches du suicide. Ensemble, elles essayèrent, les 2 et 3
août, d’organiser une agitation contre la guerre ; elles
contactèrent 20 membres du SPD dont les opinions radicales étaient
connues, mais elles n’obtinrent que le soutien de Liebknecht et de
Mehring. (...) Rosa envoya 300 télégrammes à des responsables
locaux qu’on pensait oppositionnels, leur demandant quelle était
leur attitude vis-à-vis du vote [au
Reichstag] et les invita à Berlin pour une conférence
urgente. Les résultats furent pitoyables. Seule Clara Zetkin
répondit immédiatement pour exprimer son soutien sans réserve.3
Ils
ne purent donner un avis public de leur opposition avant septembre –
et seulement un paragraphe dans un journal suisse, disant qu’il
existait une opposition qui ne pouvait faire connaître ses vues à
cause de la loi martiale. En Allemagne même, avant que Liebknecht ne
vote et ne s’exprime contre les crédits de guerre au début de
décembre, le point de vue révolutionnaire contre la guerre n’avait
pas été entendu en public :
Cette guerre (...) n'a pas
éclaté en
vue du bien-être du peuple allemand ou de tout autre peuple. Il
s'agit d'une guerre impérialiste, d'une guerre pour la domination
capitaliste du marché mondial (...) Le mot d'ordre allemand :
« Contre le tsarisme » tout comme le mot d'ordre
anglais
et français : « Contre le militarisme », a
servi de
moyen pour mettre en mouvement les instincts les plus nobles, les
traditions et les espérances révolutionnaires du peuple au profit
de la haine contre les peuples.4
La
voix de Liebknecht était isolée. Les rédacteurs en chef d’un ou
deux journaux sociaux-démocrates de province montrèrent une
certaine opposition à la guerre – et perdirent leur emploi.
Autrement, seule une poignée de socialistes se joignit à Luxemburg
et à Liebknecht. De plus, leurs partisans étaient décimés par
l’Etat : Rosa fut bientôt mise en prison, et Liebknecht
envoyé au front, bien qu’il eût plus de quarante ans, puis
emprisonné.
Mais
la guerre elle-même commençait à modifier le sentiment populaire.
Elle s’éternisait mois après mois, année après année. Les
soldats en permission ramenaient les histoires des horreurs de la
guerre de tranchées. L’enthousiasme des masses pour la guerre
commença à se dissiper.
Dès
1915, Rosa Luxemburg pouvait en effet écrire :
La scène a changé
fondamentalement. La
marche de six semaines sur Paris a pris les proportions d’un drame
mondial ; l’immense boucherie est devenue une affaire
quotidienne, épuisante et monotone, sans que la solution, dans
quelque sens que ce soit, ait progressé d’un pouce. La politique
bourgeoise est coincée, prise à son propre piège : on ne peut
plus se passer des esprits que l’on a évoqués.
Finie l’ivresse. Fini le
vacarme
patriotique dans les rues, la chasse aux automobiles en or ;
les
faux télégrammes successifs ; on ne parle plus de fontaines
contaminées par des bacilles du choléra. (...) finis les
débordements d’une foule qui flairait partout l’espion ;
finie la cohue tumultueuse dans les cafés où on était assourdi de
musique et de chants patriotiques…
Le spectacle est terminé.
(...)
L’allégresse bruyante des jeunes filles courant le long des
convois ne fait plus d’escorte aux trains de réservistes et ces
derniers ne saluent plus la foule en se penchant depuis les fenêtres
de leur wagon, un sourire joyeux aux lèvres ; silencieux, leur
carton sous le bras, ils trottinent dans les rues où une foule aux
visages chagrinés vaque à ses occupations quotidiennes.5
Il
n’y avait pas que l’enthousiasme qui était perdu. La guerre
détruisait les conditions même qui avait si longtemps permis
l’adaptation du mouvement ouvrier à l’Etat prussien.
L’impact économique et social de la
guerre
Lorsque
la guerre a commencé, les politiciens et les généraux des deux
camps pensaient qu’elle serait terminée en quelques mois.
Schlieffen, le premier chef d’état-major allemand, considérait
une guerre longue comme « inconcevable ».
Son successeur, Moltke, était un peu moins optimiste : il
n’excluait pas la « possibilité »
que la guerre dure deux ans. Tous les calculs économiques du
gouvernement tablaient sur une guerre de neuf mois.6
De telle sorte qu’aucun préparatif n’avait été fait pour
assumer le fardeau économique d’une guerre qui durait, consommant
une quantité inouïe de munitions, et dans laquelle chaque camp
recourait de plus à plus au blocus pour essayer de briser l’économie
de l’adversaire.
Les
problèmes liés à la guerre économique dans un conflit à
caractère « industriel » n’avaient même pas fait
l’objet d’un commencement d’anticipation.7
En
même temps que les armées ennemies étaient embourbées dans les
champs du nord de la France, l’économie allemande dans son
ensemble devait être mise à contribution pour alimenter la machine
de guerre. La première victime fut le niveau de vie des salariés.
Les approvisionnements alimentaires diminuèrent fortement, en partie
à cause du blocus, mais aussi, et surtout, à cause de la
conscription de la main d’œuvre agricole dans les forces armées.
A la fin de 1916, la ration de viande était tombée à moins du
tiers de la moyenne d’avant-guerre, les œufs à un cinquième, la
ration de pain à près de la moitié, et le lait ne pouvait plus
être obtenu qu’au marché noir. La ration hebdomadaire de la
plupart des travailleurs était limitée à quatre livres de pain,
cent grammes de beurre et une demie livre de viande. Sa valeur
calorique – 1 313 - était égale à la moitié des besoins
normaux d’un adulte.
On
toucha le fond pendant l’hiver 1916-17, quand l’approvisionnement
des villes fut interrompu. Pendant « l’hiver des
navets »,
les éléments de base de l’alimentation furent remplacés – par
du pain de navet, de la confiture de navet, et même du café de
navet. La faim frappait la plupart des quartiers ouvriers. Dans son
sillage, la moindre épidémie faisait des ravages : la ville de
Hamborn connut 854 cas de typhus en 1917.
En
quelques mois, la vie de la classe ouvrière allemande fut
transformée. Quarante ans de lente amélioration avaient cédé la
place à une détérioration cauchemardesque.
Ce
n’était pas seulement les conditions matérielles qui avaient
souffert. Des millions de travailleurs avaient été, bien sûr,
envoyés au front. Ceux qui restaient dans les villes découvrirent
que les maigres droits civiques qui avaient été arrachés à l’Etat
dans les décennies passées avaient disparu du fait des règlements
du temps de guerre relatifs à la sédition. Une Loi
sur sur le service patriotique
(« Hilfdienstgesetz »)
votée fin 1916
organisait la conscription industrielle des travailleurs de sexe
masculin, les liait à leurs employeurs et les soumettait aux
juridictions militaires. Les cercles conservateurs et les industriels
accueillirent la loi comme le premier pas vers une dictature
militaire directe des nouveaux chefs des forces armées, Hindenburg
et Ludendorff.
La
structure même de la vie quotidienne fut transformée par la guerre.
Comme des millions d’hommes étaient dans l’armée, ils furent
remplacés dans les usines par des femmes, de telle sorte qu’en
1916 la force de travail industrielle était constituée de 4,3
millions de femmes et de 4,7 millions d’hommes8.
Le gouvernement décida qu’il n’y avait pas besoin d’imposer la
conscription industrielle aux femmes, dans la mesure où la faim les
poussait de toute manière à chercher du travail. Dans les mines et
les aciéries de la Ruhr, les déportés étrangers et les
prisonniers de guerre en vinrent à former un cinquième ou même un
quart de la force de travail.
L’effet
immédiat de ces changements fut d’accroître la confusion dans la
classe ouvrière et d’affaiblir son organisation interne. En même
temps que les vieux militants (pas moins des trois quarts des membres
masculins du SPD) étaient envoyés au front et remplacés par des
travailleurs nouveaux et inexpérimentés, les effectifs des
organisations social-démocrates et des syndicats tombèrent de plus
d'une moitié9.
La tâche de ceux qui voulaient argumenter contre la guerre dans ces
organisations était très difficile, même après la retombée de
l’enthousiasme guerrier des premiers temps.
Mais
l’effet cumulatif de l’économie de guerre était de créer un
potentiel plus grand que jamais pour l’organisation de la classe
ouvrière. L’Allemagne de 1914 était encore, selon les critères
d’aujourd’hui, un pays où les usines étaient relativement
petites et la production relativement sous-développée. Désormais,
les décrets gouvernementaux fermaient les petites usines et
concentraient la production dans des installations modernes plus
grandes et plus efficaces. Dans une usine après après l'autre, les
techniques que nous associons à la production de masse – la
division des tâches individuelles « qualifiées » en
une
multiplicité de tâches « spécialisées » – devinrent
la norme pour la première fois.
La
cheville ouvrière de la social-démocratie d’avant-guerre avait
été en grande partie les travailleurs qualifiés dans des
industries comme la métallurgie, où les syndicats étaient les plus
forts. Par dessus tout, leur expérience dans l’obtention
d’augmentations de salaire avait fourni la base matérielle du
réformisme dans la pratique de la social-démocratie. Désormais, à
l’intérieur de l’usine les travailleurs qualifiés étaient
menacés par de nouvelles formes de discipline industrielle, même
s’ils étaient les mieux placés pour éviter le front du fait de
leur importance pour l’industrie de guerre. De plus, ils
ressentirent vraiment l’impact de la guerre sur le niveau de vie.
Jusqu’en 1914, du fait de barèmes différentiels, leur vie était
plus facile que celle des ouvriers non qualifiés. Maintenant tous
les ouvriers étaient réduits à la ration minimale nécessaire à
la survie physique10.
La
guerre avait détruit beaucoup des liens qui avaient uni les
travailleurs organisés, mais en même temps elle concentrait la
classe ouvrière dans des unités de production de plus en plus
grandes, créant une nouvelle uniformité de conditions d’existence
pour la classe. Si l’effet immédiat était de rendre
l’organisation contre la guerre pratiquement impossible, l’effet
à long terme était de créer une nouvelle base pour l’organisation
révolutionnaire, à la fois dans les secteurs traditionnellement
influencés par la social-démocratie et dans des secteurs nouveaux,
à l’écart de son influence.
Les premières secousses
Pour
une minorité de travailleurs, la perte d’enthousiasme pour la
guerre commençait à se transformer en colère face à ses
résultats.
Durant
l’année 1915,
il y eut à
nouveau des manifestations dans les rues. Mais ce n’était plus les
défilés patriotiques comme en août 1914. (...) L'enthousiasme
s’était évaporé. On ne cherchait plus d'espions, mais du pain.
Ici et là la faim poussait les masses, en particulier les femmes,
dans la rue. (...) Au cours de l’année il y eut à Berlin quelques
manifestations pour la paix, auxquelles d'abord quelques centaines de
participants, puis quelques milliers de personnes participèrent.
Mais ces nombres relativement modestes à cette époque, alors que
chacun subissait le joug de la dictature militaire, avaient une
signification immense.11
Certaines
manifestations étaient des explosions plus ou moins spontanées de
la part de groupes inorganisés, le plus souvent des femmes :
la
colère éclatait lorsqu’un magasin n’avait plus de nourriture,
ou augmentait ses prix, ou lorsque les rationnements étaient
brusquement réduits. Il y eut une vague de
« manifestations »
de ce type pendant l’hiver 1915-16, et à nouveau l’hiver
suivant, qui menaient souvent à des affrontements entre des
travailleurs « apolitiques » et la police.
Mais
il y avait aussi des manifestations plus ouvertement politiques. Le
changement dans le sentiment populaire donnait un courage nouveau à
ceux qui s’étaient opposés à la guerre au sein de la
social-démocratie. Dans des réunions du SPD, certains exigeaient
que leur député au Reichstag vote contre les crédits de guerre et
que le journal local lance la discussion sur la guerre. Par exemple,
à Brême en 1915 la gauche ne comptait que 15 personnes et ne tenait
que des discussions privées. Pendant l’hiver de 1915-16 il y avait
des assemblées générales du parti local, réunissant jusqu’à
1 100 participants (le quart des effectifs totaux), où des
opinions sur la guerre étaient ouvertement exprimées12.
A Berlin, la gauche était assez forte pour que le groupe de
Luxemburg et Liebknecht, l’Internationale, puisse appeler à une
manifestation le Premier Mai 1916 : Liebknecht fut arrêté
alors qu’il commençait à parler à plusieurs milliers de
travailleurs et de jeunes gens. Le jour de son procès, 55 000
travailleurs se mirent en grève de solidarité. Désormais
Liebknecht n’était plus une voix solitaire, y compris au
Reichstag : en décembre 1915, 19 autres députés le
rejoignirent dans l’opposition aux crédits de guerre.
Le
sentiment antiguerre fut renforcé par le fait que les cercles
militaires et industriels faisaient de moins en moins mystère de
leurs buts de guerre. La préservation des anciennes frontières de
l’Allemagne n’était plus de nature à les satisfaire. Ils
exigeaient l’incorporation dans le Reich de la Belgique et du nord
de la France, la mise en place d’un gouvernement fantoche en
Pologne et « l’hégémonie »
sur les autres Etats d’Europe centrale et orientale. Lorsque
Hindenburg et Ludendorff reçurent le commandement des forces armées
(et de l’économie de guerre) en été 1916, les militaires et les
industriels prirent les choses en mains de plus en plus ouvertement –
même si le gouvernement n’approuvait pas formellement leurs buts
de peur d’indisposer son allié austro-hongrois (leur but était
« l’hégémonisation »
de l’Autriche-Hongrie).
Les
arguments des dirigeants sociaux-démocrates de droite parlant de
« guerre
de
défense nationale »
sonnaient encore plus creux après l’effondrement du tsarisme en
Russie sous les coups de la Révolution de Février 1917. La
« tyrannie
russe » ne
pouvait plus être présentée comme une menace – pour une minorité
croissante de travailleurs, la véritable menace était la politique
de guerre expansionniste de l’Etat prussien et du grand capital.
Avril
1917 vit une grève des métallos contre une réduction de la ration
de pain avec la participation de 200 000 travailleurs, dirigée
par des opposants à la guerre. Des mouvements spontanés contre la
pénurie alimentaire commençaient à fusionner avec l’opposition
politique à la guerre. Mais commençaient seulement.
Les
événements de l’été 1917 et du début de 1918 montrèrent à la
fois l’impact potentiel d’un mécontentement qui fermentait
spontanément – et
les limitations politiques internes qu’il avait encore à
surmonter.
La
structure de classe de la société allemande était parfaitement
reflétée dans les rapports entre les officiers et les hommes dans
les forces armées. Les privilèges des officiers contrastaient de
façon permanente avec les maigres rations et la discipline sévère
imposées aux rangs subalternes. Au front, la camaraderie qui
résultait du danger partagé émoussait souvent la colère issue de
cette situation. Ce n’était pas le cas dans la flotte, qui,
craignant une confrontation directe avec les navires britanniques en
haute mer, restait prudemment à l’abri dans les ports de la côte
nord-ouest.
Les hommes
trimaient comme des
esclaves
et faisaient perpétuellement l’exercice, pendant que les officiers
soignaient leurs ongles et peignaient leurs chevelures. La différence
entre les conditions d’existence des officiers et des hommes était
soulignée par leur proximité étroite à bord des navires.
L’équipage voyait que ses supérieurs mangeaient mieux, allaient à
terre quand cela leur plaisait, et avaient des clubs de loisirs
spéciaux…13
Le
ressentiment fit place à l’organisation lorsque les rations furent
réduites au minimum à la suite de « l’hiver des
navets ».
Un mouvement pour l’élection de « comités
alimentaires »
vit le jour. Les marins sentaient qu’ils pouvaient construire
quelque chose de proche d’une organisation syndicale, et il y eut
des grèves de la faim et des arrêts de travail, en juin et juillet
1917, exigeant la reconnaissance de ces comités. Mais, au début
d’août, les autorités arrêtèrent un certain nombre de marins.
L’équipage d’un navire entama une action de protestation, mais
l’abandonna aussitôt. Leurs notions syndicalistes passives
d’action étaient impuissantes contre la force armée de l’Etat
et sa justice militaire. Le mouvement s’effondra. Deux de ses
dirigeants furent fusillés ; les autres se virent infliger un
total de 360 ans de travaux forcés.
Les
matelots avaient appris à la dure une amère leçon : on ne
peut pas lutter contre un appareil militaire avec des protestations
pacifiques, « apolitiques ». Ils devaient se rappeler
cette leçon 14 mois plus tard. Mais elle devait d’abord être
apprise par les travailleurs de Berlin.
Les grèves de janvier
Le
mécontentement croissant contre la guerre se focalisa politiquement
en novembre 1917. Les bolcheviks établissaient un nouveau pouvoir en
Russie, basé sur les soviets – des conseils d’ouvriers et de
soldats. Ils proposaient aux puissances qui étaient en guerre contre
la Russie un armistice immédiat, préalable à une paix permanente
« sans annexions ni indemnités », publiaient les
traités
secrets qui avaient abouti à la guerre, et renonçaient aux
possessions coloniales de la Russie tsariste.
Le
nouveau gouvernement de la Russie avait désespérément besoin de la
paix. Mais il ne croyait pas que les dirigeants de l’Allemagne
impériale ou de l’Autriche-Hongrie pouvaient accepter de telles
conditions – ils étaient entrés en guerre parce qu’ils étaient
poussés économiquement de se saisir de portions de plus en plus
grandes de la planète. Ce qu’ils croyaient, par contre, c’était
que l’appel à la paix amènerait les peuples du monde – en
particulier en Allemagne – à se retourner contre leurs vieux
gouvernements capitalistes. La révolution à l’étranger devait
produire la paix et l’assistance internationale nécessaire pour
stabiliser le pouvoir des soviets dans la Russie arriérée.
La
révolution avait à peine triomphé en Russie que les bolcheviks
s’employaient à la répandre au dehors. Ils commencèrent à
publier
Die Fackel (La
Torche), un journal destiné aux soldats allemands des tranchées du
front oriental. Il fut imprimé 500 000 exemplaires de chaque
numéro.
La
hiérarchie militaire allemande considéra l’offre de paix des
Russes comme une chance d’agrandir encore plus l’empire
germanique. Ils envoyèrent des représentants négocier avec les
bolcheviks dans la ville de Brest-Litovsk – pour y exiger qu’une
énorme portion de l’ancien empire des tsars soit convertie en
Etats nominalement indépendants qui deviendraient, en fait, des
« protectorats » allemands.
Mais
les négociateurs russes s’adressaient autant aux travailleurs
allemands qu’au Haut commandement. Lorsque Trotsky arriva à
Brest-Litovsk à la fin de décembre 1917, il était accompagné par
un Austro-Polonais qui avait été un révolutionnaire actif en
Allemagne avant la guerre – Karl Radek. « Radek,
sous les yeux des diplomates et des officiers rassemblés sur le quai
pour les accueillir, se mit à distribuer des brochures aux soldats
allemands. »14
Les
négociations de Brest-Litovsk échouèrent face aux exigences
germaniques d’annexions, et la Russie révolutionnaire dut assister
impuissante à l’avance des troupes allemandes. Mais des nouvelles
des déclarations bolcheviks commençaient à parvenir aux opposants
à la guerre en Allemagne et en Autriche-Hongrie. Karl Liebknecht
écrivit de sa cellule :
Grâce aux
délégués
russes, Brest
est devenu une tribune révolutionnaire qui retentit loin. Il a
dénoncé les puissances de l'Europe centrale, il a révélé
l'esprit de brigandage, de mensonge, d'astuce et d'hypocrisie de
l'Allemagne.15
Dans
la première quinzaine de janvier, les membres d’un petit groupe
révolutionnaire allemand, la Ligue Spartakus (anciennement le groupe
l’Internationale), distribua des tracts appelant à une grève
générale sur la question de la paix. D’autres opposants
« modérés » à la guerre, comme le dirigeant
social-démocrate dissident Haase, appelèrent à une grève de trois
jours.
Mais,
en même temps que ces préparatifs étaient en cours, des nouvelles
d’événements importants arrivèrent de l’empire austro-hongrois
voisin. Le 14 janvier, les ouvriers de l’usine Daimler, dans la
ville autrichienne de Wiener Neustadt, se mirent en grève contre une
réduction de la ration alimentaire. A peu près en même temps, les
travailleurs de l’usine de munitions Csepsel de Budapest cessèrent
le travail. En l’espace de deux jours, les usines des deux villes
étaient paralysées. Les sociaux-démocrates autrichiens estimaient
que deux cent cinquante mille travailleurs étaient en grève dans la
seule région de Vienne.16
Mais
ce n’était pas tout. A Vienne, des conseils ouvriers furent élus,
qui exigeaient l’abolition de la censure, la fin de la loi
martiale, la journée de huit heures et la libération du socialiste
antiguerre emprisonné Friedrich Adler.
La
grève ne dura pas plus d’une semaine. Mais elle avait été la
protestation la plus importante jusque là contre les effets de la
guerre. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce qui s’était passé
en Autriche germanophone trouve un écho à Berlin.
La
Ligue Spartakus y distribua un tract décrivant « des
conseils ouvriers viennois sur le modèle russe »
et proclamant « le
lundi 28 janvier le début de la grève de masse ».17
Cet appel a été repris par une assemblée des membres de la section
des tourneurs du syndicat des ouvriers métallurgistes. L’un des
responsables de la section était le socialiste antiguerre Richard
Müller et, sur sa proposition, ils votèrent pour la grève le lundi
et pour la direction de l’action par des délégués élus dans des
assemblées générales.
La
grève allemande connut tout d'abord un grand succès. 400 000
ouvriers débrayèrent le premier jour et furent rejoints le
lendemain par 100 000 de plus. Le mouvement s’étendit bien au
delà des limites de la capitale et gagna Kiel, Hambourg, Dantzig
(aujourd’hui Gdansk), Magdebourg, Nuremberg, la Ruhr, Munich,
Cologne, Mannheim et Kassel.18
Au début aussi, l’organisation de la grève semblait parfaite. 414
délégués d’usine se rencontrèrent à Berlin et désignèrent un
comité d’action de 11 personnes.
Mais
les autorités ne restaient pas inactives. Elles dispersèrent la
réunion suivante des délégués, interdirent les réunions de masse
dans les usines et occupèrent les locaux syndicaux. Dès le
mercredi, Berlin était couvert d’affiches officielles renforçant
l’état de siège et annonçant des tribunaux militaires
extraordinaires. Il y eut des affrontements entre les grévistes et
la police, qui reçut le renfort de 5 000 policiers d’autres
villes. Même le journal officiel, belliciste, des
sociaux-démocrates, Vorwärts,
fut interdit par
les autorités pour avoir « répandu
de fausses informations »
- il indiquait le nombre des grévistes.
Les
affrontements aggravaient l’amertume des masses. Un des dirigeants
spartakistes, Jogiches, décrivit comment « après
chaque affrontement »
avec la police on entendait : « Camarades,
demain nous viendrons armés ».19
Mais
il y avait dans le mouvement de grève une faiblesse fondamentale.
Les militants qui le dirigeaient n’avaient pas beaucoup réfléchi
à l’action à entreprendre en cas de succès. Comme Jogiches
l’écrivit peu de temps après, ils « ne
savaient pas quoi faire
[de l’énergie révolutionnaire] ».20
Pour
faire l’unité de toute la classe ouvrière dans la grève, le
comité d’action avait insisté, face à une certaine opposition,
sur la présence dans le comité de trois représentants du Parti
Social Démocrate partisan de la guerre. Mais ces dirigeants
n’avaient pour s’y joindre qu’une seule raison, comme ils
devaient s’en expliquer plusieurs années après. Ebert était très
clair : « J’ai
participé à la direction de la grève avec l’intention précise
de faire cesser la grève le plus vite possible pour éviter des
dommages au pays. ».21
Son collègue Scheidemann ajoutait : « Si
nous n’avions pas participé au comité, le tribunal ne serait plus
ici aujourd’hui ».22
Ebert
et Scheidemann firent tout leur possible pour semer la confusion dans
la grève. Ebert, par exemple, alla jusqu’à braver la loi en
parlant dans une réunion interdite – mais seulement pour saper le
mouvement d’une façon qui n’aurait pas été possible aux
autorités militaires, en disant : « C’est
le devoir des travailleurs de soutenir leurs frères et leurs pères
qui sont au front et de fabriquer les meilleures armes. (...) La
victoire est le but le plus cher de tous les Allemands. ».23
Pour
avoir parlé à cette réunion, le socialiste de gauche Dittmann se
vit infliger une sentence de quatre ans de prison. Ebert, bien sûr,
ne fut pas inquiété.
Les
dirigeants sociaux-démocrates apportèrent la confusion au cœur
même du comité d’action. Ils proposèrent de négocier avec le
gouvernement sur les revendications purement économiques
des grévistes – comme s’ils n’avaient pas eu des motivations
politiques, aussi confuses fussent-elles. Les dirigeants de la grève
n’étaient pas satisfaits de cette suggestion des
sociaux-démocrates, mais n’avaient pas d’alternative claire. Ils
admettaient que la guerre était la question centrale, même s’ils
avaient utilisé des motifs économiques pour mobiliser les
travailleurs. Mais pour mettre fin à la guerre ils avaient besoin
d’action révolutionnaire aussi bien que de grèves – et ils ne
s’y étaient pas préparés. Finalement, ils n’eurent pas d’autre
choix que d’appeler à la reprise du travail, malgré le grand
nombre de travailleurs qui avaient participé à la grève.
Le
gouvernement saisit l’occasion que fournissait la démoralisation
qui suivit pour décapiter le mouvement. De nombreux dirigeants
grévistes furent arrêtés, et à Berlin un ouvrier sur dix fut
envoyé au front. L’avant-garde du mouvement contre la guerre fut
éloignée physiquement des usines berlinoises.
Comme
pour les marins de Kiel l’été précédent, la grève fut défaite
parce qu’elle essayait de mettre en œuvre des tactiques purement
syndicales pour régler une question concernant le pouvoir militaire
et politique. Comme l’a résumé Jogiches, « Parce
qu’on ne pouvait pas s'imaginer la vague de grèves comme quelque
chose de plus qu’un simple mouvement de protestation, le comité de
grève a essayé, sous l’influence des députés au Reichstag,
d'entrer en négociations avec le gouvernement, plutôt que de
refuser toute négociation et de diriger l’énergie des masses ».24
La gauche
Aucun
de ces mouvements n’avait été dirigé par une organisation
révolutionnaire. Des révolutionnaires individuels jouèrent un rôle
à certains moments. Ils donnèrent une expression à la colère de
beaucoup de travailleurs contre la faim, les bas salaires et
l’effusion de sang futile de la guerre. Mais ces travailleurs
n’étaient pas eux-mêmes des socialistes révolutionnaires, pas
plus qu’ils n’observaient la discipline d’une organisation
révolutionnaire. Ils désiraient tout simplement un retour aux
conditions d’avant-guerre. Ils gardaient une certaine confiance
dans les dirigeants sociaux-démocrates, y compris lorsqu’ils
faisaient grève contre la guerre que ces dirigeants soutenaient.
Le
mécontentement croissant avait un impact sur l’organisation
social-démocrate elle-même. Même les dirigeants les plus à
droite, comme Ebert, ne pouvaient pas se désolidariser complètement
des grands mouvements de grève. Ils savaient que ce faisant ils
auraient perdu toute influence sur les masses – la seule influence,
pensaient-ils, qui pouvait éviter un effondrement de « la loi
et de l’ordre ».
Le
changement dans le sentiment populaire avait un effet encore plus
marquant sur les milliers de permanents subalternes du parti.
Beaucoup d’entre eux n’avaient pas été, en 14, des
enthousiastes de la guerre. Mais ils étaient membres d’un parti
qui possédait des millions de marks, des centaines d’immeubles des
syndicats et des coopératives, des douzaines de journaux quotidiens,
des centaines d’employés. Tout cela, craignaient-ils, aurait été
détruit par la répression si le parti s’était opposé à
l’hystérie guerrière généralisée. Il était plus facile, à
leurs yeux, de se comporter de façon « réaliste »,
d’accompagner l’humeur belliciste tout en résistant à ses pires
excès. Alors ils soutenaient la guerre, mais s’opposaient aux
appétits de l’état-major et des milieux d’affaires pour
l’annexion d’immenses portions de territoires étrangers.
Trotsky,
qui était à Vienne lorsque la guerre éclata, décrivit les
attitudes à l’intérieur du parti social-démocrate local. Ce
qu’il écrivait s’appliquait également à l’Allemagne :
Quelle fut
l’attitude que je
trouvai
dans les cercles dirigeants de la social-démocratie autrichienne, à
l’égard de la guerre ? Les uns s’en réjouissaient
ouvertement. (...) Ils étaient au fond, organiquement, des
nationalistes ; le léger vernis de culture socialiste dont ils
étaient couverts tombait d’eux, et non pas de jour en jour, mais
d’heure en heure. (...) D’autres, et à leur tête Victor Adler,
considéraient la guerre comme une catastrophe extérieure qu’il
fallait savoir supporter. Cette passivité expectative ne servait
cependant qu’à dissimuler l’aile du parti qui était activement
nationaliste.25
C’était
exactement la situation dans le parti allemand.
« L’acceptation
à contre-cœur » y était abondamment répandue.
Mais
maintenant que le sentiment antiguerre connaissait un regain de
popularité, ces gens trouvèrent commode de faire connaître leurs
doutes jusque là secrets. Ils pouvaient désormais le faire sans
briser avec la mixture de couardise et de carriérisme qui les avait
fait taire en 1914.
De
telle sorte qu’en 1916 un courant commença à se développer dans
le SPD en opposition à la direction va-t-en-guerre. L’humeur des
travailleurs de base, qui en avaient assez de la guerre mais ne
voulaient pas encore la révolution, trouvait sa contre-partie chez
de nombreux permanents du parti, qui n’aimaient pas non plus la
guerre et qui étaient aussi hostiles à la révolution qu’ils
l’avaient toujours été.
Ce
courant fut bientôt connu sous le nom de « centre »
ou
de « centriste », à cause de sa position à mi-chemin
des dirigeants du parti et des éléments révolutionnaires regroupés
autour de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Les dirigeants du
centre voulaient la fin de la guerre – mais ils ne voulaient pas de
grandes secousses sociales. Ils voyaient la paix comme le produit
possible de la « bonne volonté » des puissances en
lutte, et tendaient de plus en plus à mettre leurs espoirs dans la
politique du président américain Woodrow Wilson. Ils prenaient soin
de se distancier des slogans des spartakistes tels
que :
« L’ennemi
est
dans notre propre pays »,
« La
paix passe
par la révolution socialiste ».
Ils proclamaient avec insistance qu’ils ne croyaient pas aux actes
« séditieux », comme appeler les marins à se mutiner.
Le maximum qu’il étaient prêts à faire était de fonctionner
comme un groupe parlementaire distinct de la droite du SPD.
Mais
la direction bureaucratique du SPD n’était pas disposée à
tolérer quelque opposition que ce fût à sa politique favorable à
la guerre, même aussi molle que celle-là. Elle lui retira les
journaux sous son influence – et surtout le plus important d’entre
eux, le quotidien berlinois Vorwärts –
puis exclut en
bloc la minorité au début de 1917, l’obligeant à former son
propre parti, qu’elle le voulût ou non. Le Parti Social-Démocrate
Indépendant (l’USPDD ou simplement les
« Indépendants »)
était né.
Ce
n’était en aucune manière un parti révolutionnaire. Ses
dirigeants n’étaient liés que par une chose – leur désir de
voir la majorité du Parti Social-Démocrate cesser de soutenir la
guerre. Sur la plupart des autres sujets, il y avait le même
éventail de différences que celles qui existaient au SPD. Certains
étaient pour la révolution, d’autres pour la réforme, la plupart
préférant parler un langage révolutionnaire et agir de façon
réformiste. Certains voulaient une fin négociée à la guerre,
d’autres parlaient de la transformer en guerre civile.
De
façon caractéristique, le parti fut rejoint par le théoricien
principal de la social-démocratie d’avant-guerre, le « pape
du marxisme » Karl Kautsky, et par celui du réformisme, le
« révisionniste » Eduard Bernstein.
Mais
le développement du nouveau parti était d’une extrême
importance. Il emportait avec lui une bonne part du vieil appareil du
SPD – des douzaines de permanents, des députés au Reichstag et
aux parlements d’Etat, des quotidiens, des dirigeants syndicaux,
des bureaux et des salles de réunion. Surtout, c’était un parti
légal, libre d’organiser des réunions publiques, même si c’était
dans les limites de la censure et des lois sur la sédition. L’USPD
fournissait un point de ralliement pour les aspirations de dizaines
de milliers de personnes qui commençaient, même si c’était de
façon hésitante, à critiquer la guerre. Six mois après la
scission il pouvait revendiquer 120 000 membres, contre
150 000
dans le SPD.26
Un grand nombre des dirigeants des grèves d’avril 1917 et de
janvier 1918 étaient dans ses rangs ; et les marins révoltés
d’août 1917 commençaient à s’identifier à lui et à prendre
contact avec ses dirigeants locaux et nationaux.
Les
vrais révolutionnaires étaient plus à gauche. A la place de la
vague revendication de « paix » formulée par les
Indépendants, ceux-ci parlaient de révolution comme
seul moyen de
mettre un terme à la guerre capitaliste. Mais il n’y avait autour
d’eux que de petits groupes isolés d’activistes.
Il
est vrai que Liebknecht était connu dans tout le pays, et admiré
par beaucoup de monde aussi bien comme le député au Reichstag qui
avait le premier parlé contre la guerre que comme victime de la
persécution gouvernementale depuis lors. Mais la répression rendait
pratiquement impossible à ses collègues d’expliquer en détail
leurs opinions à des publics plus larges que des cercles restreints
de travailleurs. Il fut lui-même envoyé au front, malgré son âge
(il avait plus de quarante ans), puis emprisonné. Rosa Luxemburg
elle aussi fut jetée en prison, et leurs contacts dans les usines
furent les premiers à être persécutés et envoyés à la boucherie
après la grève de janvier 1918.
Une
estimation récente des forces (ou de la faiblesse !) de la
gauche révolutionnaire indique que :
Les
révolutionnaires de Brême
ne
disposent plus d'un seul militant sur les chantiers ou dans les
entreprises du port (...) A Berlin, le groupe spartakiste de la 6°
circonscription, qui s'étend sur Charlottenburg, Berlin-Moabit et
jusqu'à Spandau, ne compte que sept membres. La direction
spartakiste a été démantelée par les arrestations (...).27
La
faiblesse numérique de la gauche révolutionnaire était aggravée
par le fait qu’elle n’avait pas d’organisation nationale
unique, mais au contraire était divisée en trois groupes distincts,
qui n’étaient pas toujours d’accord.
Les
dirigeants spartakistes – Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Franz
Mehring, Clara Zetkin et Karl Liebknecht – adhéraient toujours à
l'idée d’avant-guerre selon laquelle un petit groupe de
révolutionnaires ne pouvait maintenir un contact vivant avec la
majorité des travailleurs que s’il faisait partie d’une
organisation plus grande. De telle sorte que les spartakistes
restèrent dans l’USPD, même si leur politique était complètement
différente de celle de la direction du parti. Ils pensaient que les
travailleurs qui devenaient hostiles à la guerre ne seraient pas
capables au début de faire la différence entre les bruits vaguement
antiguerre émis par la direction des Indépendants et la position de
Liebknecht, et qu’ils se tourneraient vers la plus importante force
d’opposition, l’USPD. Les révolutionnaires pourraient établir
des contacts avec ces travailleurs en étant à l’intérieur de
l’USPD, où ils pourraient maintenir leur propre organisation, leur
propre presse et leur propre discipline de fraction. Jogiches
écrivait :
Nous devons lutter
pour les
masses
confuses ou toujours vacillantes qui suivent aujourd’hui l’AG [le
groupe parlementaire des Indépendants]. (...) Et nous ne
pouvons faire tout cela qu'à la condition de mener le combat à
l’intérieur du parti et de ne pas mener des attaques sur l'AG
depuis l'extérieur en tant qu'organisation complétement séparée.28
Une
autre section de la gauche rejetait cette perspective. Basée
essentiellement à Brême, elle était en relation avec les
bolcheviks russes par l’intermédiaire d’un de ses membres
d’avant-guerre, l’exilé polonais Radek, qui travaillait alors
avec Lénine. Ce groupe était connu sous le nom de « radicaux
de gauche » (plus tard les Communistes Internationaux
d’Allemagne). En restant dans l’USPD, disaient-ils, les
spartakistes rendaient plus
difficile aux travailleurs de distinguer entre la véritable gauche
et les pacifistes mous qui dirigeaient l’USPD.
Les
figures les plus connues de ce groupe étaient Johann Knief,
l’inspirateur du groupe de Brême, l’ouvrier devenu journaliste
Paul Frölich, et l’intellectuel hambourgeois Laufenberg. Malgré
leurs critiques envers les spartakistes, ces dirigeants s’avérèrent
un groupe possédant peu de cohésion ou d'homogénéité politique.
Enfin,
il y avait encore un troisième groupement révolutionnaire, même
s’il n’était pas une tendance pleinement organisée, constitué
d’un certain nombre de militants ouvriers influents au sein du
Syndicats des Métallurgistes Berlinois. Ces derniers avaient dirigé
les grandes grèves de 1917 et de 1918 et se considéraient comme
révolutionnaires, organisés dans un groupe appelé « les
Délégués Révolutionnaires ». Cependant, ils ne rompirent
pas complètement avec la direction de l’USPD, étant
particulièrement proches du vétéran député au Reichstag Georg
Ledebour, dont l’avis était souvent décisif dans les moments de
crise.29
Dans
l’ensemble, à l’été 1918, il y avait probablement trois ou
quatre mille socialistes révolutionnaires en Allemagne. Ils
n’avaient pas d’organisation unique, pas de traditions de
discipline commune, aucun moyen de parvenir à un accord stratégique
ou tactique, aucun moyen de sélectionner parmi eux des dirigeants à
la tête froide, dignes de confiance. Pourtant, ces révolutionnaires
allaient entrer dans une des périodes de lutte de classe les plus
intenses de l’histoire du capitalisme.
A
l’été de 1918, l’armée allemande lança une offensive massive
sur le front occidental. Elle tendit les ressources à la disposition
des généraux au delà du point de rupture. Lorsque les succès
initiaux furent réduits à néant par une contre-offensive des
forces alliées, il devint clair pour le haut commandement allemand
que la défaite les regardait dans les blanc des yeux. Ils étaient
en état de choc. A peine quelques semaines plus tôt, ils parlaient
de victoire avec assurance. Le retrait de la Russie avait laissé
libre leur flanc oriental et leur avait permis de tout transférer
sur le front Ouest. L’agitation contre la guerre de janvier s’était
calmée, apparemment pour de bon : il était possible pour une
commentateur contemporain de la scission dans le SPD de proclamer en
mai que la paix à l’est avait eu pour effet « d’amener
les masses aux côtés du gouvernement ».30
La
discussion dans les cercles dirigeants n’avait pas porté sur la
question de savoir s’il fallait continuer la guerre ou faire la
paix, mais sur ce qui devait être annexé après la victoire
allemande. Désormais les généraux voyaient que le front tout
entier allait s’effondrer, sauf si le pays pouvait sortir de la
guerre les plus rapidement possible. Ils cessèrent de vanter leur
invincibilité et commencèrent à chercher des moyens d’éviter
d’être rendus personnellement responsables de la défaite.
Hindenburg
et Lundendorff, pour l’état-major, eurent un entretien avec le
Kaiser le 29 septembre. Ils lui révélèrent que « la
guerre était perdue »
et que la situation était désespérée. L’ouverture immédiate de
négociations pour une paix de compromis était la seule alternative
à une défaite désastreuse. La seule façon de garantir la
stabilité sociale était de remplacer le pouvoir absolu par un
nouveau gouvernement, libéralisé, comportant des ministres
sociaux-démocrates.
Le
Kaiser était stupéfait. Les représentants de l’élite militaire
prussienne étaient en train de lui suggérer de former un
gouvernement qui inclurait son ennemi traditionnel. Il n’avait pas
le choix, insistaient-ils. Comme devait le formuler le secrétaire
d’Etat, Hintze, « il
faut prévenir le bouleversement d'en bas par la révolution d'en
haut ».31
Ainsi,
avec la bénédiction des secteurs les moins libéraux de la société
allemande, un nouveau gouvernement de coalition
« libérale »
fut formé. Le chancelier en était le cousin du Kaiser, le prince
Max de Bade. Son programme : des concessions, à la fois aux
travailleurs allemands et aux puissances alliées. Son but :
sauver la monarchie.
Le
SPD avait toujours été, par principe, républicain. Là, les
dirigeants du parti consentaient à faire partie d’un gouvernement
dont la seule raison d’être était la préservation de la
monarchie. Le secrétaire du parti, Ebert, déclara lors d’une
réunion de la direction :
Si nous ne voulons
pas
d'entente avec les
partis bourgeois et le gouvernement, nous devrons laisser les
événements suivre leur cours. (...) Qui a vécu les événements de
Russie ne peut pas souhaiter, dans l'intérêt du prolétariat, qu'un
tel développement advienne chez nous.32
C’était
suffisant pour convaincre les collègues d’Ebert qu’il avait
raison de soutenir les efforts du prince Max – mais il était trop
tard pour qu’un tel soutien puisse éloigner le spectre de la
révolution.
Les
discussion sur une armistice eurent un impact considérable au sein
de l’armée. Les soldats du rang ne voyaient plus l’intérêt de
continuer à se battre. Comme l’a noté un historien de l’armée
allemande, dès le printemps de 1918 de nombreuses « jeunes
recrues »
étaient « infectées
par la propagande de gauche contre la guerre ».
Le sentiment était moins dominant au front qu’à l’arrière.
Malgré tout, il y eut plus de 4 000 passages à l’ennemi en
1918. Maintenant qu’on avait dit aux soldats que tous leurs efforts
passés n’avaient servi à rien. (...) « les
désertions dans les rangs s’accrurent après la demande hâtive de
Ludendorff aux alliés d'un compromis ».33
Le
tournant dans la situation politique ouvrait de nouvelles
opportunités pour les forces de l’extrême gauche. Le sentiment
que l’ordre ancien était en crise grandit dans une couche
significative de travailleurs et trouva une expression dans les rues.
« Le
mois
d’octobre fut (...) le moment de l'éveil de larges masses de
travailleurs, les assemblées tempétueuses et les manifestations
spontanées alternaient les unes avec les autres ».34
L’impression que le gouvernement n’était pas sûr de lui fut
confirmée lorsque, le 23 octobre, Liebknecht fut libéré de prison
– une concession faite sous la pression des sociaux-démocrates qui
voulaient lui ôter son prestige de martyr.
Mais
cette concession n’était pas suffisante pour faire cesser les
troubles croissants. Les gens n’étaient que trop conscients que
l'appareil répressif et les lois restaient intactes : les
condamnations continuaient de tomber sur les participants aux grèves
de janvier. Et surtout, la guerre n’était pas finie. Le Haut
Commandement allemand avait espéré obtenir facilement une paix de
compromis. Mais les puissances alliées, en particulier la France,
étaient déterminées à traiter l’Allemagne comme les Allemands
avaient traité la Russie soviétique au début de l’année –
briser sa force, accaparer des portions de son territoire, lui
prendre ses colonies, piller son économie.
Plutôt
que d’accepter ces conditions, le Haut Commandement préféra
envoyer ses troupes livrer des batailles perdues. Finalement, dans
une tentative désespérée de changer la donne, il lança à la mer
une flotte qu’il avait maintenue à l’abri des hasards des
batailles pendant la plus grande partie de la guerre.
L’humeur
des matelots du rang était encore plus amère, si cela était
possible, que l’année précédente. Ils savaient que s’ils
laissaient la flotte défier les navires britanniques en haute mer
ils connaîtraient la défaite et une mort certaine. Lorsque les
marins de Wilhelmshaven reçurent l’ordre, à la fin d’octobre,
de mettre leurs navires en marche, ils répondirent en éteignant les
chaudières. Comme l’écrivit un marin à son père, « Nous
sentions tous que ce serait notre dernier voyage, d'où le refus
instinctif d'obéir aux ordres ».35
Ils furent immédiatement arrêtés.
Mais
le mouvement ne fut pas brisé par la répression comme il l’avait
été l’année précédente. Il y avait désormais trop de choses
en jeu. Cinq jours plus tard, des milliers de marins défilaient dans
les rues de Kiel pour protester contre les arrestations. Ils furent
rejoints par les travailleurs du port. Des affrontements avec des
patrouilles loyales au gouvernement laissèrent neuf morts sur la
chaussée. Mais ces patrouilles rencontrèrent bientôt une
résistance qui les força à se retirer de la ville. La Révolution
Allemande avait commencé.