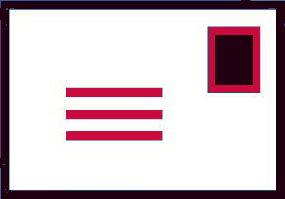Le
13 mars 1920, à quatre heures du matin, une colonne de soldats
fortement armés entra dans Berlin et déclara le gouvernement
renversé. Pas un coup de feu ne fut tiré contre eux. La plupart des
unités de l’armée et de la police « protégeant » la
ville les accueillirent avec enthousiasme.
Noske,
le ministre de la guerre nominalement en charge des armées de la
république, avait tenté désespérément d'arrêter la colonne en
marche. Il avait envoyé des officiers supérieurs ordonner aux
troupes de faire halte : les officiers avaient eu des
discussions amicales avec les commandants des soldats rebelles – et
les avaient autorisés à poursuivre leur route vers la capitale.
Noske avait ordonné à la police de procéder à des
arrestations :
elle avait simplement averti les conspirateurs que des manœuvres
étaient en cours contre eux. Il avait demandé à ses généraux des
troupes pour combattre le coup d’Etat : le chef de l’armée,
Seeckt, lui avait répondu : « La Reichswehr ne tirera
pas
sur la Reichswehr ». Il ne put contacter les officiers de la
police de sécurité de Berlin : ils s’étaient eux-mêmes
joints au coup d’Etat.
Les
« Gardes de Noske » s’étaient retournés contre Noske.
« Tout le monde m’a abandonné », gémissait le limier
intrépide de l’année précédente, « Il ne me reste plus
que le suicide ».1
Mais
Noske tenait à sa peau plus qu’à ce qu’il pouvait lui rester de
principes. Au lieu de se brûler la cervelle, lui et le reste du
gouvernement choisirent la poudre d’escampette, et ce avant même
que les troupes rebelles ne soient entrées dans la ville. Les
soldats, une brigade commandée par le capitaine Erhardt, prirent les
ministères sans rencontrer aucune résistance et proclamèrent un
nouveau gouvernement présidé par le bureaucrate conservateur Kapp.
Berlin
avait été arrachée au gouvernement social-démocrate par ces mêmes
militaires que les sociaux-démocrates avaient promus l’année
précédente : Erhardt, à qui ils avaient confié la tâche de
lutter contre la Révolution Russe ; Lüttwitz, qui avait dirigé
la répression contre les travailleurs de Berlin en janvier et mars
1919 ; Pabst, qui avait joué un rôle d’organisateur dans
l’assassinat de Rosa Luxemburg ; et Oven, qui avait commandé
les Freikorps dans l’écrasement de la Bavière soviétique.
Un
certain nombre de généraux ne prirent pas part au putsch, mais ils
se dérobèrent quand on leur demanda de le combattre. Le refus de
Seeckt de porter secours au pouvoir exécutif
« légitime »
fut imité par beaucoup d’autres. Lorsque Noske, Ebert et leur
gouvernement arrivèrent à Dresde en quête de protection, le
général Märcher, commandant de la région, les obligea à
poursuivre leur route vers Stuttgart. Il voulait savoir qui avait
gagné avant de se déclarer pour un camp ou un autre.
Le
coup d’Etat n’aurait dû être une surprise pour personne. Il y
avait des rumeurs, depuis l’été précédent, qu’une telle
entreprise était imminente. Dès juin 1919, Lüttwitz avait commencé
par suggérer à Noske lui-même la mise en place d’une dictature.
Pabst était prêt depuis la fin juin à lancer un assaut militaire
sur le gouvernement, mais avait été persuadé de l’ajourner par
un groupe de généraux. Lüttwitz avait pris langue avec Märcher à
propos d’un coup d’Etat à peu près à la même époque ;
Märcher avait refusé de collaborer – mais, de façon
significative, n’avait pas songé à faire part des entreprises
mutines de Lüttwitz au gouvernement. « En octobre 1919, les
rumeurs d’une révolte de droite imminente étaient très
répandues », écrit Gordon.2
Noske
refusa tout simplement d’accorder son attention à ces rapports.
Pour lui, le corps des officiers avait un droit sacré,
constitutionnel, de faire tout ce qu’il souhaitait. Interférer eût
été une offense à l’honneur de l’armée. Ainsi il se laissa
persuader par d’autres généraux de ne pas sanctionner Lüttwitz.
Au lieu de cela, il travailla avec
Lüttwitz à la préparation des mesures de janvier 1920, interdisant
la presse de l’USPD et du KPD et déclarant les grèves illégales.
A
peine quelques heures avant le putsch, Noske déclara à un collègue
social-démocrate, Kuttner, qu’il était totalement convaincu que
les généraux continueraient à soutenir le gouvernement légal.3
Il est donc peu surprenant que les conspirateurs fussent persuadés
que si le coup réussissait Noske et Ebert soutiendraient – ou même
rejoindraient – un nouveau gouvernement.
Même
s’ils n’étaient pas prêts à aller jusqu’à participer au
putsch, ils n’avaient pas le pouvoir de le stopper. Ils avaient
passé 14 mois à restaurer l’appareil d’Etat comme mécanisme
hors d’atteinte du contrôle populaire. Et là, ils découvraient
qu’ils ne pouvaient le contrôler eux-mêmes. Ils avaient contribué
à faire en sorte que « la quasi-totalité du corps des
officiers adhère aux principes monarchiques et aux idées sociales
conservatrices ».4
Ils pouvaient dès lors difficilement s’appuyer sur lui pour
empêcher un putsch d’extrême droite.
Les
partis bourgeois de droite, eux aussi, étaient réticents à
accorder leur soutien total à un putsch qui pouvait tourner court.
Mais il n’allaient ni le condamner ni entreprendre quoi que ce soit
pour empêcher son succès. L’historien du principal parti des
grands milieux d’affaires, le Parti du Peuple Allemand, écrit :
En ce
qui concernait Stresemann lui-même, il était évidemment hors de
question qu’il s’associe activement, lui ou son parti, à une
offensive contre le gouvernement républicain. Mais une rébellion
couronnée de succès, organisée par d’autres, était quelque
chose de tout à fait différent.5
La grève générale
En
fait, malgré son succès militaire, le putsch échoua. Il y avait
une force, la seule, que la puissance de l’armée allemande était
incapable d’écraser – une classe ouvrière unie.
Ebert
et Noske avaient fui Berlin. Mais tous les dirigeants
sociaux-démocrates n’avaient pas la même attitude complaisante.
Leur réputation auprès des travailleurs était en jeu – ainsi que
quelque chose qui comptait encore plus, leur peau. C’était une
chose que de collaborer avec des généraux pour assassiner des
révolutionnaires. C’en était une autre que de s’incliner devant
un coup d’Etat qui menaçait l’existence même de leur parti.
L’initiative
de l’appel à la grève générale à Berlin, et l’organisation
de la résistance furent prises en charge, de façon extraordinaire,
par le dirigeant syndical droitier Legien, le bureaucrate qui, depuis
des années, était le fléau de la gauche dans les syndicats et le
SPD. Il refusa de fuir, attaqua l’attitude des dirigeants
sociaux-démocrates et jeta tout son poids dans la bataille pour la
grève générale.
Une
réunion fut organisée à la hâte entre les syndicats, l’USPD et
les dirigeants SPD restés à Berlin. On imprima à la hâte un tract
proclamant une « grève générale illimitée ». Au bas
du texte s’alignaient les signatures des membres SPD du
gouvernement. De façon caractéristique, Noske, dans un télégramme
au général Watter, nia l’avoir signé.
L’appel
eut un effet immédiat. Il commença à être distribué le jour du
putsch, le samedi 13 mars, à 11 heures du matin. A midi la grève
avait démarré. Ses effets furent ressentis partout dans la capitale
en 24 heures, bien que ce fût un dimanche. Il n’y avait plus de
trains, plus d’électricité, plus de gaz. Kapp édicta un décret
menaçant de fusiller les grévistes. Son effet fut nul. Dès le
lundi, la grève s’étendait dans tout le pays – la Ruhr, la
Saxe, Hambourg, Brême, la Bavière, les villages industriels de
Thuringe, et même les grandes propriétés de la Prusse rurale.
Et
le mouvement ne concernait pas seulement les ouvriers de l’industrie.
Même si la classe moyenne commençait déjà à virer à droite, la
réponse déterminée des travailleurs industriels attira à elle une
grande partie des cols blancs traditionnellement conservateurs. Comme
un rapport au congrès du Parti Communiste l’exposait,
« Certes,
les employés de rang moyen des chemins de fer, de la poste, des
prisons et des tribunaux ne sont pas devenus communistes et ne vont
pas le devenir très rapidement de façon massive. Mais ils ont, pour
la première fois, lutté aux côtés du prolétariat ».6
Kapp
et ses affidés découvrirent, selon le socialiste belge de Bruckere,
que « la grève générale les enlaçait d’un pouvoir
terrible et silencieux ». A partir de là s’est développé
un mythe selon lequel le putsch avait été mis en échec par la
seule vertu d’une grève pacifique. Par exemple Richard Watt, dans
son histoire populaire par ailleurs utile de la période
révolutionnaire, écrit :
Le
putsch de Kapp fut vaincu par une combinaison de la totale
incompétence du « chancelier » (Kapp) et de
l’efficacité
stupéfiante d’une grève générale à laquelle appelèrent les
socialistes.7
Mais
le putsch était, en fait, confronté à quelque chose d’infiniment
plus menaçant. Dans de plus en plus de lieux, les travailleurs
transformaient la grève en assaut armé sur le pouvoir à l’œuvre
derrière le putsch – la structure du pouvoir militaire
minutieusement construite par Noske et le Haut Commandement au cours
des 14 mois précédents. Comment aurait-il pu en être autrement,
dans la mesure où le gouvernement de Kapp avait ordonné à l’armée
d’ouvrir le feu sur des grévistes
« pacifiques » ?
Soit les travailleurs désarmaient les troupes, soit les soldats
massacraient les grévistes.
Dans
trois endroits d’Allemagne, le cœur industriel de la Ruhr, les
zones industrielles et minières de l’Allemagne centrale, et la
région du Nord entre Lübeck et Wismar – la classe ouvrière armée
prit effectivement le pouvoir entre ses mains.
Les Armées Rouges de la Ruhr
Les
travailleurs de la Ruhr avaient déjà fait l’expérience de la
brutalité sans limite de l’occupation militaire par les Freikorps
et par l’armée. La « restauration » sauvage de
l’ordre
en février et avril 1919 fut suivie par une nouvelle période de
pouvoir militaire au commencement de 1920. En réponse à une grève
des chemins de fer et à un regain de l’agitation pour la journée
de six heures dans les puits, le ministre social-démocrate Severing
avait donné au général Watter les pleins pouvoirs pour disperser
les meetings, dissoudre les comités de grève et arrêter les
membres des piquets. La presse communiste et indépendante fut
interdite et des centaines de militants de gauche jetés en prison.
Les travailleurs savaient ce que cela signifierait si les généraux
étaient capables de gouverner sans même faire
semblant de respecter
les formes démocratiques.
Des
nouvelles arrivant de Berlin, des réunions de représentants des
partis ouvriers et des syndicats furent organisées pour reprendre
l’appel à la grève. Déjà, dans ces réunions, beaucoup
parlaient d’une action qui ne se bornerait pas à vaincre le putsch
et à retourner à la situation précédente. Lors d’une réunion
de délégués de la région du Rhin inférieur (la Ruhr du Sud)
tenue à Eberfeld, l’Indépendant de gauche Otto Brass présenta
une résolution appelant au désarmement des classes moyennes et à
l’établissement d’une dictature prolétarienne basée sur les
conseils ouvriers. Les dirigeants sociaux-démocrates locaux ne
savaient que dire, face à l’écroulement de leurs arguments sur la
loyauté des autorités militaires. A la surprise générale, ils
votèrent pour
la résolution.8
Mais
même à ce moment, certains ouvriers étaient encore sous
l’influence des sociaux-démocrates ou des Indépendants de droite.
A Essen, lorsque les communistes et les Indépendants de gauche
appelèrent à la dictature du prolétariat, les sociaux-démocrates
se retirèrent et formèrent leurs propres comités de grève avec
des membres des partis bourgeois « démocratiques ».9
Cela ne se produisit pas à Hagen, un bastion indépendant – mais
seulement parce que les revendications du comité d’action se
limitaient à un appel à « défaire le putsch »,
protéger la république, rétablir les droits des travailleurs.10
Dans
de telles circonstances, l’appel à la grève générale fut
diffusé, et l’industrie de la Ruhr s’arrêta le lundi matin.
L’action armée contre les autorités militaires fut lente à se
développer. A Dortmund, les sociaux-démocrates réussirent à
l’empêcher en proclamant que la Garde Locale était à 90 %
SPD et qu’on pouvait lui faire confiance. A Hagen, les dirigeants
Indépendants consentirent à l’armement des travailleurs – mais
le firent lentement, de façon typiquement bureaucratique.
Le
comportement des autorités changeait rapidement ces attitudes. A
Hagen, le lent armement des travailleurs fut remplacé par une action
de masse spontanée lorsqu’il apparut qu’un des journaux locaux
de droite soutenait le putsch de Kapp. En quelques heures, des foules
de travailleurs avaient pris possession du centre de la ville, saisi
les armes de la police, et imposé une censure ouvrière de la
presse.
Mais
ce fut l’action du commandement de l’armée qui radicalisa le
plus les travailleurs. Le général des Freikorps, Watter, était
stationné en dehors de la Ruhr elle-même, à Munster. Il était
assez avisé pour ne pas s’engager aux côtés de Kapp ni du
gouvernement tant qu’il ne voyait pas lequel allait gagner. Il
restait sur la touche, obtenant même l’accord du dirigeant
social-démocrate Severing pour se joindre à un appel en faveur de
« la paix et l’ordre ». Mais pour Watter,
« la
paix et l’ordre », cela signifiait poursuivre la répression
militaire du mouvement ouvrier local, tout en restant passif à
l’égard de ses officiers subalternes qui étaient ouvertement du
côté de Kapp : une partie du plan national du coup d’Etat
était la marche sur Berlin du Corps Lutzow, basé à Remscheid, et
le drapeau monarchiste flottait sur les casernes de Mülheim.
Dans
son effort pour maintenir « la paix et l’ordre »,
Watter envoya deux brigades, sous les ordres d’un capitaine
Hasenclaver, confisquer les fusils des ouvriers de Hagen. Un
dirigeant des « Armées Rouges » décrivit plus tard ce
qui se passa alors :
La batterie du capitaine
Hasenclaver
arriva à la gare de Wetter-am-Ruhr le 15 mars 1920, à dix heures du
matin. Le comité d’action local – constitué d’Indépendants
et de sociaux-démocrates – interpella le capitaine :
« De
quel côté sont les militaires ?’ » Vint alors la
réponse solennelle, dont dépendait tout le résultat de l'action de
défense dans le bassin houiller de la Ruhr : « Nous
sommes ici par ordre du général Watter et il est du côté du
général Lüttwitz’ »
Puis commença une bataille
sans
équivalent dans l’histoire du mouvement ouvrier allemand. Les
travailleurs attaquèrent avec leurs rares fusils. Le terrain
montagneux leur était favorable. De derrière chaque rocher, chaque
arbre, chaque buisson et chaque cachette, frappait la mort rouge. Des
camarades travailleurs vinrent se joindre au combat, venus de
Brommern, Volmarstein, Wengern, Hagen, Witten, avec dans leurs mains
des armes prises à l’ennemi. Et quand
la bataille meurtrière fut terminée, les espoirs de Kapp, Lüttwitz
et Watter étaient étendus sans vie dans la gare – abattus par
l'enthousiasme embrasé des prolétaires. Soixante-quatre morts,
parmi lesquels quatre officiers, dont le capitaine Hasenclaver, une
centaine de prisonniers ! Mais les travailleurs portèrent en
terre six des meilleurs d'entre eux.11
Pendant
ce temps, à Dortmund, les Gardes Locaux « à 90 %
sociaux-démocrates » ouvraient le feu sur un meeting ouvrier,
tuant six personnes. La colère contre les dirigeants SPD grandit.
Elle devint même plus brûlante le lendemain, lorsque deux
dirigeants sociaux-démocrates locaux se joignirent au Freikorps
Lichtschlag dans une marche en direction de Hagen. « Ce fut la
rupture entre la masse social-démocrate et la direction
social-démocrate ».12
Il
n’était désormais plus question de retenir un soulèvement plus
ou moins spontané, un mouvement qui devait se développer en
attaques frontales coordonnées qui bousculèrent l’armée, la
forçant à évacuer la Ruhr.
A
Hagen, une direction militaire régionale fut constituée sous les
ordres de l’Indépendant Joseph Ernst. En même temps que des
trains électriques étaient utilisés pour envoyer des renforts
d’ouvriers armés à Wetter, tous les autres transports furent
stoppés pour empêcher les troupes d’obtenir de l’aide.
Dortmund, à quelques kilomètres au nord, était encore tenue par
les militaires. Quand Watter essaya d’envoyer des renforts à la
garnison, ceux-ci durent d’abord faire face à un système
ferroviaire saboté, puis à des attaques d’ouvriers armés à
Berghofen et Aplerbeck. Pendant ce temps, des travailleurs en armes
marchaient sur Dortmund, où un comité d’action composé
d’Indépendants, de communistes et de syndicalistes (les
sociaux-démocrates refusèrent de s’y joindre) dirigeait l’attaque
sur les troupes. Après une bataille acharnée, l’armée dut
abandonner ses positions et faire retraite sur sa base de Remscheid –
où elle fut attaquée de tous côtés.
Les
travailleurs, qui avaient en tout et pour tout 50 fusils lorsqu’ils
engagèrent le combat le mardi, avaient, le mercredi, forcé les
troupes à se retirer – jusqu’à ce que, à nouveau attaquées
par des travailleurs à Morsbachtal, beaucoup se rendirent et furent
désarmés. Trente trois ouvriers furent tués dans ces batailles.
Les
travailleurs tenaient désormais la totalité de la partie orientale
de la Ruhr, avec un front face à Münster au nord et à Essen à
l’ouest. A Essen, la police de sécurité « Verte » et
les Gardes locaux avaient imposé un étroit contrôle militaire,
interdisant le comité d’action de grève et tirant sur les
manifestants. Mais, comme l’a relaté un témoin oculaire :
Le 18 mars le Front Rouge
avait déjà
atteint les limites de la ville d’Essen. Les
« Verts »
défendaient avec ténacité chaque bâtiment. Les combats pour le
contrôle de Stoppenberg furent particulièrement acharnés. (...)
Dans la nuit du 18 au 19 mars l’Armée Rouge franchit la limite
nord de la ville. Les forces d’occupation firent à la hâte des
préparations pour arrêter l’Armée Rouge. Tôt dans la matinée
du 19 mars il y eut une bataille furieuse autour des abattoirs. (...)
Il y eut de nombreuses pertes des deux côtés. (...) Entre 9 et 10
heures du matin les premiers Gardes Rouges apparurent dans la
Beuststrasse. Ils furent accueillis avec une incroyable jubilation.
L’abattoir était maintenant sous le feu des deux côtés. Puis les
« Verts » qui occupaient l’abattoir comprirent que
résister plus longtemps était inutile. Ils se replièrent en
déroute vers la ville, laissant derrière eux d’importants stocks
d’armes et de munitions dont les travailleurs s’emparèrent.
(...) Les
travailleurs d'Essen
purent enfin participer à la bataille. Des milliers d’entre eux
s’armèrent et rejoignirent le Front Rouge. Mais cela prit
longtemps pour que les travailleurs se rendent maîtres de la ville
d’Essen. Sur la Viehofer Platz et le Pferdemarkt les Verts résistaient
avec acharnement. (...) Il était midi lorsque le
drapeau rouge fut hissé sur l’hôtel de ville. (...) D’importants
combats faisaient encore rage autour de la gare et de la poste.13
Avec
la perte d’Essen, Watter vit que ses autres garnisons dans la
région n’allaient pas durer longtemps. Il ordonna à ses troupes
de se retirer de Düsseldorf, Mülheim, Duisburg et Hamborn.
Comme
il l’expliqua à ses officiers dans un ordre du jour du 22 mars,
sept jours après la tentative de putsch :
La
bataille actuelle dans la ceinture industrielle est différente des
précédentes interventions pour mater les désordres intérieurs, en
ceci que nous sommes désormais confrontés à une troupe bien
organisée, bien armée et bien commandée, qui a un plan tactique
unique. (...) Il s'agit d'une opération purement militaire, le
combat des troupes gouvernementales contre l’Armée Rouge
révolutionnaire.14
Ce
qui avait commencé comme une série de soulèvements isolés s’était
développé en moins de cinq jours en une confrontation frontale
entre deux armées – la Reichswehr et « l’Armée
Rouge »,
forte, selon certaines estimations15,
de 50 000 hommes et équipée des armements les plus modernes, y
compris de l’artillerie. Et la Reichswehr avait été vaincue et
avait battu en retraite, laissant comme pouvoir unique dans la région
industrielle de la Ruhr celui de l’Armée Rouge.
Pourtant,
dans un certain sens, l’appellation « Armée Rouge »
est erronée. C’était une forme de pouvoir prolétarien, mais il
n’y avait pas de structure unique de commandement pour l’unifier.
Le soulèvement des travailleurs avait été la réaction à des
attaques de la droite dans diverses régions :
Les
travailleurs obtinrent leurs premières armes de la police, des
membres bourgeois des Gardes Locales, etc., dans une attitude
défensive, et en se limitant à des revendications locales. (...) A
chaque fois, ils étaient surpris par l'apparition des militaires.
(...) Plus les troupes avançaient dans les villes, mieux les
travailleurs apprenaient à se coordonner entre eux. Certaines
grandes villes devinrent de véritables centres d'alerte et de
mobilisation.16
Les
travailleurs qui avaient entamé la lutte, chassant
« spontanément »
la Reichswehr et la police de lieu en lieu, le firent en groupes plus
ou moins organisés – peut-être à partir d’une usine, d’une
section syndicale ou d’une cellule de parti ouvrier. Bientôt ils
furent organisés par des centres locaux sous le contrôle des
comités d’action. Un observateur bourgeois a décrit un
« bureau
de recrutement » de l’armée des travailleurs :
Devant
le bureau de recrutement les gens s’assemblaient. Mais tout se
déroulait (...) dans un calme exemplaire. La distribution des armes
se faisait dans un autre endroit, où, semble-t-il, étaient envoyées
les armes saisies. La première solde est payée à chaque
volontaire au moment de l'enrôlement. (...) Les lieux d'appels, la
répartition des troupes, la distribution des armes, leur
vérification par le responsable des armes, la distribution de pain,
le départ des unités, c'était le même tableau que lors de la
mobilisation de 1914. Des troupes ordonnées en colonnes de quatre,
avec un chef à leur tête, marchaient de façon extrêmement
disciplinée dans les rues.17
Des
qualifications minimales commencèrent à être exigées pour être
membre de l’Armée Rouge ; habituellement 12 mois
d’appartenance à un parti ouvrier ou un syndicat, et six mois
d’expérience des combats au front pendant la guerre.
Mais
le fonctionnement de l’organisation au niveau local n’avait pas
sa contre-partie dans une centralisation. Dans chaque ville, les
comités d’action étaient portés, alors que la police et la
Reichswehr étaient hors d’état de nuire, à se transformer en
conseils ouvriers exécutifs ; mais c’est seulement à
Dortmund et à Mülheim qu’ils étaient subordonnés à des
instances constituées de délégués élus des usines ;
ailleurs, ils demeuraient des coalitions d’individus nommés par
les partis. La bataille faisait rage depuis dix jours et aucun effort
sérieux n’avait été fait pour coordonner les comités d’action
de l’ensemble de la Ruhr.
De
plus, l’organisation de la lutte armée avait tendance à
s’émanciper de ces organes. Plus l’armée des travailleurs était
nombreuse, moins les conseils exécutifs avaient de contrôle sur
elle, et plus l’organisation de l’Armée Rouge venait
d’elle-même.18
Des dirigeants émergeaient, qui commandaient les unités dans chaque
section du front. Mais, comme l’indiquait un membre dirigeant du
Conseil Exécutif de Dortmund :
Les
dirigeants qui jouaient alors un rôle avaient une importance plus ou
moins locale, et pas plus. Les partis, l’USPD, le Spartakusbund,
les syndicalistes, n’étaient guère mieux lotis. (...) Autour de
Dortmund la direction de l’USPD « régnait’ ; à
partir de Dortmund les spartakistes, organisationnellement faibles,
essayaient, à l’aide de slogans clairs et fondés historiquement –
conseil central, dictature des conseils – à organiser et
solidifier le pouvoir des travailleurs ; autour de Mülheim se
développait un syndicalisme anti-centraliste, anti-dirigeants.19
A
Mülheim et Hagen des tentatives furent faites d’établir une
direction militaire centralisée pour l’ensemble de la Ruhr. Les
leaders de Mülheim formèrent un « Quartier général de
l’Armée Rouge », qui proclama la dictature du prolétariat.
Mais aucun des deux n’étendait son influence au delà de quelques
villes de sa région, et la communication entre les deux était
réduite.
Lors
de la réaction initiale au putsch de Kapp, ces déficiences étaient
de peu d’importance. Malgré elles, les travailleurs chassèrent la
police et les troupes, saisirent leurs armes – y compris de
l’artillerie lourde et deux avions – et établirent ce qui était
effectivement un pouvoir des travailleurs. Les Armées Rouges
contrôlaient le front, pendant que les conseils exécutifs
organisaient une police locale de travailleurs en armes, censuraient
la presse bourgeoise, essayaient de négocier des livraisons de
denrées alimentaires pour prévenir la famine, relâchaient les
prisonniers politiques et supervisaient les activités des autorités
locales. Mais l’absence d’une coordination centrale allait
devenir de plus en plus importante après la fin du premier stade de
la lutte, dès lors que se posait la question : que fait-on
maintenant ? Pour savoir pourquoi, nous devons d’abord porter
notre regard sur ce qui se passait ailleurs en Allemagne.
L’Allemagne centrale
En
1919, les grèves de mineurs de la Ruhr avaient été rapidement
suivies de luttes similaires engagées par les mineurs et les
ouvriers de l’industrie d’Allemagne centrale. Un an plus tard,
l’effet du putsch de Kapp fut de pousser les ouvriers du centre à
réagir en même temps et à peu près de la même façon que les
travailleurs de la Ruhr. Dans presque tous les centres industriels
d’Allemagne centrale, la grève générale fut immédiate et donna
bientôt naissance à la lutte armée.
A
l’ouest de l’Allemagne centrale, on trouvait dans les sept
principautés de Thuringe plus de vestiges de la Révolution de
Novembre que partout ailleurs en Allemagne. L’USPD était le parti
ouvrier le plus important, contrôlant un grand nombre des
gouvernements locaux et influençant la composition de la police et
des détachements de sécurité. Le gouvernement de Kapp déclara
sans pouvoirs ces gouvernements locaux ; ils répondirent en
soutenant officiellement la grève générale et en prenant des
mesures d’autodéfense.
A
Gotha, après que le gouvernement de l’Etat ait appelé à la
formation de comités de défense ouvrière basés dans les usines, à
la constructions de conseils ouvriers et à la formation d’une
« armée du peuple », des travailleurs et des
policiers
sympathisants prirent le contrôle des plus importants bâtiments
municipaux, dont ils furent bientôt délogés par des renforts de
l’armée. Mais les travailleurs des villes et villages de la
périphérie, qui avaient désarmé les éléments de la droite
locale, marchèrent sur Gotha où ils remportèrent une victoire
contre l’armée, au prix de 46 morts.
Il
y eut des développement semblables à Weimar. Les travailleurs de la
ville voisine d’Iéna désarmèrent la réactionnaire « Garde
Paysanne » locale et se mirent en marche pour venir en aide à
la capitale de l’Etat.
A
Gera les travailleurs s’armèrent et prirent d’assaut l’hôtel
de ville, les bâtiments gouvernementaux et les casernes. A Sommerda,
à 25 kilomètres d’Erfurt, les ouvriers désarmèrent les Gardes
Locaux réactionnaires, saisirent 2 000 armes et constituèrent
une armée ouvrière. Le fait qu’il y eût en Thuringe un certain
nombre d’usines d’armement s’avéra très utile pour les
travailleurs. Ils avaient bientôt pris le pouvoir armé entre leurs
mains dans tous les centres importants, à l’exception d’Erfurt.
La
situation était très semblable dans la province prussienne de Saxe,
au nord de la Thuringe. Là aussi, les villes et villages
périphériques étaient bientôt sous le contrôle des travailleurs
en armes. A Burg, les officiers de la garnison furent arrêtés, et
le conseil municipal donna 30 000 marks pour renforcer les
Gardes Locaux avec des travailleurs. A Neuhandensleben, il y eut des
confrontations armées entre les ouvriers et la force réactionnaire
des Volontaires. A Strassfurter les ouvriers prirent totalement le
contrôle de la ville. Les travailleurs d’Aschersleben prirent les
armes et marchèrent sur Quedlingburg, où, après de combats qui
coûtèrent une centaine de vies, « les ouvriers agricoles
étaient souvent maîtres de la situation ».20
La
plus grande ville de la région, Halle, était toujours dominée par
les Volontaires de droite. Des meetings de travailleurs votèrent
pour la constitution d’un commandement militaire et l’adjonction
d’éléments ouvriers aux Gardes Locales, mais ne purent briser
l’emprise des militaires sur la ville jusqu’à ce que des
travailleurs armés venant de la région assiègent la ville, formant
un véritable front militaire.21
Une bataille s’ensuivit, dans laquelle les ouvriers étaient en
nombre supérieur mais manquaient d’armes et de munitions. 106
personnes furent tuées dans la bataille, qui dura une semaine.
Venons-en
enfin à l’Etat (le Land) de Saxe (à ne pas confondre avec la
province prussienne du même nom), avec ses concentrations
industrielles autour des trois grandes villes de Chemnitz, Leipzig et
Dresde.
A
Chemnitz, les travailleurs remportèrent immédiatement de grands
succès. L’une des principales agences de presse d’Allemagne
rapportait :
Les
travailleurs règnenten maîtres à Chemnitz. Samedi un comité
d’action provisoire a été constitué avec trois membres venant
des sociaux-démocrates, des Indépendants et du Parti Communiste. Il
a immédiatement désarmé les Volontaires, expurgé les éléments
bourgeois de la Garde Locale (...) et armé 3 000 travailleurs
révolutionnaires. La poste, la gare des chemins de fer et l’hôtel
de ville sont occupés par la Garde Ouvrière. Les journaux
bourgeois sont interdits. (...) Dans les villes voisines aussi les
travailleurs ont pris le pouvoir entre leurs mains.22
Le
pouvoir ouvrier se répandit bientôt hors de la ville, les forces
militaires bourgeoises étant désarmées dans un rayon de 50
kilomètres alentour. Des élections furent tenues dans les usines de
Chemnitz pour remplacer le comité d’action des partis par un
conseil ouvrier. Les 1 500 délégués (un pour 50 ouvriers)
désignèrent un exécutif composé de dix communistes, neuf
sociaux-démocrates, un Indépendant et un Démocrate. Une armée
ouvrière fut constituée, avec à peu près les mêmes effectifs
pour les deux partis principaux, les communistes et les
sociaux-démocrates. Le conseil de Chemnitz devint bientôt l’axe
d’une structure de pouvoir ouvrier dans toute la région, appelant
à une conférence des délégués des conseils ouvriers du reste de
la Saxe et des parties limitrophes de la Thuringe et de la Bavière.
En fait, le niveau réel d’organisation
du pouvoir ouvrier était plus élevé que dans la Ruhr, où il n’y
eut jamais un tel degré de centralisation.23
La
raison d’un tel succès réside en partie dans la faiblesse
relative des forces réactionnaires dans la ville à l’époque du
putsch. Le désarmement de l’ennemi ne constitua pas le problème
politique majeur qu’il fut, par exemple, à Halle. Mais il faut
sans doute accorder plus d’importance à la direction politique du
mouvement ouvrier. Chemnitz avait le Parti Communiste le plus
puissant d’Allemagne, ce qui était le résultat des activités de
Heinrich Brandler et de Fritz Heckert, qui militaient dans les
mouvements socialiste et syndical locaux dès avant la guerre. Ils
avaient construit la Ligue Spartakus locale, y compris pendant les
jours les plus sombres de la guerre, et n’avaient pas fait l’erreur
de se lancer prématurément à la conquête du pouvoir en 1918-1919.
Ils prirent au sérieux les arguments insistants de Rosa Luxemburg, à
savoir que les communistes ne pourraient prendre le pouvoir tant
qu’ils n’auraient pas le soutien de la majorité de la classe
ouvrière, et s’étaient consacrés à construire ce soutien en
travaillant politiquement à briser les illusions que pouvaient
encore nourrir les travailleurs envers la social-démocratie.
En
ce qui concernait la réaction au putsch de Kapp, cela signifiait
qu’ils ne s’avisèrent ni de prendre le pouvoir eux-mêmes, ni
d’insister pour que les sociaux-démocrates s’engagent sur un
programme de dictature du prolétariat. Au lieu de cela, ils
proposèrent aux dirigeants SPD une action commune sur une liste de
revendications que ceux-ci pouvaient difficilement refuser si leur
résistance au putsch était sérieuse : la purge des éléments
petits bourgeois de la Garde Locale ; la transformation du
restant en armée ouvrière ; l’occupation des casernes des
Freikorps et la dissolution de ceux-ci ; la prise de contrôle
de tous les bâtiments officiels ; et l’élection dans toutes
les usines de délégués au conseil ouvrier.24
Les
dirigeants sociaux-démocrates furent contraints par leur propre base
à consentir à ces exigences, même si, étant les meilleurs
combattants, les communistes étaient destinés à recueillir le plus
de prestige de l’action commune. La mise en œuvre de ces demandes
impliquait la constitution d’une structure de
facto de pouvoir
ouvrier dans laquelle les travailleurs, aussi bien sociaux-démocrates
que communistes, étaient engagés – et permettait d’envisager de
persuader les travailleurs influencés par les sociaux-démocrates
que c’était de cette façon que la société devrait être
organisée dans l’avenir.
Malheureusement,
la transformation de la région de Chemnitz en noyau de pouvoir
ouvrier ne rencontra pas d’écho dans les deux autres grandes
villes de Saxe, Dresde et Leipzig.
Dresde
était le centre militaire de l’Etat, et son commandant, le général
Märcher, s’était, comme Watter dans la Ruhr, déclaré
« neutre »
entre le gouvernement et ceux qui soutenaient le putsch. Le mouvement
ouvrier local ne savait pas quelle réponse politique donner à cette
attitude. L’USPD était aussi influent que les sociaux-démocrates
– mais presque aussi bureaucratique. De telle sorte que tout se
résuma à une grève générale de vingt-quatre heures, qui en tant
que telle ne déboucha sur aucun conflit avec les forces de Märcher
– même si 50 personnes furent tuées lorsque les troupes tirèrent
sur un petit groupe de travailleurs qui avaient essayé de s’emparer
des bâtiments postaux. Le groupe communiste de la ville était
incapable d’une intervention réaliste dans la mesure où son
dirigeant, Otto Rühle, refusait par principe à appeler à une
action commune avec le SPD ou l’USPD.25
Leipzig
était un bastion de l’USPD. C’était aussi la base de 4 000
soldats partisans de Kapp. Le deuxième jour du putsch ces derniers
tirèrent sur une manifestation ouvrière, tuant 15 personnes. Les
travailleurs se procurèrent des armes comme ils purent – en
obtenant des centaines de Chemnitz et des usines d’armement de
Thuringe – et assiégèrent les troupes à l’intérieur de la
ville. Des combats acharnés firent rage pendant trois jours, jusqu’à
ce qu’un ministre social-démocrate du gouvernement d’Etat de
Dresde n’arrange un cessez-le-feu avec l’accord des dirigeants
Indépendants. Comme cela devait se produire si souvent dans
l’histoire de la Révolution Allemande, les militaires utilisèrent
les négociations pour dissimuler le renforcement de leurs positions.
Lorsque la vigilance des travailleurs sur les barricades se relâcha,
les troupes firent mouvement pour attaquer, réussirent une percée
et purent prendre le contrôle de la ville.
En Allemagne du Nord et ailleurs
Dans
une seule autre région le tempo de la lutte avait atteint celui de
la Ruhr et de l’Allemagne centrale : la côte du Nord – une
zone qui ne s’était pas spécialement manifestée dans le passé
par des traditions de lutte révolutionnaire. Pourtant à Wismar la
république des conseils fut déclarée et à Rostock 1 000
réactionnaires furent désarmés, les armes servant à la création
d’une armée ouvrière.
Le
même activisme – mais pas toujours la même réussite – se
retrouvait dans les zones agricoles situées à l’est de l’Elbe.
Dans de nombreux districts les salariés agricoles, non contents de
se joindre à la grève, désarmèrent les troupes soutenant le
putsch. Ils saisirent des fusils dans des unités de police isolées,
des Gardes Locaux et des transports ferroviaires, et les utilisèrent
pour prendre le contrôle des villages et des villes.
Ce
qui était significatif dans ces actions était que des travailleurs
sociaux-démocrates (les communistes n’existaient pratiquement pas
dans ces régions) se comportaient de la manière qui avait été
auparavant celle des communistes et des Indépendants de gauche. Ils
avaient été appelés à cesser le travail par leurs dirigeants
syndicaux sociaux-démocrates – alors que dans les zones rurales la
répression militaire était telle qu’elle rendait toute grève
impossible sans recours à la résistance armée. Tout ce que les
dirigeants sociaux-démocrates avaient dit à leur base sur la
nécessité de « respecter les forces de la loi et de
l’ordre »
devait être oublié si on voulait que la grève à laquelle ces
mêmes dirigeants avaient appelé ait un semblant de réalité.
C’était
vrai d’une grande partie de l’Allemagne. Dans de nombreux
endroits, les uns après les autres, la grève amenait inévitablement
à des affrontements avec les militaires, même s’ils
n’atteignaient pas l’échelle de l’Allemagne centrale et de la
Ruhr. A Nuremberg, par exemple, 22 manifestants furent tués par
l’armée, et les travailleurs furieux tentèrent de prendre
d’assaut les postes de police. A Stuttgart, 47 usines élirent des
conseils ouvriers. A Hanau, des travailleurs essayèrent de détourner
des transports de troupes se dirigeant vers la Ruhr. A Kiel, des
ouvriers se battirent avec des fusils contre les partisans du putsch
– et gagnèrent par là même le soutien des rangs inférieurs de
la marine, qui se mutinèrent contre leurs officiers.
Le
paysage n’était pas homogène. Dans deux des centres de l’orage
de 1918-1919, Hambourg et Brême, il ne se passa pas grand-chose. A
Hambourg, le gouvernement d’Etat social-démocrate se borna à
incorporer 1 000 travailleurs dans la Garde Locale. A Brême,
seuls les cheminots se joignirent à la grève. De façon
surprenante, Berlin était aussi relativement calme. La grève y
était absolument solide, mais il fallut attendre le quatrième ou le
cinquième jour pour assister à des soulèvements armés dans les
faubourgs ouvriers, et aucun n’atteignit le niveau de ceux de la
Ruhr ou de l’Allemagne centrale.
En
définitive, les généraux avaient, dans leurs efforts pour enterrer
les derniers vestiges d’une première révolution, provoqué les
débuts d’une seconde. La situation ressemblait à ce que sera
l’Espagne de juin 1936 après le soulèvement militaire franquiste.
Le coup d’Etat militaire d’extrême droite provoqua un
contre-soulèvement de la part des travailleurs, qui ne pouvaient se
borner à attaquer les partisans avérés du putsch. Les travailleurs
comprenaient que si Kapp et Lüttwitz réussissaient, le reste de
l’armée se rangerait bientôt derrière eux. C’était le corps
des officiers dans son ensemble qui était pris de nostalgie des
jours d’avant Novembre, et pas seulement une poignée d’excités.
Beaucoup
de travailleurs s’étaient opposés aux Spartakistes en janvier
1919, étaient restés passifs quand les Freikorps avaient marché
dans Berlin et dans Brême, avaient considéré les grévistes de la
Ruhr comme des extrémistes, et avaient accepté les raisons des
sociaux-démocrates dans l’écrasement de la République des
Conseils de Bavière. Désormais ils voyaient que non seulement les
« extrémistes » mais eux-mêmes étaient l’objet d’une
agression, et ils suivirent l’appel des Indépendants de gauche et
des communistes à détruire la structure de pouvoir qui avait rendu
possible le putsch de Kapp. Ce faisant, ils commencèrent à créer
des structures de pouvoir nouvelles – celles du pouvoir ouvrier –
aux côtés des anciennes.
Trois
ou quatre jours après le putsch, l’autorité de l’Etat ne
s’exerçait plus dans certains des centres industriels essentiels
de l’Allemagne. Les forces militaires, qui avaient dominé le pays
en marchant d’une frontière à l’autre en 1919, avaient connu la
défaite au combat. Elles commencèrent à perdre pied à partir du
moment où elles étaient confrontées, non pas à une section des
travailleurs qui luttaient pendant que les autres se tenaient
tranquilles, mais des soulèvements simultanés dans de nombreux
endroits différents. Pour couronner le tout, la grève des chemins
de fer les empêchait d’envoyer des troupes fraîches pour soulager
les garnisons locales assiégées.
Kapp se retire
A
Berlin, les partisans de Kapp se retrouvaient dans une situation
confuse. Ils avaient effectué un coup d’Etat militaire
impeccable : en termes militaires, c’était une opération
couronnée de succès. La moitié de l’armée les soutenait et
l’autre moitié attendait d’être sûr que le putsch était
réussi pour faire de même. Les partis de droite les
reconnaissaient.
Pourtant
ils ne pouvaient rien faire face à la grève générale et aux
insurrections locales – parce que toute la puissance de l’armée
était annulée une classe ouvrière unie et déterminée. Dans une
tentative désespérée de briser la grève, Kapp fit distribuer un
tract, le troisième jour, décrétant l’exécution des grévistes
– et, incapable de mettre la mesure en pratique, la retira quelques
heures plus tard. « L’Etat fort » construit par Noske
avait des pieds d’argile qui s’écroulaient rapidement. Kapp et
Lüttwitz avaient proclamé un « gouvernement
d’action »
– mais ils furent paralysés, la plus simple mesure ne pouvant être
exécutée.
Kapp
et ses partisans avaient espéré recueillir l’allégeance d’une
section des travailleurs grâce à la collaboration de l’extrême
aile droite de la social-démocratie. « Severing, Heine et
Sudekum avaient la confiance des kappistes ».26
Mais l’intensité de l’émotion au sein du SPD empêcha les
dirigeants de mériter cette confiance – à l’exception de
Winnig, le social-démocrate qui présidait aux destinées de la
Prusse Orientale. Les kappistes se retrouvèrent isolés, incapables
d’agir, dans une situation militaire qui se détériorait
rapidement.
Les
partis bourgeois de droite qui avaient reconnu le gouvernement de
Kapp commencèrent à avoir des doutes. Le biographe de Stresemann
raconte comment « Les porte-parole [des partis bourgeois]
commencèrent à s’alarmer des rumeurs d’un soulèvement
communiste à Berlin ».27
Ils pressèrent les généraux insurgés de passer un compromis avec
le gouvernement social-démocrate avant qu’il ne soit trop tard.
Lüttwitz
était la tête militaire du putsch – mais des craintes semblables
avaient agité beaucoup de ses officiers dès la fin du troisième
jour. Ce soir là le Bataillon du Génie des Gardes de Berlin se
mutina, arrêta ses officiers et ses proclama en faveur du
gouvernement Ebert. La police de sécurité commença à changer de
camp. Lüttwitz fut averti par ses officiers que « d’autres
troupes étaient au bord de la mutinerie » et qu’il devait
démissionner.28
Puis Kapp lui-même eut une attaque de nerfs et s’enfuit ventre à
terre, laissant à Lüttwitz le bébé agonisant.
Ce
qui se produisit alors devait être d’une importance déterminante
pour toute l’histoire postérieure de la République de Weimar. Les
partis gouvernementaux, les sociaux-démocrates à leur tête,
avaient l’occasion de briser une bonne fois pour toutes l’emprise
de l’extrême droite sur les forces armées. Ils ne la saisirent
pas. Bien au contraire, ils s’employèrent à mettre hors de cause
la plupart des personnalités qui avaient rendu le coup d’Etat
possible. Ebert, Noske et ses amis, même lorsqu’ils avaient fui
Berlin en proie à la terreur, n’avaient pas abandonné toute foi
dans les généraux qui avaient organisé le putsch d’extrême
droite. Ils firent un appel aux travailleurs selon lequel il fallait
« éviter toute effusion de sang » (après avoir
eux-mêmes présidé un gouvernement qui ne s’était pas montré
avare du sang des ouvriers, 20 000 d’entre eux environ tués
par les Freikorps en 14 mois). Et ils avaient en partant laissé à
Berlin un intermédiaire entre les gouvernements rivaux, le
vice-premier ministre social-démocrate Schiffer.
Severing,
le ministre de l’intérieur (en exil) social-démocrate, alla
jusqu’à donner aux travailleurs de la Ruhr, le 16 mars,
l’instruction de ne pas gêner les mouvements des troupes qui
essayaient de prendre le contrôle de la région :
« Dans
les intérêts de l’ancien gouvernement, les mouvements de troupes
ne doivent subir aucune interférence ».29
Pourquoi ?
Parce que le chef de l’armée de la Ruhr, Watter, ne s’était pas
déclaré partisan de Kapp. Mais il ne s’était pas non plus
déclaré partisan du gouvernement – jusqu’à ce qu’il soit
clair que l’entreprise de Kapp était vouée à l’échec. Et ses
subordonnés avaient été des enthousiastes du coup d’Etat. Ils
avaient donné ensemble l’ordre de harceler et de réprimer la
grève générale appelée par le gouvernement
« légitime ».
Si les ordres de Severing avaient été obéis, cela aurait fait
pencher la balance de façon décisive du côté des insurgés.
Les
dirigeants des partis bourgeois (y compris ceux qui participaient au
gouvernement) étaient restés à Berlin pendant le coup d’Etat. A
la première opportunité, ils ouvrirent des négociations avec
Lüttwitz pour une solution « pacifique » du conflit.
Ils
en vinrent bientôt à un accord verbal acceptant certaines
revendications des putschistes – de nouvelles élections, que la
droite s’attendait à gagner (même s’il y avait eu des élections
seulement 13 mois plus tôt, les partis de droite considéraient de
nouvelles élections comme un « droit
constitutionnel »),
et une amnistie pour les officiers qui avaient soutenu le coup
d’Etat.
Mais
le mouvement populaire était déjà trop avancé pour que le
gouvernement puisse parvenir à concéder de telles demandes.
Lüttwitz lui-même semble avoir compris à ce stade que s’il se
maintenait au pouvoir, il serait renversé en quelques heures par une
réédition de Novembre 1918. Il se contenta des vagues promesses des
partis bourgeois, et fila sans demander son reste.
Le
gouvernement social-démocrate avait survécu à ses moments les plus
difficiles. Cependant ses premières pensées n’allèrent pas à
empêcher une répétition de ces moments en purgeant l’armée des
éléments putschistes, mais à mettre un terme à la grève et aux
soulèvements contre le putsch. Il plaça aux commandes de l’armée
l’homme que les putschistes eux-mêmes avaient désigné vers la
fin de leur aventure – Seeckt. A peine quatre jours plus tôt,
souvenons-nous, il avait refusé d’obéir à l’ordre de Noske lui
enjoignant de marcher contre le coup d’Etat.
Avec
Schiffer, au nom du gouvernement, il édita un tract qui fut lancé
par avion dans tout le pays : « La grève générale
s'effondre – Faites front contre le bolchevisme qui anéantit
tout ».30
Le groupe parlementaire social-démocrate fit usage d’un ton très
semblable lorsqu’il avertit que « la révolte junkeriste et
syndicaliste continuent à menacer l’Etat du peuple allemand. (...)
La grève générale ne frappe plus seulement les coupables de haute
trahison, mais aussi notre propre front ».31
Seeckt
lui-même « protégea » de nombreux putschistes,32
permettant aux officiers supérieurs les plus compromis de s’enfuir,
ne prenant pas de sanctions contre les partisans de Kapp qui
n’avaient pas manifesté trop ouvertement leurs sympathies, et
n’inquiétant aucunement les officiers subalternes.
Malgré
tout, les sociaux-démocrates avaient un problème. Leur capacité à
jouer un rôle politique reposait, en dernier ressort, sur leur
influence dans de larges couches de travailleurs. Et cette influence
était menacée. Tout le monde pouvait voir que tout ce qu’ils
avaient proclamé à cor et à cri, pendant l’année écoulée, sur
la « loyauté » d’officiers tels que Lüttwitz et
Erhardt s’était avéré faux. Dans tout le pays, des
sociaux-démocrates de base avaient fait grève et lutté aux côtés
de ceux qu’on leur avait appris à insulter, les Indépendants de
gauche et les communistes. Ils s’étaient fait tirer dessus par des
troupes que pratiquement tout le monde appelait les « Gardes
Noske ». Ils n’allaient pas accepter sans broncher un simple
retour à l’état des choses antérieur au putsch.
Ceux
qui étaient à la direction du parti se sentirent obligés
d’exprimer des regrets symboliques (même s’ils étaient dénués
de sincérité) pour ce qui s’était passé. Scheidemann lui-même
fit des discours dans lesquels il se montrait sévère envers Noske.
Le premier numéro du Vorwärts
qui parut après l’échec du putsch comportait des exigences :
Le
gouvernement doit être restructuré. Pas vers la droite, surtout
pas, mais vers la gauche. Nous avons besoin d’un gouvernement qui
s’engage sans réserve dans la lutte contre la réaction
militaro-nationaliste, et qui sache gagner autant que possible la
confiance des travailleurs sur une orientation de gauche.33
Une
quinzaine de jours plus tard, le ministre social-démocrate Wels
décrivait ainsi les problèmes de son parti :
« Comment
faire pour sortir le parti du chaos dans lequel il s'est trouvé
entraîné par le combat en commun contre la réaction? »34
– en d’autres termes, comment amener ses membres à s’identifier
avec leurs dirigeants nationaux, et non avec les éléments de gauche
qui étaient très récemment leurs compagnons de lutte.
Le
« problème » était particulièrement grave dans les
tout premiers jours qui suivirent l’échec du putsch. La fuite de
Kapp et de Lüttwitz n’avait pas automatiquement mis fin à la
grève générale, et ce dans la majeure partie de l’Allemagne, y
compris à Berlin. Et dans la Ruhr les combats continuaient. Dans
l’ensemble, les travailleurs étaient désireux d’obtenir des
garanties concrètes contre une nouvelle attaque de l’extrême
droite. Le climat était tel que les dirigeants syndicaux ne se
sentaient pas autorisés à donner l’ordre de la reprise. Legien
suggéra aux sociaux-démocrates, aux Indépendants et aux
communistes que la condition préalable d’une reprise du travail
serait une rupture complète avec les anciennes méthodes de
gouvernement, par la grâce d’un nouveau « gouvernement
ouvrier » issu des trois partis et des syndicats.
Il
ne faut pas exclure que Legien ait pu être sincère dans cette
suggestion. Il était certainement très préoccupé par les ennuis
que lui avait causé le flirt des ministres SPD avec les généraux
d’extrême droite. Mais il pensait sans doute aussi, comme les
dirigeants sociaux-démocrates bavarois au mois d’avril précédent,
que le meilleur moyen de mettre un terme aux sempiternelles critiques
de l’extrême gauche était de l’inviter à participer au
gouvernement, soit pour tempérer son action, soit pour la mettre
dans une situation où il serait aisé de développer contre elle une
opposition « modérée ». La proposition de
« gouvernement ouvrier » était à la fois une
échappatoire de la difficile situation dans laquelle se trouvaient
Legien et ses amis, et
un piège possible pour la gauche. Mais elle pouvait aussi constituer
une ouverture vers quelque chose de plus radical, malgré Legien,
dans la mesure où un tel gouvernement eût été responsable devant
les organisations de la classe ouvrière et non devant la majorité
bourgeoise du parlement.
Laquelle
de ces combinaisons de possibilités devait l’emporter dépendait
de la réponse de la gauche, et de la clarté avec laquelle elle
l’expliquerait aux travailleurs. Heureusement pour le capitalisme
allemand, la gauche ne fit aucune réponse claire.
Le
Parti Communiste finit par donner une réponse cohérente – mais
seulement après qu’un désaccord dans la direction ait abouti à
ce qu’une position adoptée lors d’une réunion du Centre soit
rejetée par une autre réunion le lendemain, et cette dernière
position elle-même renversée quelques jours plus tard. La position
finale était que, en tant que Parti Communiste, il ne pouvait
participer à un tel gouvernement parce que la majorité des
travailleurs n’était pas encore convaincue de la justesse du point
de vue communiste. Mais il considérerait un gouvernement des deux
partis sociaux-démocrates et des syndicats sous une lumière
différente d’un gouvernement Ebert-Noske. Comme le disait Rote
Fahne du 26 mars :
L'étape actuelle du combat, où
le
prolétariat n'a à sa disposition aucune force militaire suffisante,
où le parti social-démocrate majoritaire a encore une grande
influence sur les fonctionnaires, les employés et les autres couches
de travailleurs, où le parti social-démocrate indépendant a
derrière lui la majorité des ouvriers des villes, prouve que les
bases solides de la dictature du prolétariat n'existent pas encore.
Pour que les couches profondes des masses prolétariennes acceptent
la doctrine communiste, il faut créer un état de choses dans lequel
la liberté politique sera presque absolue et empêcher la
bourgeoisie d'exercer sa dictature capitaliste.
Le K.P.D. estime que la
constitution d'un
gouvernement socialiste sans le moindre élément bourgeois et
capitaliste créera des conditions extrêmement favorables à
l'action énergique des masses prolétariennes, et leur permettra
d'atteindre la maturité dont elles ont besoin pour réaliser leur
dictature politique et sociale.
Le
parti continuait en déclarant qu’il agirait comme une
« opposition
loyale » à ce gouvernement, tant que ce dernier
« n'attentera
pas aux garanties qui assurent à la classe ouvrière sa liberté
d'action politique, et tant qu'il combattra par tous les moyens la
contre-révolution bourgeoise et n'empêchera pas le renforcement de
l'organisation sociale de la classe ouvrière ». Etre une
« opposition loyale », disait-il, signifiait pour le
parti « ne pas préparer de coup d’Etat », tout en
conservant sa « une liberté d'action complète en ce qui
concerne la propagande politique en faveur de ses idées ».
La
formulation était bien construite. Elle fournissait une base
d’action commune avec les travailleurs sociaux-démocrates contre
les ministres de droite, sans rendre les communistes responsables des
actes d’un « gouvernement de gauche » qui
fonctionnait
encore dans les limites du capitalisme.
C’était
très semblable à la proposition de Lénine, en août-septembre
1917, de soutenir la majorité mencheviks-socialistes
révolutionnaires dans les soviets russes s’ils remplaçaient le
gouvernement de coalition avec les partis bourgeois par un
gouvernement d’union de tous les socialistes responsable devant les
soviets. Comme Lénine l’expliquait à ses camarades du parti :
(...)
nous pouvons, en tant que parti, proposer un compromis volontaire.
(...) à nos adversaires les plus proches. (...) aux
socialistes-révolutionnaires et aux menchéviks. Ce n’est qu’à
titre exceptionnel, ce n’est qu’en vertu d’une situation
spéciale qui, vraisemblablement, durera très peu de temps. (...) Ce
compromis serait que, sans prétendre à la participation
gouvernementale (impossible pour un internationaliste sans que soient
effectivement assurées les conditions de la dictature du prolétariat
et des paysans pauvres), les bolcheviks renonceraient à réclamer la
remise immédiate du pouvoir au prolétariat et aux paysans pauvres
et à employer les méthodes révolutionnaires pour faire triompher
cette revendication. (...) Les menchéviks et les
socialistes-révolutionnaires. (...) consentiraient. (...) à former
un gouvernement entièrement et exclusivement responsable devant les
soviets, auxquels serait transmis tout le pouvoir central et aussi
local.35
Malheureusement,
le comité central du KPD ne réussit pas à se mettre d’accord sur
sa version du « compromis » avant que les
négociations
sur la forme que devrait prendre le gouvernement à la suite du
putsch de Kapp ne soient terminées.
Les
Indépendants étaient encore plus confus. Leur droite aussi bien que
leur gauche étaient divisées par la proposition de Legien. Une
partie de l’aile droite, menée par Hilferding, voulait accepter –
elle voyait l’occasion d’obtenir des postes ministériels et
d’empêcher de nouvelles attaques de la part de la droite
militaire. L’autre section, derrière Crispien, proclamait qu’elle
« ne siégerait pas à la même table que les meurtriers des
travailleurs ». Crispien semble avoir été davantage motivé
par la peur d’indisposer ses partisans que par des principes
moraux, puisqu’il devait, à peine deux ans et demi plus tard,
rejoindre le parti des « meurtriers des
travailleurs » et
serrer la main tachée de sang d’Otto Wels.36
Sur
la gauche
des Indépendants il y avait ceux qui, comme Koenen, s’opposaient
au rejet pur et simple de la notion de gouvernement de tous les
socialistes, craignant que cela ne soit pas compris par les
travailleurs sociaux-démocrates dégoûtés de Noske, Ebert, Wels et
compagnie. A l’inverse, la plupart des Indépendants de gauche
furent d’accord avec Daümig lorsqu’il déclara qu’un
gouvernement SPD-USPD-syndicats serait une « simple
répétition » du gouvernement de novembre-décembre 1918.37
Il
y avait, évidemment, ce danger – Hilferding devait participer à
un gouvernement tout aussi mauvais que celui-là en 1923 – mais
lorsque la question fut posée en 1920, ce gouvernement aurait été
jugé par la masse des travailleurs sociaux-démocrates, beaucoup
d’entre eux armés, selon un simple critère : utiliserait-il
la force gagnée durant les derniers jours pour briser le corps des
officiers et les forces armées de la droite ? Eût-il manœuvré
de la même façon que le gouvernement SPD-USPD de novembre-décembre
1918, il y avait de grandes chances pour que les travailleurs
sociaux-démocrates joignissent leurs forces avec les
révolutionnaires contre le gouvernement et la droite. Ils auraient
été préparés à suivre les orientations de la gauche et à
prendre en mains la tâche de désarmer la contre-révolution, et la
classe ouvrière serait restée unie sur la défense des positions
gagnées dans la lutte contre Kapp.
Mais
rien de tout cela ne put être soumis à l'expérimentation. Les
Indépendants ne firent aucune réponse positive aux propositions de
Legien. Même s’ils n’étaient pas eux-mêmes prêts à
participer au gouvernement, ils auraient pu pousser pour un
gouvernement social-démocrate majoritaire de gauche, porteur d’un
engagement, clairement exprimé et doté d’un calendrier, de
désarmer les réactionnaires, leurs unités, les Freikorps, les
Volontaires et les Gardes Locaux de droite, et de renforcer les
organisations armées de la classe ouvrière. Cela, au moins, aurait
montré clairement à tous les travailleurs engagés dans la grève
et dans le soulèvement ce que les sociaux-démocrates étaient prêts
à faire. Si le SPD avait accepté de telles revendications, il
aurait donné lui-même aux travailleurs le feu vert pour continuer
la lutte et désarmer la droite. S’il les avait rejetées, ses
propres membres auraient vu que rien n’était offert en échange de
l’arrêt de la grève et de la restitution des armes.
Mais
l’USPD, unissant dans son sein des gens porteurs de conceptions
complètement différentes de la lutte pour le socialisme, était
incapable d’une telle clarté. Ses dirigeants refusèrent
simplement les propositions de Legien, le laissant négocier à son
idée avec le gouvernement.
Le
résultat fut un désastre. Quels que fussent les motifs de Legien,
cela faisait trop longtemps qu’il était un bureaucrate droitier
pour obliger ses vieux amis du SPD à s’engager clairement, sur un
calendrier, à désarmer la droite, en spécifiant les unités à
dissoudre, les noms des éléments à purger et la
manière dont cela
devait être effectué. Au lieu de cela, il accoucha d’un ramassis
de vagues promesses : « reconnaissance par le futur
gouvernement du rôle des organisations syndicales dans la
reconstruction économique et sociale du pays » ;
« le
désarmement et le châtiment immédiat des rebelles » (sans
spécifier qui étaient les rebelles) ; une « réforme
de
l'Etat sur une base démocratique » (sans préciser le sens à
donner à ces mots) ; aucune action contre « les
unités
de la Reichswehr et de la police fidèles lors du putsch »38
(là encore, aucune spécification – Watter et Märcher étaient-ils
loyaux lorsqu’ils refusaient d’aider le gouvernement ?).
C’est
sur cette base que les fédérations syndicales appelèrent à la
reprise du travail. Mais l’USPD et le comité de grève de Berlin
rejetèrent le texte. A Berlin la grève continuait. Mais elle
n’avait pas de perspectives claires, et dans d’autres régions du
pays, où les organisations de gauche étaient plus faibles, les
travailleurs ne voyaient pas l’intérêt de rester en grève s’il
n’y avait rien à y gagner. Petit à petit ils commencèrent à
reprendre le travail.
A
Berlin, d’autres négociations s’engagèrent. Mais le résultat
n’était toujours pas satisfaisant. Et le gouvernement savait que,
la grève s’affaiblissant, chaque journée écoulée jouait en sa
faveur.
Bauer,
le premier ministre social-démocrate, proposa un retrait des troupes
de Berlin, « aucune action offensive contre les travailleurs
armés », en particulier dans la Ruhr, et le recrutement en
Prusse de travailleurs dans des « détachements de
sécurité »
contrôlés par les syndicats. L’offre restait vague – aucune
mention des divers corps de Volontaires, ni de spécification des
unités de l’armée qui avaient été « déloyales »,
ou de ce qui arriverait aux policiers qui, à un moment ou à un
autre, s’étaient battus pour le putsch. Elle n’accordait aux
comités d’action et aux conseils ouvriers aucun pouvoir pour
traiter de ces affaires. Mais les Indépendants finirent par accepter
les propositions – les Indépendants de droite parlant d’une
« fin » de la grève, et la gauche, dirigée par
Daümig,
d’une « interruption » conditionnée au comportement
du
gouvernement.
Mais
les grèves ne sont pas des mécanismes que l’on peut brancher ou
débrancher à volonté. Leur succès dépend de la détermination
des grévistes, un certain élan dans la lutte, qui permet de croire
à la victoire. Une pause dans la lutte – ou parfois la seule
mention d’une telle pause – peut détruire cet élan, briser
l’unité et renvoyer les travailleurs vers leurs vies
individuelles. C’est la raison pour laquelle les grèves sont
presque toujours plus faciles à continuer, malgré les difficultés,
qu’à reprendre après une « interruption ».
La
grève durait à Berlin depuis dix jours. La confusion des
négociations avait provoqué chez beaucoup de travailleurs une perte
de clarté sur les objectifs. De nombreux centres de province
s’étaient déjà retirés du mouvement. L’appel à la reprise du
travail signifiait en fait l’arrêt de la lutte unitaire qui avait
neutralisé le putsch, sans
la moindre transformation radicale des structures du pouvoir
militaire qui avaient rendu ce putsch possible.
Pendant
ce temps, les ministères s’étaient remis au travail, on commença
à nouveau à obéir aux ordres des vieux fonctionnaires, et la
chaîne du commandement fut rétablie dans l’armée sous le
commandement de Seeckt. Pendant que les dirigeants ouvriers
hésitaient, la bourgeoisie se remettait de ses frayeurs et se
réorganisait.
Sa
position une fois raffermie, elle pouvait commencer à répliquer au
mouvement ouvrier. La presse commença à se plaindre du
« contre-gouvernement » des syndicats. Legien se vit
signifier que tout gouvernement devait disposer d’une majorité à
l’Assemblée – et donc être soutenu par au moins un des partis
bourgeois. Finalement, un nouveau gouvernement de coalition fut
constitué, très semblable à celui qui avait permis au putsch de
Kapp de se développer. Noske était trop compromis pour jouer un
rôle, mais il fut remplacé par un homme encore plus disposé à se
plier aux désirs du Haut Commandement (si cela était
possible !),
le politicien bourgeois Gassler, qui s’empressa d’accorder à
Seeckt une entière liberté de manœuvre.
Le retour des Freikorps
On
se rendit bientôt compte à quel point on avait raté le coche.
« Le
gouvernement n’a pas pris la moindre mesure pour briser le pouvoir
de la réaction et pour sauvegarder la démocratie contre de
nouvelles attaques », se plaignait peu après un Indépendant
de droite :
On n’a pas formé un seul
bataillon
d’ouvriers : au lieu de cela le chancelier, Bauer, a investi
Seeckt des pleins pouvoirs pour instaurer un régime de terreur
militaire. Une fois encore, la loi martiale règne dans tout le pays,
comme au temps de Noske. A Kopenik – pour ne mentionner qu’un des
nombreux incidents qui se sont produits dans les environs de Berlin –
l’Indépendant Futran et trois de ses compagnons ont été arrêtés
et fusillés. Futran était bien connu comme un politicien modéré,
innocent de la moindre peccadille.
Le 19 mars fut publié le
décret
gouvernemental qui conférait à Seeckt le pouvoir de constituer des
tribunaux d’exception et de proclamer la loi martiale. (...) Les
travailleurs qui (...) s’étaient armés et levés en défense de
la démocratie et pour désarmer les rebelles devinrent bientôt la
proie des gardes citoyennes réactionnaires, du corps des
Volontaires, ainsi que des corps de troupes qui avaient toléré les
rebelles avec une incontestable indulgence.
Les
travailleurs grévistes, ou ceux qui s’étaient armés pour
résister, devinrent bientôt des « spartakistes » et
des
« communistes’ » qui fomentaient une dictature
bolchevik, et qui devaient par conséquent être réprimés avec la
dernière rigueur. Ce qui s’était produit à Kopenik fut bientôt
répété ailleurs sur une grande échelle. Un incident survenu en
Thuringe peut être mentionné à titre d’exemple. Le 24 mars, Bad
Thal, en Thuringe, fut occupé par des Volontaires étudiants de
Marburg, et le maire du district fut enjoint d’indiquer la
résidence de quinze citoyens, qui furent sur le champ arrêtés et
emportés. Le matin suivant les corps des prisonniers, affreusement
mutilés, furent retrouvés au coin d’une rue. Les hommes,
désarmés, avaient été traités avec une affreuse cruauté par le
corps des étudiants nationalistes, aux cris de
« Fusillez-les !
» et « Nous voulons des cadavres pour nos cours
d’anatomie ».39
Dans
ce contexte, les partisans de Kapp eux-mêmes purent en toute liberté
remporter une victoire significative. En Bavière, au point culminant
du putsch, le commandement militaire local avait
« persuadé »
le gouvernement social-démocrate présidé par Hoffmann de
démissionner. Le pouvoir passa entre les mains d’un gouvernement
du Parti du Peuple Bavarois dirigé par Kahr – qui devait offrir
asile et protection pendant les trois années suivantes aux éléments
fascistes et nationalistes de toute l’Allemagne. Les
sociaux-démocrates locaux lancèrent en fait un appel conjoint
contre la grève générale avec le général Mohl, qui penchait vers
le soutien à Kapp. Lorsque Kapp disparut, ses protégés bavarois
restèrent au pouvoir.
Mais
les développements les plus significatifs eurent lieu dans la région
où les combats avaient été les plus durs pendant le putsch
lui-même, la Ruhr.
Pendant
qu’à Berlin les négociations suivaient leurs cours, l’armée de
Watter dans la Ruhr restait sous la pression de l’Armée Rouge de
la Ruhr. La résolution de la gauche à poursuivre la lutte se trouva
renforcée lorsqu’on découvrit des fournitures militaires envoyées
par Berlin à Watter pour qu’il les utilise contre elle.
Mais
même s’il fournissait des armes à Watter, le souci principal du
gouvernement de Berlin était de mettre un terme aux combats de la
Ruhr. Dans le sud de l’Allemagne, les cheminots avaient repris le
travail, ce qui rendait plus facile à la Reichswehr la concentration
de ses troupes autour de la Ruhr. Mais à Berlin, ce n’est qu’après
le 22 mars que les usines sous l’influence des Indépendants
acceptèrent d’arrêter la grève générale. Tout regain des
combats dans la Ruhr pouvait facilement mettre en danger le
raffermissement du pouvoir gouvernemental dans la capitale. De sorte
que, dès le premier jour de la reprise du travail à Berlin,
Severing – qui avait supervisé la répression de la Ruhr l’année
précédente – entama des négociations à Bielefeld pour faire
cesser les hostilités dans la Ruhr, au moins temporairement, et
gagner du temps pour le gouvernement. Il expliqua plus tard :
Je ne
pouvais et ne voulais approuver une nouvelle entrée des troupes dans
la Ruhr que si l'on pouvait garantir que cette entrée serait
effectuée dès le départ avec de telles forces que toute résistance
semblerait inutile aussi aux insurgés. Mais pour cela, il était
nécessaire de faire sortir du soulèvement la partie de la classe
ouvrière qui n’avait combattu que pour défendre la constitution.
(...) Les autorités ne pouvaient alors constituer une telle force,
même avec la meilleure des volontés. Les troupes en étaient
complètement incapables.40
Les
négociations ne comportaient pas seulement le gouvernement et ceux
qui avaient combattu les militaires, mais aussi les dirigeants de
tous les syndicats et des partis « démocratiques » de
la
région et les maires (le plus souvent membres de ces mêmes partis)
des grandes villes. Les forces ouvrières étaient représentées par
la direction du conseil ouvrier de Hagen. Mais, de façon
significative, il n’y avait aucun représentant d’Essen, ni des
zones où les combats continuaient.
La
transaction qui fut conclue – les « Accords de
Bielefeld »
– posait les bases d’un cessez-le-feu. Les troupes de Watter
devaient rester hors de la Ruhr ; une section de l’Armée
Rouge était autorisée à conserver ses armes à travers
l’incorporation dans la police des autorités locales ; le
reste de l’Armée Rouge devait rendre ses armes. Comme le traité
conclu à Berlin pour mettre fin à la grève générale, les Accords
étaient essentiellement caractérisés par leur imprécision. De
plus, ils laissaient intactes les forces de Watter et leur
permettaient de continuer à se renforcer.
Ce
qui est certain, c’est qu’ils permirent au gouvernement de gagner
le temps dont il avait besoin, et jetèrent le mouvement ouvrier dans
la confusion la plus complète.
La
section de l’Armée Rouge qui avait été représentée aux
négociations, du front de l’est de Hagen, considéra les Accords
comme une victoire et déposa les armes. Les travailleurs du front de
l’ouest qui, eux, n’étaient pas représentés à Bielefeld,
sentaient qu’ils étaient sur le point de chasser les troupes de
Watter de leur dernier bastion, la caserne de Wesel, et que de là
ils pouvaient s’emparer de son quartier général de Munster. Ils
dénoncèrent comme traîtres les signataires des Accords – y
compris les deux communistes de Hagen qui avaient été à Bielefeld
– et poursuivirent le combat.
Il
est clair que les deux positions étaient erronées. Rendre ses armes
et se retirer du front sur la foi d’un morceau de papier était une
folie, étant donné le passif de trahisons des sociaux-démocrates
depuis Novembre 1918. Continuer le combat était aussi déraisonnable,
la grève étant terminée dans toute l’Allemagne et les militaires
se renforçant chaque jour davantage. La position tactiquement la
plus sensée était celle que préconisa un représentant du Parti
Communiste de Berlin, Pieck, qui arriva dans la Ruhr le lendemain des
Accords : que l’Armée Rouge garde ses fusils et maintienne
son front, mais en évitant la bataille, rejetant clairement la
responsabilité de la reprise des hostilités sur Watter et Severing.
La signification d’une poursuite de l’effusion de sang aurait
alors été évidente pour les travailleurs du reste de l’Allemagne,
que l’on pouvait convaincre de passer à l’action en soutien à
la Ruhr.
En
définitive, si l’Armée Rouge tout entière avait soutenu l’une
ou l’autre des deux positions mauvaises, cela aurait été
préférable à ce qui se passa, une moitié allant d’un côté et
l’autre moitié de l’autre. Le gouvernement avait le prétexte
qu’il lui fallait pour faire revenir les troupes dans la Ruhr –
et trouva ce faisant devant lui une résistance diminuée. Les
travailleurs de la Ruhr se retrouvèrent avec la pire option
possible. C’était le prix qu’ils devaient payer pour l’échec
à construire un commandement centralisé, basé sur les conseils
ouvriers, pendant les journées euphoriques où les Armées Rouges
repoussaient les soldats de Watter.
Une
espèce de structure centrale vit bien le jour le lendemain de la
signature des Accords. Les délégués de 70 conseils se réunirent à
Essen avec les principaux chefs de l’Armée Rouge, élisant une
direction centrale. Mais cela prit encore deux jours pour que cette
dernière accepte la politique consistant à garder les fusils et
éviter le combat. Et elle ne pouvait faire appliquer ses décisions
sur le front de Wesel.
Il
était trop tard. L’équilibre des forces s’était déplacé en
faveur du gouvernement, qui en était conscient. Ses forces se
raffermissaient d’heure en heure, et il était capable de présenter
la poursuite des combats aux travailleurs des autres parties de
l’Allemagne comme la réédition du « putschisme
spartakiste » de 1919. Le chancelier, Müller, informa le
conseil central d’Essen qu’il ne pourrait y avoir de négociations
tant que les travailleurs n’avaient pas déposé les armes, et que
les Accords de Bielefeld n’étaient plus valables puisque l’Armée
Rouge « les avait rompus ».
La
guerre de classe est semblable à toute guerre sous un aspect :
le résultat n’est pas seulement acquis par l’équilibre absolu
des forces à un moment donné, mais aussi par la façon dont les
chefs dirigent leurs forces en fonction des forces et des faiblesses
de l’ennemi. Dans une guerre entre des armées aux forces à peu
près égales, une seule erreur de jugement peut mener de l’approche
de la victoire au désordre et à la désintégration. C’est
d’autant plus le cas dans la guerre de classe, où les forces
ouvrières ne sont pas des soldats conditionnés à l’obéissance
aveugle, mais des volontaires, dont l’engagement dans le combat
vient en grande partie de leur conviction que leur liberté est à
portée de main ; ils sont rapidement jetés dans le désarroi
lorsque l’élan en avant de la lutte est perdu. Cela peut être
juste une petite erreur qui ouvre la voie à la défaite – mais une
fois qu’elle est commise, le résultat peut être plus dévastateur
que si la bataille n’avait pas été livrée.
Dans
la Ruhr, une des plus grandes victoires de la classe ouvrière
allemande se transforma en une grande défaite. Au début avril, ce
qui avait été une action massive et disciplinée des travailleurs
s’était effondrée, avec d’un côté la démoralisation et la
passivité, et des attaques de guérilla isolées et des actes de
sabotage de l’autre. Lorsque Watter entreprit, le 4 avril, sa
nouvelle marche dans la Ruhr, personne ne pensait que la lutte armée
pouvait l’arrêter, et il ne rencontra aucune résistance. Mais
cela n’empêcha pas ses forces d’exercer les plus ignobles
représailles.
Ernst,
qui commandait l’Armée Rouge sur le front de Hagen, décrit
comment
Pendant
l’entrée des troupes dans Hamm, des travailleurs ont été
immédiatement arrêtés, et abattus sans procédure régulière. Le
comportement des soldats était méthodique. Le premier jour,
lorsqu’ils occupaient un lieu, tout était paisible. On laissait
même jouer des orchestres militaires les places des marchés. Le
deuxième jour, ils commençaient brusquement à arrêter et à
fusiller. Le meurtre des ouvriers était planifié. La lâche
bourgeoisie participa aussi à ces événements. (...) Les
travailleurs étaient pris dans leurs maisons et abattus. On peut
mesurer la brutalité de ces bêtes sauvages par le fait que 65
ouvriers des canaux ont été littéralement massacrés. Ils étaient
occupés à construire un pont à Haltern et n’avaient pris aucune
part aux combats. Quand la Reichswehr avança, ils se retrouvèrent
sous le feu des mitrailleuses. Ils se sont enfuis dans un hangar. La
Reichswehr y donna l'assaut en lançant des grenades. Il n'y eut
aucun survivant.41
Des
méthodes qui devaient plus tard être la marque du nazisme furent
alors expérimentées pour la première fois, contre des travailleurs
allemands et avec le consentement des ministres
sociaux-démocrates :
à Pelkum, 90 victimes de l’armée en marche furent enterrées dans
une fosse collective ; il y avait parmi les victimes des
femmes
et des jeunes filles vêtues d’uniformes d’infirmières.
L’armée nationale restaura
l’ordre
ancien par des exécutions de masse. De nombreux milliers de
travailleurs s’enfuirent devant cette terreur blanche, à laquelle
participèrent de nombreux officiers de Kapp, vers les zones occupées
[par les Français]. Après que le gouvernement leur eut assuré
qu’ils n’avaient pas à craindre des représailles, ils
rentrèrent, pour se retrouver victimes de cours martiales
d’exception qui prononcèrent des centaines de sentences de mort.
Parmi la
population des districts
de Düsseldorf, Münster et Arnsberg, une émotion intense fut
provoquée par les condamnations en masse.42
Il
n’y eut aucune action équivalente entreprise contre les forces
réactionnaires engagées dans le putsch initial. Personne ne fut
exécuté – de telles punitions étaient réservées à ceux qui
avaient combattu pour le « gouvernement légal ». Des
procédures furent entamées contre 540 officiers pour leur rôle
dans le putsch – mais jamais terminées. On laissa les chefs de la
conspiration s’échapper à l’étranger, puis au bout d’un an
ou deux on leur permit de revenir. Lüttwitz toucha même une
retraite de 18 000 marks jusqu’à sa mort. Les soldats de la
brigade Erhardt furent « punis » en étant envoyés
écraser les travailleurs dans la Ruhr. En fait, une seule peine de
prison fut prononcée – Jugow écopa de cinq ans.
Le résultat du putsch
Le
putsch de Kapp commença comme une offensive de l’extrême droite.
Au bout de deux jours, il avait donné lieu à une énorme
contre-offensive de la gauche, qui menaçait de détruire toute la
structure construite par la vieille classe dirigeante au cours des 14
mois précédents. Pourtant, en quelques semaines, la
contre-offensive elle aussi était au point mort. Le gouvernement
était reconstruit – mais pas à gauche. L’armée et les
Freikorps reprirent leurs marches à travers l’Allemagne. Et le
gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates satisfit l’exigence
de nouvelles élections émise par la droite, qui les gagna de très
loin (les Indépendants aussi firent des progrès, recueillant
presque autant de voix que le SPD – mais cela n’était pas
suffisant, en termes parlementaires, pour compenser les suffrages
obtenus par les partis de la droite).
Les
dirigeants sociaux-démocrates s’étaient unis avec la droite,
après les journées de Kapp, dans une offensive contre les
travailleurs en armes. Après quoi la droite se retourna contre eux.
Quelques mois après le putsch, ils furent éjectés du pouvoir au
profit d’un nouveau gouvernement présidé par le « républicain
modéré » Fehrenbach. De façon peu surprenante, on se mit à
considérer les journées frénétiques du putsch de Kapp comme étant
d’importance mineure, des notes en bas de page de l’histoire.
Pourtant
ces jours auraient pu apporter bien plus. Lénine les a comparés un
jour à l’époque de l’offensive de Kornilov contre le
gouvernement russe de Kérenski en août 1917. Les bolcheviks étaient
sortis de cette lutte comme le parti le plus puissant de la classe
ouvrière, qui avait à moitié pris le pouvoir dans le cours de la
lutte contre l’extrême droite. Il n’y eut qu’un pas des
combats contre Kornilov à Octobre Rouge. Mais les choses ne se
passèrent pas ainsi en Allemagne. Pourquoi ?
L’explication
la plus simple consisterait à invoquer des « circonstances
objectives » ou la « conscience non-révolutionnaire
des
ouvriers occidentaux ». Ce serait une façon de considérer la
question comme réglée.
Dans
des lieux comme Chemnitz, Halle, la Ruhr, même dans le Mecklenberg
rural et à Vogtland sur la frontière tchèque, les conséquences du
putsch furent
les mêmes qu’en Russie en août-septembre 1917. La vieille
structure militaire était vaincue, les travailleurs étaient armés,
dans de nombreux cas la réalité du pouvoir était exercée par des
conseils ouvriers. De plus, à la différence des journées de
Novembre 1918, c’étaient des conseils ouvriers à majorité
révolutionnaire. Cela n’aurait pas de sens de dire que les
circonstances objectives
étaient différentes dans ces endroits de ce qu’elles étaient
dans le reste de l’Allemagne. Comment est-ce que Chemnitz différait
« objectivement » de Brême, ou la Ruhr de Berlin,
pour
qu’il y ait un résultat révolutionnaire dans l’un et pas dans
l’autre ?
Pourtant,
on n’a pas assisté au développement d’une offensive contre la
vieille structure d’Etat dans les centres industriels. Dans
certaines grandes villes, la grève ne s’est pas transformée en
soulèvement armé ; dans un ou deux endroits, la grève
elle-même n’était pas très solide. Et dans beaucoup de lieux
elle était dirigée, non pas par les conseils ouvriers, mais par des
comités d’action dominés par des dirigeants – souvent les
bureaucrates – des « partis ouvriers » et des
syndicats.
Parler
dans l’abstrait de « conscience ouvrière de classe »
ne saurait expliquer ces écarts. les endroits dans lesquels la lutte
ne s’éleva pas
au niveau d’une confrontation armée intégrale comportent des
métropoles comme Hambourg, Brême, Leipzig et surtout Berlin – des
villes considérées généralement pendant cette période comme des
places fortes de l’extrême gauche ; et surtout des villes où
le parti, supposé révolutionnaire, des Indépendants jouissait du
soutien de la majorité de la classe ouvrière depuis 12 mois et
plus.
Ce
qui manquait, c’était une organisation solide, et une direction de
la classe ouvrière capable de se hisser au niveau de la conscience
engendrée par le putsch. La majorité des travailleurs regardaient
du côté des Indépendants pour avoir une orientation. Mais les
Indépendants de droite, au delà de leur bavardage
« révolutionnaire », souhaitaient par dessus tout un
retour à l’unité avec leurs vieux collègues de la direction des
sociaux-démocrates majoritaires. Et les Indépendants de gauche
n’avaient aucune structure leur permettant de mettre en œuvre des
décisions indépendamment de la droite.
Le
résultat était que la façon dont la conscience militante nouvelle
de la majorité des travailleurs pouvait se transformer en action
dépendait d’éléments relativement accidentels. Le facteur
« subjectif » était décisif, par exemple s’il y
avait, dans un district particulier ou dans une grande usine, des
révolutionnaires capables de prendre l’initiative d’appeler à
l’élection de conseils pour diriger la lutte armée – et
disposant d’assez d’influence pour faire accepter un tel appel.
Objectivement,
par exemple, la classe ouvrière de Chemnitz n’était pas « plus
révolutionnaire » que sa voisine de Leipzig. En fait, au début
de 1919 cela semblait plutôt être l’inverse – Leipzig était un
bastion des Indépendants alors que Chemnitz était toujours sous la
domination du SPD. La différence venait de ce que les communistes de
Chemnitz avaient réussi, au cours de 1919, à améliorer leur
pénétration dans le mouvement ouvrier local en dirigeant des luttes
« économiques » « partielles », au
point de
reléguer dans l’ombre les Indépendants et de mettre en péril
l’influence du SPD. Ils furent dès lors capables de prendre dès
le premier jour du putsch l’initiative d’appeler à la grève
générale, allant jusqu’à un appel à élire des conseils
ouvriers politiques, à désarmer la classe moyenne et à constituer
des détachements de travailleurs en armes.
A
l’inverse, à Leipzig, comme le communiste de Chemnitz Brandler le
déclarait au congrès de son parti un mois plus tard :
L'aile
gauche [des Indépendants] laissa Lipinski [un Indépendant de
droite] prendre la direction et négocia avec le gouvernement, sabota
l’élection de conseils ouvriers pour des raisons de parti. Ainsi,
la classe ouvrière fut divisée, au lieu d'être rassemblé, et pendant ce
temps [les troupes de Kapp] furent rassemblées pour la
défaite des travailleurs.43
Le
résultat de cet « accident d’influence » était d’une
importance nationale majeure. Brandler fit observer que Leipzig et
Chemnitz auraient pu, ensemble, contrôler la plus grande partie de
l’Allemagne centrale : « Ensemble, nous aurions pu
mettre la pression sur Dresde » (où le gouvernement s’était
d’abord enfui et où le chef de file des attentistes, le général
Märcher, était basé). « Non seulement nous aurions exigé le
démantèlement de l’ancien gouvernement, mais nous y aurions
procédé ».
Au
lieu de cela, les Indépendants de Leipzig appelèrent, avec les
sociaux-démocrates locaux, à la reprise du travail et à l’arrêt
de « la confrontation avec les troupes » au moment où
Kapp lui-même avait décampé. Ils ne songèrent pas un instant à
demander des garanties que des actions seraient engagées contre les
vieilles structures militaires.
A
Hambourg et à Brême, la situation semble avoir été encore plus
sombre. A Hambourg, 1 500 travailleurs sociaux-démocrates et
USPD furent armés – mais maintenus sous un contrôle étroit par
le gouvernement SPD de l’Etat en étant incorporés dans les Gardes
Locales et la police. La grève manquait d’un véritable
enthousiasme. A Brême, un « comité d’action » mis en
place par les « partis ouvriers » semble n’avoir fait
à
peu près rien.
A
Berlin, comme nous l’avons vu, les Indépendants de gauche
dirigèrent une grève massive qui commençait à se transformer en
soulèvement – mais qui ensuite ne sut pas traduire ses succès en
gains permanents.
Le Parti Communiste et les journées de
Kapp
Le
Parti Communiste avait été formé précisément à cause des
tergiversations des Indépendants dans des situations de ce genre.
Mais il n’était pas en état, au printemps 1920, de les défier à
l’échelle nationale. C’était une organisation extrêmement
faible. Même s’il était passé de trois ou quatre mille membres à
ses débuts à 110 000 à l’été 1920, il avait ensuite
scissionné. Le fragment résiduel autour de la direction du parti
avait très peu de force en dehors de Chemnitz et Stuttgart. Il
n’avait pratiquement pas de militants dans des villes essentielles
comme Hambourg, Brême, Hanovre, Dresde et Magdebourg. A Berlin, il
avait seulement « quelques centaines de membres »
(selon
un intervenant à son Quatrième Congrès), alors que les
Indépendants en avaient « 100 000 ».44
Brandler
déclarait au Troisième Congrès, à peine un mois avant le
putsch :
D’une
manière générale nous n’avons pas encore de parti. Et si je le
dis de manière si abrupte, c'est que je dois le faire après avoir
pris connaissance du mouvement en Rhénanie-Westphalie. (...) Et il
ne sera pas possible de mettre le Parti Communiste sur ses pieds dans
un avenir proche. (...) Justement lors de la lutte des mineurs et des
cheminots, il s'est révélé que nous n’avions pas la moindre
influence sur les travailleurs.45
Dans
les rares endroits où le parti existait, il donna le plus souvent
une orientation que les travailleurs suivirent pendant les journées
du putsch. Nous avons vu comment il s’était mis à la tête du
mouvement à Chemnitz ; à Stuttgart, le parti appela à la
grève générale et à l’armement des travailleurs dans la demie
heure qui suivit l’annonce du putsch de Berlin ; même dans la
Ruhr, les membres du parti isolés parvinrent à exercer une
influence sur le cours des évènements.
Le
point le plus faible était Berlin. Une réunion clairsemée de la
Centrale du Parti – Levi, par exemple, était en prison ;
Brandler était à Chemnitz – se tint le jour même du putsch. Elle
fit une erreur catastrophique. Elle fit une déclaration s’opposant
à la grève générale, définissant la lutte comme un combat
« entre deux ailes contre-révolutionnaires », et
poursuivant :
Ebert-Bauer-Noske
sont partis sans bruit et sans résistance dans leurs tombes. (...)
Alors qu’elle est en train de sombrer, cette société de
banqueroutiers appelle la classe ouvrière à la grève générale
pour « sauver la république ». (...) Le prolétariat
révolutionnaire ne lèvera pas le petit doigt pour le gouvernement
des assassins de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, tombé dans la
honte et la disgrâce. Il ne lèvera pas le petit doigt pour la
république démocratique, qui n’est que le masque misérable de la
dictature de la bourgeoisie.46
Le
lendemain, Rote Fahne
expliquait que les travailleurs n’étaient pas assez forts pour une
grève générale !
Les
travailleurs doivent-ils, à cet instant, se mettre en grève
générale ? La classe ouvrière, hier encore attaquée par
Ebert et Noske, désarmée, subissant la pire des oppressions, n’est
pas prête pour l’action à cet instant. Nous pensons que c'est
notre devoir de le dire clairement. La classe ouvrière engagera la
lutte contre la dictature militaire au moment et avec les moyens qui
lui paraîtront appropriés. Ce moment n’est pas encore venu.47
Les
14 et 15 mars, la Centrale fit volte-face, soutenant désormais la
grève : il pouvait difficilement faire autrement, dans la
mesure où la grève connaissait un succès grandissant. Mais il
n’appelait toujours pas à l’armement
de la classe ouvrière – même si les meilleurs militants
communistes de province, non seulement y appelaient, mais y
procédaient dans la pratique. Même le lundi, le troisième jour du
putsch, alors que les premiers affrontements armés éclataient en
Allemagne centrale et dans la Ruhr, le parti n’alla pas plus loin
que l’appel à la grève générale et à l’élection de conseils
ouvriers. Au lieu d’appeler les ouvriers aux armes, il
avertissait : « Travailleurs, ne descendez pas dans
les
rues. Réunissez-vous tous les jours dans les usines. Ne vous laissez
pas provoquer par les Gardes blancs ».
Pour
l’essentiel, la façon dont le parti essayait de façon centrale de
se distinguer des sociaux-démocrates, des Indépendants et des
dirigeants syndicaux passait par des attaques verbales contre Ebert
et Noske :
Pour
la grève générale. A bas la dictature militaire. A bas la
démocratie bourgeoise. Les communistes sont contre le gouvernement
Ebert-Noske, contre le rétablissement du gouvernement sur une base
bourgeoise, avec le parlement et la bureaucratie d’Etat.48
Le
meilleur commentaire de ces déclarations est contenu dans une lettre
adressée à la Centrale écrite par un de ses membres, Paul Levi,
qui était temporairement en prison :
Je viens à l’instant de lire
les
tracts. Mon jugement : le KPD est menacé de faillite morale et
politique. Il m'est incompréhensible que dans cette situation on
puisse écrire des phrases telles que « la classe ouvrière
n’est pas prête pour l’action aujourd’hui ». (...) Après
avoir dit le premier jour que les travailleurs n’étaient pas prêts
pour l’action, le lendemain on sort un tract :
« Maintenant,
enfin, le prolétariat allemand doit engager la lutte pour la
dictature prolétarienne et la république communiste des
conseils ».
(...) J’ai toujours pensé que nous étions clairs et unis sur
ceci : lorsqu’une action se produit – même pour le buts le
plus délirant ! (...) nous nous joignons à l’action, pour que nos
slogans puisse la détourner du but délirant (...) et nous ne
hurlons pas au départ : « Ne bougez pas le petit
doigt ! » si le but ne nous convient pas.
Nous devons donner des slogans
concrets.
Dire aux masses ce qui doit être fait dans l’immédiat !
(...) La république des conseils vient en dernier et non en premier.
J’ai l’impression que personne ne pense aux élections aux
conseils d’usine à présent. Le seul slogan du moment présent
c'est : « Armement du
prolétariat ! ».
Une
grève doit comporter des revendications ! Il faut savoir ce
qu'on peut gagner directement par la grève. (...) Avec ces slogans
le KPD aurait pu donner un « visage » à la grève,
qu’elle n’a pas encore. (...) C’est alors, et alors seulement,
lorsque les masses auront repris nos revendications et que les
« dirigeants » se seront refusé à les défendre, ou
même les auront trahies, c’est alors que de l'action naît la
revendication d'autres revendications, c'est à dire de conseils !
Des conseils, un congrès des conseils, une république des conseils,
« A bas la république démocratique’ », etc ;
toutes ces revendications s’élèvent d'elles-mêmes lorsque les
revendications de la grève sont satisfaites. (...) Une fois les
revendications satisfaites, la république doit basculer à gauche.
(...) Une fois les revendications satisfaites, la force qui tient la
république est le prolétariat, et son gouvernement, quel que soit
le nom qu’il se donne, est la figure de proue de ces forces
sociales complètement changées. De là à la république des
conseils il y a un laps de temps de six mois de développement
normal !49
Le
jugement de Levi sur l’inanité des tracts de la Centrale était
indubitablement correct. Mais comment la Centrale en était-elle
venue à commettre de telles bévues ?
On
disait par la suite, dans le parti, que la direction avait été
« lente » et « déconnectée », basée
à
Berlin où les effectifs du parti étaient maigres et peu enracinés
dans la masse ouvrière. Au surplus, il y avait le souvenir de la
séquence souvent répétée de 1919, lorsque les sociaux-démocrates
poussaient les communistes à mettre leur tête sur le billot. Une
direction qui n’avait pas un accès immédiat à la classe à
travers un réseau de militants expérimentés ne pouvait pas sentir
que, ce coup-ci, des millions de travailleurs jusque là passifs
allaient répondre à l’appel des dirigeants syndicaux, et ne
laisseraient pas les communistes agir – et mourir – seuls.
Nous
ne devons pas oublier qu’à peine 12 mois plus tôt, en mars 1919,
ce qui avait commencé comme un mouvement uni de toute la classe
ouvrière de Berlin s’était terminé dans un bain de sang, dans
lequel les communistes et les Indépendants de gauche avaient été
massacrés en masse. En ce sens, l’erreur de la Centrale était une
erreur qui vint empoisonner de façon répétitive la Révolution
Allemande – une sur-compensation des fautes passées. Au lieu
d’apprendre suffisamment du passé pour pouvoir agir dans le
présent, les dirigeants révolutionnaires semblaient condamnés à
vivre un cercle vicieux, dans lequel une défaite créait la
confusion qui rendait la défaite suivante inévitable.
Mais
la timidité ne saurait être la seule explication des déclarations
qui furent faites. Cela n’explique pas le signe égal qui fut mis
entre le gouvernement social-démocrate, aussi ignoble fut-il, et une
dictature d’extrême droite.
L’explication
réside dans la tentation, qui restait forte dans la direction du
parti, du « gauchisme », que la scission n’avait pas
éliminé. C’était particulièrement vrai dans les faibles
districts berlinois sous la direction d’Ernst Friesland. Les
déclarations sur le putsch de Kapp exprimaient ce
« gauchisme »
sous une forme qui en même temps permettait l’abstention de la
lutte de masse – une combinaison favorite des petites sectes
ultra-gauchistes qui peuvent ainsi garder la pureté de leurs
principes sans courir le risque de l’action.
Lors
de la conférence du parti tenue un mois plus tard il y eut une
grande discussion sur la réaction du parti au putsch de Kapp. La
question était essentiellement de savoir s’il avait eu raison de
se joindre à l’appel pour un « gouvernement ouvrier »
d’union SPD-USPD. Paul Levi fit remarquer qu’au moment où on lui
demanda au parti son opinion sur ce sujet, il avait très peu
d’influence. Il n’avait rien eu à dire au début de la lutte ;
pourquoi l’écouterait-on maintenant ?
Il
demandait : « Le KPD a-t-il avancé des slogans qui
lui
ont apporté un crédit politique et moral lui permettant de diriger
lorsque d’autres facteurs l’en empêchaient ? »
Le
fait de ne pas avoir pris la direction dès le samedi du putsch avait
des conséquences :
Jusqu'au
samedi 13 mars la direction des masses était visiblement entre les
mains des cinq fédérations syndicales et de l’aile droite de
l’USPD. Les masses n’étaient pas habituées à suivre une autre
direction. Et maintenant, après cinq jours d'une grève dans
laquelle la ville tout entière était au point mort, dans laquelle
pas une roue ne tournait dans une grande ville, sans aucun convoi de
ravitaillement, sans lumière, sans gaz, une ville complètement
morte, après cinq jours, est-ce que la Centrale du parti, qui
n’avait joué jusque là aucun rôle, pouvait lancer un appel à
redoubler d'efforts dans la lutte ? Si nous avions pris la
direction au début, alors oui, cela aurait été possible après
l'appel à terminer la grève.50
Les communistes dissidents
Ceux
qui avaient rompu avec le Parti Communiste parce qu’il était
« trop à droite » étaient eux-mêmes incapables de
fournir une quelconque direction nationale. A Hambourg, le district
des communistes dissidents sous la direction de Laufenberg et
Wolffheim sortit un tract qui disait : « La grève
générale est une absurdité générale » et ne modifia plus
sa position. Le résultat était qu’il n’y avait pas de présence
communiste dans la ville pour compenser la passivité des
sociaux-démocrates.51
A
Mannheim, le conseil ouvrier sous l’influence des syndicalistes
demanda aux travailleurs de ne pas descendre dans les rues et de
« prendre le pouvoir sur le lieu de la production »
en
faisant fonctionner les usines sous le contrôle des travailleurs. En
réalité, cela signifiait refuser de s’opposer au pouvoir des
partisans de Kapp, des troupes, des Volontaires et de la police.52
Dans
la Ruhr, de nombreux communistes dissidents jouèrent un rôle très
positif et courageux en organisant des détachements de combat et en
les incorporant dans l’Armée Rouge. Ce qui leur manquait, c’était
la conception de chaque bataille comme devant faire partie d’une
lutte unifiée, prenant en compte des considérations stratégiques
et politiques. Ils finirent par se couper des conseils ouvriers et
s’engagèrent dans des actions isolées de guérilla, qui faisaient
le jeu de Watter et de Severing. Levi a affirmé qu’en menaçant de
faire sauter les puits ils braquèrent de nombreux mineurs contre
eux, à tel point que certains étaient prêts à considérer les
troupes de Watter comme des « libérateurs » – on ne
pouvait s’attendre à ce que les mineurs accueillent favorablement
la destruction des seuls emplois dans des villages où ils
travaillaient comme l’avaient fait leurs pères et leurs
grand-pères avant eux.53
« En
Rhénanie-Westphalie [en d’autres termes la Ruhr] un système de
conseils complètement développé fut construit, qui reflétait
fidèlement la volonté des travailleurs » expliquait Levi.
Mais « contre la volonté des conseils, des camarades
individuels pensaient qu’ils pouvaient faire la révolution par
dessus la tête de cette représentation ».54
Ce
que l’on peut dire avec certitude, c’est que si le Parti
Communiste ne s’est pas manifesté au bon moment le 13 mars, ceux
qui s’étaient éloignés de lui « sur la gauche » se
montrèrent incapables de fournir quelque stratégie ou tactique que
ce soit.
Une occasion manquée
La
lutte contre le putsch de Kapp s’ajoute à la longue liste des
occasions manquées de l’histoire de la Révolution Allemande –
une liste qui se termine en 1933 avec la plus grande tragédie du
20ème
siècle. Et la raison fondamentale en était l’incapacité de
l’organisation et de la direction révolutionnaire de se situer au
niveau du brusque bond en avant de la conscience de la classe
ouvrière.
Un
des dirigeants révolutionnaires concluait, huit ans plus tard :
Dans
les rangs de la Ligue Spartakus, et par dessus tout dans sa direction
à l’époque du putsch de Kapp, se reflètent toute les faiblesses
idéologiques de la Révolution Allemande. (..) Ainsi, le manque d’un
parti communiste fort, idéologiquement mûr, implanté dans les
masses, a été la cause déterminante du recul subi par la
révolution prolétarienne en Allemagne lors du putsch de Kapp.55