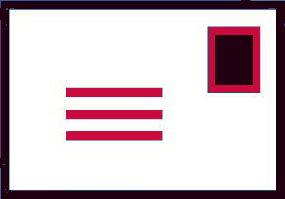A
la fin de l’été 1919, la nouvelle république bourgeoise semblait
s’être stabilisée. Les conseils ouvriers avaient été éliminés,
les milices de travailleurs désarmées, les discours sur la
« socialisation » étaient en recul. Les drapeaux
rouges
et les soldats mutins ne semblaient plus, pour les classes moyennes,
qu’un cauchemar lointain.
Tout
n’était pas tout rose, cependant, pour les sociaux-démocrates au
pouvoir. Ils avaient pu briser les divers soulèvements et grèves
générales parce que leur influence restait assez grande pour
obtenir que la majorité des travailleurs reste passive pendant que
les Freikorps occupaient les différentes régions l’une après
l’autre. Mais l’emprise du SPD commençait à faiblir. D’abord,
parce que de plus en plus de travailleurs voyaient de leurs yeux que
c’étaient les Freikorps, et non les « spartakistes »
ou les « bolcheviks », qui créaient le désordre.
Mais
le plus important était que les travailleurs étaient contraints par
la situation économique à engager la lutte sur le terrain des
salaires, et le gouvernement ne pouvait garder le contrôle qu’en
dirigeant sur la masse des salariés la répression jusque là
réservée aux « spartakistes ».
La
guerre mondiale avait dévasté l’économie allemande. Le pays
avait été coupé du marché mondial et dirigé comme une économie
de guerre pendant quatre ans, il ne pouvait continuer à fonctionner
qu’en maintenant le niveau de vie des travailleurs en dessous de la
subsistance à long terme. A la fin de la guerre, les puissances
victorieuses s’étaient emparées des anciens marchés de
l’Allemagne. La production industrielle était en 1920 la moitié
de celle d’avant-guerre. L’Allemagne était également contrainte
par les termes du traité de Versailles à livrer un quart de sa
production de charbon comme « réparation » à la
France,
à la Belgique et à l’Italie.
Cela
signifiait que pour les travailleurs allemands les conditions de vie
du temps de guerre continuaient, avec des pénuries aiguës de
produits alimentaires et de combustible. La consommation de viande
était tombée à 37 % de son niveau d’avant-guerre ;
celle de farine à 56 % ; celle de café à
28 %. Et
les prix furent multipliés par dix entre 1913 et 1920. Pour
couronner le tout, le chômage augmentait rapidement au fur et à
mesure de la démobilisation.
Pourtant
les travailleurs émergèrent de la Révolution de Novembre avec la
conviction qu’au moins leurs revendications économiques
traditionnelles seraient satisfaites. Ils rejoignirent en masse les
syndicats. Avant la révolution, il y avait 1,5 million de
syndiqués ; au début de décembre 1918 il y en avait 2,2
millions, en décembre 1919, 7,3 millions.
Le
chiffre des grèves explosa également :1
|
|
Nombre de grèves
|
Unités (usines) touchées
|
Journées
|
|
1918
|
773
|
7 397
|
5 219 290
|
|
1919
|
4 970
|
51 804
|
48 067 180
|
|
1920
|
8 800
|
197 823
|
54 206. 942
|
La
plupart des grèves concernaient les salaires. Mais elles se fixèrent
bientôt des buts, sinon toujours politiques, du moins
semi-politiques : le droit des fonctionnaires et des cheminots
à
s’organiser, les pouvoirs des conseils d’usine, la question de la
socialisation. Par dessus tout, un gouvernement qui s’était engagé
sur la voie du rétablissement des fortunes du capitalisme allemand
ne pouvait éviter de passer à l’action politique contre
les grèves. Nous avons vu comment les troupes avaient occupé les
puits pendant la grève pour les six heures dans la Ruhr. Elles
furent à nouveau mises en action pendant une grève nationale des
chemins de fer, arrêtant les piquets, et pendant une longue grève
de 150 000 travailleurs de la métallurgie de Berlin, qui dura
d’août à novembre.
A l’été
1919, Noske créa une
unité spéciale de briseurs de grève, la Technische
Nothilfe
(« service technique d'urgence »
En janvier 1920 son collègue Heine, ministre de l’intérieur de
Prusse, fit un pas de plus. Confronté à une énorme manifestation
appelée par les Indépendants devant le Reichstag, qui concernait
les dispositions d’une nouvelle loi régissant les conseils
d’usine, il concentra des forces militaires dans le centre de la
capitale. Après quelques bousculades avec les centaines de milliers
de manifestants, les troupes se déchaînèrent. Il y eut « un
feu terrible de mitrailleuses qui dura plusieurs minutes, devant
lequel la foule se dispersa en proie à la panique ».2
On releva 42 morts
et 105 blessés. Par la suite « non seulement les ministres
sociaux-démocrates proclamèrent avec insistance que les troupes
s’étaient comportées tout à fait correctement, (...) mais ils
déplacèrent la responsabilité finale sur les Indépendants et les
Communistes. (...) Le sang des morts, déclara le chancelier du Reich
Bauer, est sur les mains des Indépendants. »3
Un
certain nombre de dirigeants révolutionnaires, parmi lesquels
l’Indépendant de gauche Daümig, furent arrêtés et maintenus en
détention pendant des mois. Trente journaux, indépendants et
communistes, furent interdits. Un nouveau décret gouvernemental
prévoyait des peines d’emprisonnement pour les grévistes dans les
« services essentiels » tels que les mines, les
chemins
de fer, l’électricité et le gaz. Lorsque les junkers entreprirent
de réprimer les salariés agricoles en Prusse orientale, Noske
s’empressa de leur fournir des troupes.
Les
travailleurs avaient massivement rejoint les rangs sociaux-démocrates
dans la première excitation de la révolution. Ses effectifs,
réduits à 243 000 par la scission de 1917, grimpèrent à
1 012 800 en 1919. Beaucoup étaient des travailleurs
qui
« pendant la guerre avaient été conservateurs, libéraux ou
pangermanistes », comme le rapporta Wels au congrès du SPD de
1919. Le même afflux de soutien fut démontré par les élections de
janvier 1919. Le SPD s’y affirma comme le parti le plus important
avec 11,5 millions de voix, par comparaison avec l’USPD et ses 2,5
millions de suffrages. Le progrès du SPD était le plus remarquable
dans les régions les moins industrialisées du pays : en Prusse
Orientale, il obtint 50,1 % des voix alors qu’il n’en avait
eu que 14,8 % en 1912 ; en Poméranie, 41 %
contre
24 %.
Mais
la déception s’installa bientôt. Même aux élections de janvier,
les sociaux-démocrates majoritaires ne conservèrent pas
l’allégeance des ouvriers des plus grandes villes. A
Halle-Merseberg, le SPD obtint seulement 16,3 % des voix, les
Indépendants 44,1 ; à Leipzig le SPD fit 20,7 %, les
Indépendants 38,6. Ailleurs le SPD obtenait la majorité, mais
seulement par 34,6 % contre 22,5 à Düsseldorf, par
34,6 %
contre 22,5 en Thuringe, par 36,7 % contre 27,6 à Berlin.
A
l’évidence, une section de son soutien ouvrier traditionnel
commençait déjà à abandonner le SPD et à évoluer à gauche,
remplacée par les couches inférieures de la petite bourgeoisie qui
jusque là votaient pour les partis bourgeois.
Aux
élections nationales suivantes, 18 mois plus tard, on put voir
l’impact de la politique du SPD au gouvernement en 1919 : il
perdit des voix au bénéfice de la droite, mais beaucoup plus à
gauche. Le score total du parti était divisé
par deux.
|
|
Janvier 1919
|
Juin 1920
|
|
SPD
|
11,5 millions
|
5,5 millions
|
|
USPD
|
2,3 millions
|
4,9 millions
|
En
prenant en compte le soutien continuel de certains électeurs de la
classe moyenne pour le SPD, il ne fait aucun doute que pendant un
certain temps les Indépendants ont été le parti majoritaire dans
la classe ouvrière industrielle. La déception causée par la
social-démocratie à l’ancienne se reflétait rapidement dans les
syndicats : le congrès de 1920 de la principale fédération,
l’ADGB, vota pour la « neutralité » entre les deux
grands partis ouvriers. La classe ouvrière allemande était en train
de se radicaliser – même si ce fut seulement après
la première grande vague de lutte armée et de défaites.
La classe ouvrière était-elle
révolutionnaire ?
Mais
jusqu’où allait cette radicalisation ? Certains historiens
ont conclu, des défaites de la première année de la révolution,
que les ouvriers allemands n’étaient tout simplement pas
révolutionnaires. Ainsi, par exemple, Barrington Moore écrit :
Sans
la combinaison des privations matérielles et des griefs moraux, il
semble peu vraisemblable que le mouvement politique de masse [pour
les conseils d’usine] aurait pu avancer de façon notable. Et même
avec ces éléments, les travailleurs étaient essentiellement
non-révolutionnaires et prêtaient peu d’attention aux agitateurs
putschistes. (...) Il a fallu la déception et la menace de la force
pour amener les travailleurs sur les barricades.4
Claudin
affirme, de la même façon :
La
révolution semblait une fois de plus à l’ordre du jour en
1917-1921. Mais la grande majorité du mouvement ouvrier de l’Ouest,
éduqué dans l’idéologie et la pratique de la social-démocratie,
n’était pas en condition de profiter de la crise. (...) Sous
l’hégémonie social-démocrate, la Révolution Allemande s’arrêta
au renversement de la monarchie et à l’instauration d’une
république. La majorité de la classe ouvrière vit dans ses
résultats limités une grande victoire.5
Une
version plus sophistiquée des mêmes arguments peut être trouvée
chez l’historien allemand des conseils d’usine (et politicien
social-démocrate de gauche) Peter Oertzen. Développant une idée du
premier historien de la République de Weimar, Rosenberg, il prétend
que le soutien de masse dont bénéficiait le mouvement contre les
gouvernements sociaux-démocrates en 1918 et en 1919 venait d’une
« tendance médiane dans le mouvement ouvrier socialiste, qui
ne voulait pas la révolution socialiste immédiate, mais qui n’était
pas non plus satisfaite de la république bourgeoise
social-conservatrice ».6
Un
mouvement populaire correspondant à différentes motivations sous la
direction des organisations ouvrières obtint par la lutte la
république démocratique bourgeoise. A partir de ce mouvement se
constitua une puissante tendance socialiste ouvrière qui voulait
développer celle-ci en une république démocratique socialiste.
Cette tendance fut brisée entre les forces de la révolution
socialiste radicale, d’un côté, et la démocratie bourgeoise
alliée aux forces conservatrices, de l’autre. La seule véritable
alternative à la démocratie bourgeoise n’était pas le
« bolchevisme » mais une démocratie sociale soutenue
par
les conseils.7
Toutes
ces visions souffrent du même défaut fondamental. Elles voient la
conscience comme une caractéristique fixe des individus. Elles se
demandent ce que pensaient les travailleurs à un certain moment,
puis proclament que ces idées, ces croyances, établissent les
limites que la révolution ne pouvait dépasser. Mais la conscience
n’est jamais une propriété figée des individus ou des classes.
C’est, en fait, un aspect, un moment de leur interaction dynamique,
changeante, avec leurs semblables et avec le monde.
Comme
l’a fait remarquer le révolutionnaire italien Antonio Gramsci, il
y a habituellement une fragmentation dans la conscience que les êtres
ont du monde. Nous pouvons avoir au même moment des idées
différentes, et même souvent contradictoires. Certaines idées sont
le résultat de ce que nous avons été amenés à croire dans la
société capitaliste existante, d’autres sont le produit des
luttes, aussi limitées soient-elles, dans lesquelles nous nous
sommes trouvés engagés contre certains aspects de cette
société :
L’homme
de masse actif agit pratiquement, mais n’a pas une claire
conscience théorique de son action qui pourtant est une connaissance
du monde, dans la mesure où il transforme le monde. Sa conscience
théorique peut même être historiquement en opposition avec son
action. On peut dire qu’il a deux consciences théoriques (ou une
conscience contradictoire) : l’une qui est contenue
implicitement dans son action et qui l’unit réellement à tous ses
collaborateurs dans la transformation pratique de la réalité,
l’autre superficiellement explicite ou verbale, qu’il a héritée
du passé et accueillie sans critique.8
La
classe ouvrière allemande est entrée dans la période
révolutionnaire avec tout un ensemble de théories politiques
« explicites », « verbales » – la
social-démocratie du SPD et de l’aile droite de l’USPD, la
démocratie chrétienne du Parti Catholique du Centre, les notions
démocratiques libérales du Parti Démocratique. Toutes disaient aux
travailleurs que la discordance entre leurs désirs et le monde
cruel, dévasté par la guerre, de l’empire allemand serait
surmontée dans une démocratie bourgeoise pleine et entière. Au
surplus, l’idéologie social-démocrate faisait observer qu’en
passant par la démocratie bourgeoise quelque chose d’encore
meilleur pouvait être atteint – la « démocratie
sociale »
chère à Oertzen. La « démocratie » et la
« démocratie
sociale » étaient des idéologies et, comme toutes les
idéologies, elles n’existaient pas dans le vide, mais avaient un
sens pour des millions de gens parce que, pendant une période, elles
semblaient fournir un mécanisme permettant d’ajuster une réalité
déplaisante aux besoins de ceux qui la vivaient.
Les
cruelles réalités de l’Allemagne de 1918-1919 ne devaient
cependant pas être changées en se bornant à satisfaire les
exigences de l’idéologie démocratique. Les conditions d’existence
des travailleurs ne s’amélioraient pas sous la république
démocratique. Elles tendaient plutôt à s’aggraver. Et lorsque
les travailleurs s’employèrent à réduire l’écart entre la
réalité « nouvelle » et leurs désirs en passant de la
« démocratie » à la « démocratie
sociale »
– par exemple avec le mouvement pour la socialisation dans la Ruhr,
ou celui des conseils en Allemagne centrale ou en Bavière – ils
trouvèrent toutes les forces de la vieille Allemagne rangées contre
eux en ordre de bataille.
Lorsque
les vieilles croyances ne sont plus adaptées aux circonstances, le
résultat est toujours une violente confusion idéologique. Cela ne
signifie pas que les travailleurs abandonnent automatiquement
leurs vieilles idées. Ils essaient de faire face en utilisant les
anciennes façons de penser. Ils essaient d’expliquer la ruine de
leurs espoirs comme étant un « accident », qui ne
durera
pas longtemps. Ils changent leurs anciennes idées aussi peu que
possible, tentant de se convaincre que rien d’important n’est
arrivé. Mais finalement ces ajustements ne parviennent plus à
rendre compte de la réalité, et une complète révolution dans les
idées s’avère nécessaire.
C’est,
à l’évidence, ce qui s’est passé dans toute l’Allemagne en
1918 et 1919. Il n’y a pas d’autre façon d’expliquer comment
les métallurgistes de Berlin, un bastion social-démocrate, ont pris
les armes en mars 1919 contre un gouvernement dirigé par le
SPD ;
comment l’attitude des travailleurs sociaux-démocrates de Munich
était telle, en avril, que leurs dirigeants politiques ont été
contraints de jouer à la « République des
Soviets » ;
comment les travailleurs de la Ruhr de l’ouest sont passés en
quelques mois de « l’apolitisme », en passant par la
politique social-démocrate, à des notions anarcho-syndicalistes ou
communistes de gauche, de telle sorte qu’un observateur de la Ruhr
de l’est pouvait écrire, à l’été 1919 :
Lorsque
j’ai quitté Hamborn à la fin de l’été 1918, les travailleurs
étaient, presque à un homme près, tous sociaux-démocrates
majoritaires. (...) Quand j’y suis allé récemment ils étaient,
presque à un homme près, tous communistes.9
Le
processus de passage des idéologies « démocratique »
et
« démocratique sociale » au socialisme
révolutionnaire
n’a été nulle part aussi complet qu’à Hamborn. Des traditions
différentes et des luttes différentes ont interagi, dans divers
parties de l’Allemagne, pour produire différents degrés de
radicalisation.
Il
y a toujours une relation entre la disposition des gens à envisager
le changement social et les possibilités de succès de la lutte. Un
vécu de lutte victorieuse ouvre l’esprit d’un grand nombre de
travailleurs à la notion que leur classe peut aller plus loin et
révolutionner la société. A l’inverse, les luttes qui se
terminent en défaites peuvent très facilement ôter à ces idées
toute crédibilité. Les gens sentent que s’ils ne peuvent agir
ensemble pour changer de petites choses, ils ne peuvent certainement
pas en changer de grandes. Même des gens qui croyaient auparavant à
une transformation totale de la société peuvent battre en retraite.
Quand une classe vaincue, démoralisée, lutte pour la survie au jour
le jour, d’anciens révolutionnaires peuvent facilement en venir à
penser que le mieux à faire est de s’en tenir à ce qui est plutôt
que de se battre pour ce qui pourrait être.
C’est
la raison pour laquelle après toute grande période révolutionnaire,
seule une minorité des participants continue à adhérer à des
théories explicitement révolutionnaires. Le reste ne sera à
nouveau gagné à ces idées que lorsque de nouvelles réalisations
ou des luttes collectives auront restauré leur crédibilité.
Ainsi
la question de savoir si, oui ou non, la classe ouvrière était
révolutionnaire dans l’Allemagne de 1918-1919 doit être posée
d’une manière complètement différente de celle de Barrington
Moore, Claudin et même Oertzen. La question-clé est celle-ci :
y a-t-il eu, dans les luttes ouvrières de la période, un élan qui
a porté des travailleurs, qui étaient au départ loin d’être
révolutionnaires, à entreprendre d’en finir avec la société
existante ?
La
réponse est clairement « oui ». Dans ville après
ville,
la majorité des travailleurs en est venue à une telle démarche,
même si c’était seulement pour une courte période. A Brême,
dans la Ruhr, en Allemagne centrale, à Munich, à Berlin, ces
batailles ont été livrées. Mais elles ne pouvaient conserver la
victoire, parce qu’elles étaient non coordonnées et isolées les
unes des autres. Et à chaque fois qu’une expérience locale
s’effondrait, les travailleurs qui y avaient été engagés
perdaient foi à nouveau dans leur pouvoir de remodeler la société.
Cela
ne signifie pas que dans l’une quelconque de ces luttes locales la
conscience ait été totalement révolutionnée. La contradiction
entre les idées des travailleurs et leur remise en cause de la
société bourgeoise était toujours présente ; mais leur
pensée fut mise en mouvement lorsqu’ils ont commencé à
comprendre les nouvelles possibilités – et une étape de plus dans
la marche en avant du processus révolutionnaire aurait encore plus
transformé leurs idées.
La
question de la conscience révolutionnaire des travailleurs allemands
en 1918-19 est en réalité la question du potentiel révolutionnaire.
Ceux qui prétendent que les travailleurs « n’étaient
pas »
révolutionnaires disent en fait que les idées doivent toujours être
fixes, figées dans le schéma que la société existante imprime
dans l’esprit des gens. En fait, ce que toute l’expérience de
l’Allemagne de 1918-19 met en évidence, ce sont les fluctuations
phénoménales que connaît la conscience dans une période
d’intenses luttes sociales.
La croissance de l’USPD
Les
bénéficiaires de la radicalisation ne furent pas les communistes,
mais les Indépendants. Aux yeux de la plupart des travailleurs qui
quittaient le SPD, « l’USPD était le parti
révolutionnaire ».10
Pourtant le moins qu’on puisse dire est que ses dirigeants, tels
que Haase, Hilferding, Dittmann, étaient bien peu révolutionnaires.
Alors pourquoi les travailleurs qui venaient d’être gagnés à la
révolution allèrent-ils vers l’USPD ?
Une
partie de la raison réside dans les conditions illégales dans
lesquelles devait fonctionner le parti communiste après les
premières semaines de janvier. Ses réunions et ses conférences
étaient dispersées par la police. Beaucoup de ses dirigeants
nationaux et locaux les plus capables avaient été assassinés ;
beaucoup d’autres étaient en prison.
A
l’inverse, l’USPD était un parti légal, bien organisé, avec
une presse puissante et un appareil efficace. C’était le seul
parti à gauche du SPD que les travailleurs rencontraient. Et ils le
rejoignirent en masse.
Mais
il y avait une autre raison. Les premières recrues du KPD n’étaient
pas, dans l’ensemble, des ouvriers d’usine porteurs de traditions
syndicales établies. C’étaient des jeunes gens radicalisés par
la guerre et les luttes armées qui avaient suivi. Beaucoup étaient
passés directement de l’école au front, et du front au bureau de
chômage. Comme le notait le rapport d’organisation du Second
Congrès du KPD, ils étaient venus au parti au zénith de la lutte,
considérant la révolution comme imminente. Ils ne voyaient pas un
grand intérêt dans les activités quotidiennes dans les usines et
les syndicats, dans les réunions longues et fastidieuses, les
cercles de formation, le travail systématique d’enrôlement des
membres et la construction des structures d’organisation.
L’excitation directe de la révolution les attirait beaucoup plus
que les efforts nécessaires pour la rendre possible. Ils voulaient
des combats de rues et non des réunions ennuyeuses.
Mais
dans l’action de rue, il n’était pas toujours possible de faire
la différence entre les révolutionnaires impatients, mais sérieux,
et ceux qui étaient instables, perturbés et peu dignes de
confiance. Le rapport d’organisation notait : « Comme
dans toute organisation qui se situe à l’extrême gauche, il se
trouve aussi chez nous beaucoup d’éléments douteux, des
excentriques politiques, des aventuriers, et même des
vauriens ».11
Dans
les premiers mois de 1919 les membres du parti étaient portés à
ignorer les instructions de la direction contre les actions armées,
les petits putschs, les émeutes alimentaires et le pillage. Au début
de l’été, ces activités étaient grossièrement futiles. Comme
l’a noté Radek dans une brochure écrite lorsqu’il était en
prison au mois de septembre :
Il a
fallu Brême, les troubles de mars à Berlin et la catastrophe de
Munich pour mettre un terme aux tendances putschistes des bataillons
avancés du prolétariat.12
Mais
souvent l’impatience subsistait. Elle trouva une expression dans
l’attitude envers les luttes économiques : si les dirigeants
syndicaux trahissent les grèves, rompez avec eux et formez de
nouveaux syndicats délivrés de leur influence. De la même manière
que les partisans du combat de rue immédiat oubliaient que la
majorité des travailleurs continuait à soutenir, ne serait-ce qu’à
moitié, les sociaux-démocrates, ceux qui proposaient de créer de
nouveaux syndicats perdaient de vue que la plupart des salariés
étaient d’accord, ne serait-ce qu’à moitié, avec l’approche
réformiste de la bureaucratie syndicale. Ils portaient leurs regards
vers la minorité des ouvriers révolutionnaires et oubliaient les
millions qui adhéraient au syndicat pour la première fois.
Le
district de Hambourg du Parti Communiste alla jusqu’à ordonner
à ses membres de quitter les vieux syndicats et de former une
nouvelle organisation, l’Allgemeine
Arbeiter Union (AAU),
basée sur le modèle des Industrial
Workers of the World
(IWW) américains. Le résultat, c’est que pendant de nombreuses
années les communistes restèrent une minorité dans la classe
ouvrière hambourgeoise – beaucoup plus faibles, par exemple,
qu’ils ne l’étaient à Chemnitz, qui pourtant était au départ
une forteresse social-démocrate.
Rompre
avec les syndicats n’était pas de nature à séduire la masse des
travailleurs qui perdaient peu à peu confiance dans la
social-démocratie, mais qui croyaient peu possible une alternative
révolutionnaire, ne voyant le plus souvent en elle rien d’autre
que l’image populaire d’anarchistes lançant des bombes.
Ainsi,
bien que le Parti Communiste ait multiplié le nombre de ses
adhérents, passant de 3 000 ou 4 000 membres lors de
sa
fondation à un effectif proclamé de 106 656 à la fin de l’été
1919, son influence là où elle aurait été nécessaire, comme dans
les usines et les mines, était très limitée. La majorité des
travailleurs qui rompaient avec le SPD étaient plus attirés par la
politique apparemment « raisonnable » et
« réaliste »
de l’USPD que par un KPD qu’ils pensaient
« putschiste »
et favorable aux syndicats indépendants. L’USPD avait le soutien
de la majorité de la classe ouvrière, avec des dizaines de milliers
de militants dans des centres industriels comme Berlin, Leipzig, la
Ruhr méridionale, Hambourg. Le Parti Communiste était le plus
souvent une petite minorité, avec seulement quelques centaines ou
même quelques dizaines d’activistes.
Les
dirigeants du Parti Communiste firent en octobre 1919 un effort
désespéré pour remédier à cette déficience. Ils convoquèrent
un congrès du parti, s’assurèrent par quelques légers tripotages
qu’ils avaient une étroite majorité, puis firent adopter une
liste de points politiques qui définissaient les conditions pour
continuer d’appartenir au parti : en particulier la
reconnaissance du besoin d’agir au sein des syndicats établis,
l’acceptation de la participation aux élections législatives
comme moyen de faire de la propagande communiste, et la volonté de
construire un parti régi par le centralisme démocratique. Près de
la moitié des délégués – et plus de la moitié des
organisations locales - élevèrent des objections. En agissant de la
sorte, ils se disqualifiaient eux-mêmes comme membres du parti.
Beaucoup de ces derniers se rassemblèrent plus tard pour former un
parti « ultra-gauche », le Parti Communiste des
Travailleurs (KAPD).
En
elles-mêmes, ces conditions étaient incontestablement correctes. Le
parti ne pouvait, sans elles, développer une influence significative
au delà d’un cercle étroit de jeunes travailleurs fortement
radicalisés. Mais le résultat immédiat fut d’éloigner du KPD la
plupart des groupes locaux importants – à Hambourg, Brême,
Berlin, le Rhin et la Ruhr. Le parti se retrouva avec une fraction de
ses effectifs précédents – 50 000 au maximum. La direction
du parti aurait mieux fait de pousser pour sa propre ligne au
congrès, puis d’éliminer l’une après l’autre les plus
irréconciliables des figures dirigeantes de l’opposition dans les
localités – d’autant plus que dans les mois qui suivirent il
devint clair que différentes formes d’impatience dirigeaient les
différents oppositionnels dans des directions complètement
différentes. En l’état, le remède était pire que le mal :
lorsque six mois plus tard une nouvelle crise importante s’abattit
sur la société allemande, le KPD était un parti très petit et
très inefficace.
Versailles
« La
position du gouvernement Ebert-Scheidemann est ébranlée. Il ne
survit que par la grâce de la bourgeoisie, et tout tend à indiquer
que cela ne peut plus durer très longtemps », écrivait le
dirigeant spartakiste Levi à Lénine en mars 1919.13
Plus ils perdaient leur base ouvrière de gauche, plus leur avenir
dépendait du Haut Commandement et des partis bourgeois. Mais s’ils
ne pouvaient plus contrôler les travailleurs, pourquoi les faire
bénéficier de cette bonne volonté ?
La
première question importante qui devait diviser les Alliés
contre-révolutionnaires était d’ordre externe : le Traité
de Versailles, qui mettait fin formellement à la Première Guerre
mondiale, et dans lequel les puissances victorieuses exigeaient la
sécession de parties importantes du territoire allemand, le paiement
d’énormes réparations et une déclaration signée reconnaissant
la « culpabilité’ de l’Allemagne dans la guerre.
La
réaction initiale des sociaux-démocrates avait été l’incrédulité.
Ils avaient supposé qu’une fois la guerre terminée, elle était
finie. Ils ne parvenaient pas à comprendre pourquoi les bons
démocrates libéraux des puissances alliées voulaient imposer des
mesures punitives aux bons démocrates libéraux d’Allemagne.
Cela
a été souvent la réaction de ceux qui ont, depuis, entrepris
d’écrire l’histoire allemande. Ils présentent le Traité de
Versailles, la bête noire de toute la période de Weimar, comme une
espèce d’accident historique, du à « l’obstination
française », qui ne devait pas être interprété comme partie
intégrante du développement de la société capitaliste. Ce n’était
pas plus un « accident » que la guerre dont il était
la
continuation logique.
La
Première Guerre mondiale avait éclaté parce qu’il n’était
plus possible aux différentes puissances capitalistes de résoudre
l’opposition de leurs intérêts par des moyens pacifiques. Comme
l’ont montré Lénine et Boukharine dans leurs écrits sur
l’impérialisme du milieu de la guerre, un point avait été
atteint où les Etats capitalistes rivaux devaient recourir à la
force armée pour décider du sort de leurs intérêts économiques
antagoniques. La concurrence « pacifique » pour les
marchés se transforma en conflit militaire pour les frontières des
Etats et des empires. Les grandes puissances étaient entraînées,
par la dynamique de l’accumulation capitaliste concurrentielle, à
« partager et repartager’ le monde entre elles.
La
guerre avait temporairement résolu la question en faveur des
capitalismes alliés. Mais une Allemagne qu’on autoriserait à
continuer à développer son industrie serait une Allemagne en
rivalité avec les autres puissances pour le contrôle des ressources
nécessaires à l’expansion économique. Elle serait aussi porteuse
d’un potentiel de réarmement, et du danger d’un nouveau conflit
militaire pour obtenir lesdites ressources. Elle chercherait
inévitablement à « repartager » le monde dans le sens
de ses intérêts (elle le fit, dans les faits, à partir du milieu
des années 1930). La seule question, pour les puissances alliées,
était de savoir si, comme la France et la Belgique, elles
préféraient piller et handicaper l’Allemagne, ou si, comme
l’Angleterre, elles étaient favorables au retournement de
l’agressivité du capitalisme allemand en direction de la Russie
soviétique.
Aucune
de ces options ne ménageait un avenir au rêve social-démocrate
d’un retour au capitalisme, ignorant des luttes pour l’hégémonie
mondiale, du 19ème
siècle. Les exigences du Traité de 1919 – et l’occupation de la
Ruhr par les troupes françaises quatre ans plus tard – étaient le
prix que devait payer l’Allemagne pour continuer à faire partie du
monde capitaliste.
Même
après l’annonce initiale des termes de Versailles, les
sociaux-démocrates s’accrochaient à leurs illusions dans la bonne
volonté de l’Entente. Ils croyaient qu’une démonstration
symbolique de résistance obtiendrait une diminution des demandes
alliées. Ils se joignirent donc aux partis de droite dans une
campagne nationaliste d’opposition aux termes du traité,
organisant d’énormes meetings du SPD sur des slogans
nationalistes.
Mais
les alliés ne reculaient pas d’un pouce. Les sociaux-démocrates
étaient confrontés à un grave dilemme. Le capitalisme allemand,
qui venait de perdre la guerre, n’avait aucun moyen de résister à
l’Entente. Toute tentative de résistance aurait replongé
l’Allemagne dans le chaos – et probablement la révolution. En
désespoir de cause, le SPD opéra un tournant à 180°, adopta la
position qui était auparavant celle des Indépendants, et vota pour
le traité.
Les
représentants de la bourgeoisie au gouvernement – les dirigeants
des Partis du Centre et Démocratique – adoptèrent essentiellement
la même position. Ils savaient que le capitalisme allemand n’avait
pas d’autre option que de se soumettre. Mais cela ne signifiait pas
que la bourgeoisie allemande entendait porter la responsabilité de
cette capitulation. Les partis non-gouvernementaux pouvaient faire de
grands progrès en utilisant l’agitation nationaliste contre le
traité, financée par les grands intérêts industriels et
agricoles. Il était facile de mettre la misère des travailleurs et
d’une section croissante de la classe moyenne au compte de
« l’exploitation étrangère », et de se retourner
contre les « traîtres de Novembre » dont l’agitation
en faveur de la paix avait « poignardé l’armée dans le
dos » et « mené à la défaite ». La faim, la
misère, la pauvreté, le chômage, l’inflation, tout cela pouvait
être reproché au SPD et à l’USPD « marxistes ». En
votant pour le traité, ces partis en apportèrent la
« preuve ».
Il
est impossible d’exagérer l’impact de cet argument. En novembre
1918, il y avait eu un soutien très large pour le changement social,
même dans les classes moyennes. Désormais ces classes étaient
convaincues que c’était la tentative de changer les choses qui
avait créé tous leurs problèmes. Après avoir approuvé la
révolution, ils devinrent les fantassins de la contre-révolution.
Comme
l’explique Rosenberg dans son histoire de la République de
Weimar :
Mais
c’est justement l’hésitation des dirigeants républicains qui a
aliéné les classes moyennes. Si de grandes actions décisives
avaient eu lieu, par exemple l’expropriation des grands
propriétaires terriens et des mines, si le gouvernement avait montré
au peuple qu’une ère nouvelle avait réellement commencé, le
gouvernement aurait aussi emporté l’adhésion des classes
moyennes. Mais comme de toute évidence tout devait rester inchangé,
l’enthousiasme pour la révolution s’évapora, et la république
et la démocratie se retrouvèrent accusées de tous les maux de
l’existence.14
Les
étudiants, par exemple, devinrent la force d’avant-garde de la
contre-révolution :
La
grande majorité des étudiants avaient été amèrement déçus par
les épisodes postérieurs au 9 novembre. Ils voyaient la détresse
économique et l’humiliation nationale, et mettaient la situation
sur le compte des partis du gouvernement républicain et des
évènements du 9 novembre.15
Mais
le ressentiment le plus vif à l’égard du Traité de Versailles
venait du groupe social dont les intérêts étaient directement
frappés par ses dispositions – les soldats professionnels de
l’armée qui se reconstituait autour des Freikorps. Ces derniers
avaient grandi rapidement dans la première moitié de 1919, jusqu’à
atteindre le chiffre de 400 000 hommes. Désormais les termes
du
traité stipulaient que les forces armées allemandes devaient être
réduites à 200 000 en avril 1920 et 100 000 et
juillet.
Trois soldats sur quatre devaient être renvoyés dans leurs foyers.
Des centaines de milliers de ceux qui avaient fait la guerre aux
conseils ouvriers se voyaient soudain menacés de perdre leurs moyens
d’existence. « La « vague du nationalisme »
était
une vague de simple combat pour leur existence pour les centaines de
milliers d'officiers, de sous-officiers et de soldats ».16
L’exaspération
était à son comble parmi les 40 000 hommes du Corps de la
Baltique, qui avaient mené une guerre acharnée sur les frontières
orientales, en partie contre les Polonais, mais surtout contre la
révolution bolchevik dans les pays baltes et en Ukraine. Ils furent
rapatriés en Allemagne dans la seconde moitié de 1919 pour
découvrir que le gouvernement « marxiste » se
préparait
à les licencier à la demande des Alliés.
La
colère fournissait un point de ralliement à tous ceux qui voulaient
extirper les derniers vestiges des changements de Novembre. Le
terrain fut préparé par un nouveau soulèvement qui devait secouer
la république de Novembre jusque dans ses fondations et voir se
lever à nouveau le spectre d’une classe ouvrière révolutionnaire
en armes – et, cette fois, sans illusions sur les
sociaux-démocrates majoritaires.