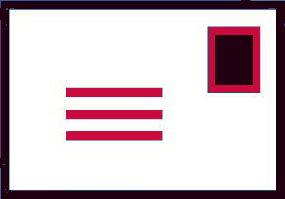La
République Bavaroise des Conseils commença comme une farce. Elle se
termina en tragédie. Ses débuts furent grotesques, ridicules. Mais
il se cachait derrière eux une signification historique. C’était
la fin d’une étape de la Révolution Allemande, une étape qui
avait déjà été atteinte à Berlin en janvier.1
La
Révolution de Novembre avait mis au pouvoir ceux qui étaient les
plus audibles et les plus préparés à le prendre : dans le cas
de la Bavière, l’homme de lettres social-démocrate indépendant
Kurt Eisner. Avant la guerre, Eisner était journaliste de la
social-démocratie, bien connu pour son soutien au
« révisionniste »
Bernstein. Il avait été nommé rédacteur en chef politique du
quotidien du SPD à Munich, capitale de la Bavière. Lors du
déclenchement des hostilités, il soutint la guerre comme
« guerre
de défense nationale », mais révisa bientôt son opinion et
passa au pacifisme extrême, fermement convaincu que l’Allemagne
était « coupable de la guerre ».
Il
fut condamné, pour ses activités pendant les grèves de janvier
1918, à huit mois et demi de prison et lors de sa libération, en
octobre de la même année, il était ce que Munich avait de plus
proche d’un martyr socialiste. Mais ses opinions politiques
personnelles étaient « modérées » : il
écrivit
qu’il y avait « entre Kautsky et moi un accord complet sur
presque toutes les questions » - et Kautsky était, des
sociaux-démocrates indépendants, l’adversaire le plus acharné
des bolcheviks.
Vers
la fin d’octobre 1918, les vibrations de la révolution dans
l’Autriche voisine parvenaient jusqu’à Munich. Eisner reprit la
campagne pour la paix – et se mit dans une position de visibilité
politique – en se présentant lors d’une élection partielle
contre le dirigeant social-démocrate Auer. Puis, au début de
novembre, des nouvelles filtrèrent du soulèvement de Kiel – en
même temps que des centaines de marins allemands basés en Autriche
faisaient halte à Munich sur le chemin du retour.
Une
nouvelle disposition d’esprit s’empara des travailleurs de
Munich. Des centaines d’entre eux se mirent à assister à des
meetings pour la « paix » qui n’en comptaient jusque
là
que quelques douzaines. Eisner, pratiquement sans organisation
derrière lui, devint virtuellement une force politique en lui-même
– à tel point qu’Auer, avec le puissant appareil de la
social-démocratie, ne put refuser de signer avec lui un appel
conjoint à la grève générale.
Le
7 novembre, la ville était paralysée par la grève. Auer vint
parler à ce qu’il croyait être une manifestation pacifique, et
découvrit que ses éléments les plus dynamiques étaient composés
de soldats et de marins en armes, rassemblés derrière la figure
bohémienne hirsute d’Eisner, avec une immense banderole où on
lisait « Vive la révolution ». Pendant que les
dirigeants sociaux-démocrates, abasourdis, se demandaient quelle
attitude adopter, Eisner emmena son groupe, avec une grande partie de
la foule derrière lui, dans une tournée des casernes. Les soldats
se précipitèrent aux fenêtres en entendant le tumulte, échangèrent
quelques mots avec les manifestants, prirent leurs fusils et se
joignirent à eux. Puis Eisner les conduisit directement au bâtiment
du parlement local, y proclama « l’Etat libre de
Bavière »,
le renversement de la monarchie, et la fin de la guerre. Ce soir là,
le roi et ses ministres prenaient le chemin de l’exil.
En
prenant l’initiative au bon moment, Eisner s’était emparé du
pouvoir d’Etat. Les dirigeants sociaux-démocrates n’avaient pas
d’autre choix que de lui emboîter le pas, au moins provisoirement,
s’ils ne voulaient pas perdre totalement le contrôle de la
situation.
Pour
la plupart des historiens, le nouveau régime a été une anomalie.
Il donnait l’apparence d’être un des plus radicaux à émerger
de la Révolution de Novembre. Pourtant la Bavière était une région
de l’Allemagne des plus conservatrices, dominée par le clergé, sa
population de huit millions d’habitants constituée essentiellement
de paysans catholiques. « Aucune ville bavaroise »,
nota
un dirigeant communiste quelques mois plus tard, « ne possède
un caractère prononcé de ville de grande industrie. Munich
particulièrement pas ».2
Cela se
reflétait dans le
caractère droitier de l’organisation social-démocrate avant la
guerre.
« L’anomalie »
était le résultat des secousses que la guerre avait imprimées à
l’ensemble de la structure sociale. En novembre 1918, tout le monde
voulait le changement. Même ceux qui avaient soutenu le monarque, et
qui devaient plus tard se rassembler sous les bannières du nazisme,
sentaient que les choses ne pouvaient se perpétuer inchangées. Dans
la paysannerie, la colère contre l’économie de guerre et le
rationnement avaient encouragé la croissance d’une Ligue Paysanne
radicale. Même si elle ne fut jamais composée que d’une minorité
de paysans, la Ligue parvint à menacer le conservatisme immémorial
des campagnes. A Munich même, une nouvelle classe ouvrière avait vu
le jour. Krupp y avait construit une nouvelle usine de munitions
employant 6 000 salariés (un nombre important dans une ville
de
600 000 habitants). Certains de ces ouvriers, originaires
d’Allemagne du Nord, vinrent porteurs de traditions bien plus
radicales que celles de la Bavière. Les travailleurs de Krupp
avaient été en première ligne de la grève de janvier 1918 et
constituaient désormais une force politique importante.
De
plus, Munich était une ville étape pour les troupes retirées du
front. A la mi-décembre, on y trouvait 50 000 soldats logés de
façon temporaire – l’équivalent du cinquième de la population
adulte de la ville. Il en résultait une concentration de
travailleurs industriels et de soldats en cours de radicalisation
accélérée, qui faisait plus que compenser le poids politique de la
Bavière rurale.
Un
autre facteur permit à Eisner de jouer un rôle apparemment
indépendant de l’équilibre des forces sociales : la classe
moyenne et la paysannerie bavaroises étaient porteuses d’une forte
tradition séparatiste. La Bavière avait été un royaume autonome
dans l’Empire germanique, maintenant même la fiction d’une armée
et d’une politique étrangère spécifiques. La population,
catholique dans son immense majorité, se méfiait de la Prusse
protestante et nourrissait une affinité considérable avec
l’Autriche voisine, elle aussi germanophone – un sentiment
renforcé par le fait que l’Autriche avait perdu son empire et
recherchait l’unité avec d’autres peuples de langue allemande.
Eisner
put jouer de tout cela pour maintenir sa position à la tête du
gouvernement, soutenant les revendications séparatistes de façon à
opposer la classe moyenne et les dirigeants sociaux-démocrates
centralistes. Et les opinions politiques d’Eisner lui-même
n’étaient aucunement d’extrême gauche. Ses premières
déclarations furent pour appeler à la convocation rapide d’un
parlement bavarois, et il s’opposait à la socialisation comme
étant « prématurée », nommant un économiste libéral
à la tête de la commission chargée d’instruire la question.
Mais
Eisner ne pouvait balancer indéfiniment entre les éléments divers
et variés à l’œuvre dans la situation politique bavaroise. Son
propre Parti Social-Démocrate Indépendant était faible. Il était
issu d’un cercle de discussion de brasserie formé d’une poignée
de dissidents du SPD et d’intellectuels tels que le poète
anarcho-communiste Mühsam et le dramaturge expressionniste Toller.
Pendant l’année 1918, son opposition à la guerre lui avait valu
un soutien considérable des délégués des grandes usines, en
particulier de chez Krupp. Mais, en termes électoraux, il n’avait
en rien les racines et l’organisation des sociaux-démocrates
majoritaires, pas plus qu’il ne pouvait se mesurer à l’influence
des partis bourgeois dans la paysannerie.
Il
n’a pas dû y avoir, dans l’histoire, beaucoup de cas semblables
à celui du 19 janvier 1919, où le parti du chef de l’exécutif
avait seulement 2,5 % du total des voix – et continuait à
gouverner.
Eisner
ne pouvait pas non plus se réclamer d’un soutien qu’il aurait eu
de la part du système des conseils ouvriers. Six mille différents
conseils étaient censés avoir été formés en Bavière dans les
journées de Novembre3,
mais leur force variait énormément. Ils dirigeaient virtuellement
le centre textile d’Augsbourg, et dans d’autres endroits exerçait
les pouvoirs des anciennes autorités municipales. Mais la plupart ne
semblent pas avoir représenté beaucoup plus qu’une vague
aspiration au changement une fois passée la jubilation des premiers
jours de la révolution. Le conseil des soldats de Munich, par
exemple, laissait le ministre social-démocrate de la guerre exercer
le plein contrôle de l’armée.
Par
dessus tout, il y avait peu d’organisation des conseils en vue de
coordonner les différentes forces qui avaient amené la révolution.
Les divers corps exécutifs des conseils formés en Novembre étaient
la plupart du temps auto-désignés, avec peu de base dans les usines
et les casernes. Ensuite les sociaux-démocrates avaient constitué
un conseil prétendument unifié pour Munich. Leurs propres membres
avaient une majorité de 50 pour un et leurs statuts déclaraient
qu’ils n’avaient « aucun pouvoir exécutif ».
Déjà,
en décembre, la position d’Eisner était faible. Il ne pouvait
rester au pouvoir qu’en faisant des concessions à ses partenaires
de coalition sociaux-démocrates – par exemple en acceptant
l’établissement d’une espèce de force de sécurité régulière
« pour maintenir l’ordre ». Les résultats des
élections le poussait de plus en plus entre leurs mains.
Pendant
qu’Eisner évoluait à droite, les conditions d’existence des
travailleurs et des soldats de Munich se détérioraient rapidement.
Le conseil municipal annonça qu’il ne pouvait plus acquérir de
légumes à vendre ; le nombre des chômeurs augmentait, et
l’inflation détruisait la valeur des salaires.
Il
y avait déjà eu des émeutes à la mi-décembre, en protestation à
une réunion tenue par le sociologue Max Weber en faveur d’élections
à l’Assemblée Nationale. Au début de janvier le sentiment de
beaucoup de travailleurs, de chômeurs et de soldats était empreint
d’amertume : ils venaient d’apprendre que le sang avait
coulé à Noël à Berlin. Le sang devait aussi bientôt couler sur
le pavé de Munich – trois personnes furent tuées après une
manifestation de chômeurs.
La
réponse des sociaux-démocrates à cette montée de la colère était
d’accentuer la pression pour la création d’une force de police
« sûre ». Ils confièrent cette tâche à Rudolf
Buttman, qui s’était déclaré plus tôt partisan de la
« contre-révolution ». Mais l’effet principal de la
proposition fut de provoquer l’antagonisme du conseil de soldats et
de le pousser vers la gauche.
Eisner
lui-même semble ne pas avoir su quoi faire. Il essayait de se
concilier à la fois les sociaux-démocrates de son cabinet et les
ouvriers et soldats qui s’éloignaient de plus en plus. A la
mi-février, il vota, lors d’une réunion de cabinet, en faveur de
la nouvelle force de maintien de l’ordre – puis alla parler à
une énorme manifestation de travailleurs qui portaient des
banderoles où on lisait « Tout le pouvoir aux
conseils »,
« Souvenez-vous de Liebknecht et Luxemburg »,
« Vive
Lénine et Trotsky ». Au pouvoir sans aucune base personnelle,
il était forcé de se comporter d’une façon de plus en plus
arbitraire, et apparemment irrationnelle.
Le
fait que ce comportement n’était pas seulement le résultat de la
personnalité d’Eisner est montré par la façon dont les
dirigeants sociaux-démocrates s’y conformaient. Eux aussi se
rendaient compte qu’ils devaient provisoirement se concilier la
seule force militaire organisée de Munich – les soldats
radicalisés - même si c’était contraire à tout ce à quoi ils
croyaient. Ainsi un jour le ministre social-démocrate de la défense
pouvait concéder au conseil de soldats le droit de contresigner ses
ordres, et le lendemain une conférence du SPD déclarait par un vote
qu’une telle chose était « impossible ».
Des semaines de non-gouvernement
Eisner
décida finalement lui-même de démissionner pour permettre aux
sociaux-démocrates de former un gouvernement stable. Mais il n’en
parla à personne. Il décida de faire son discours de démission
lors de la première réunion du nouveau parlement bavarois, le 21
février – et fut abattu en chemin par un aristocrate d’extrême
droite.
Pour
la classe ouvrière de Bavière, le meurtre d’Eisner était le
symbole de tout ce qu’ils craignaient. A Munich et à Nuremberg il
y eut des grèves générales. Des groupes armés de travailleurs et
de soldats occupèrent les rues de Munich. Un travailleur armé
pénétra au parlement et tua le social-démocrate de droite Auer,
dont beaucoup pensaient qu’il avait fomenté l’assassinat
d’Eisner. Les députés terrorisés s’enfuirent de la ville.
Désormais
le seul pouvoir résidait dans les soldats et travailleurs en armes
de Munich – et les instances qui pouvaient conserver leur
allégeance. Dans les faits, les décisions étaient prises par un
exécutif central des conseils de Bavière fraîchement formé,
présidé par le social-démocrate « de gauche »
Niekisch
et comportant le communiste Levien. Celui-ci imposa la loi martiale
et une censure molle de la presse bourgeoise. Mais ses membres, en
majorité sociaux-démocrates, refusèrent d’admettre qu’il
représentait le pouvoir. Le lendemain du meurtre d’Eisner, ils
convinrent avec les syndicats, le SPD et l’USPD de « rappeler
le parlement aussitôt que les conditions le permettraient ».
Pendant
quelques semaines, les conditions ne le permirent pas, et
« seul
le Conseil Central des Conseils d’Ouvriers et de Soldats disposait
d’un semblant de pouvoir. Mais ce n’était pas un
gouvernement ».4
Un
congrès des conseils bavarois se réunit – et discuta pendant deux
semaines sans parvenir à la moindre décision, à part voter contre
la constitution d’un gouvernement des conseils ouvriers. Il fallut
attendre la mi-mars pour qu’un vrai gouvernement soit formé,
dirigé par le social-démocrate Hoffmann et comportant des ministres
USPD et le président social-démocrate de gauche du conseil ouvrier,
Niekisch. Le parlement d’Etat donna, à l’issue d’une session
d’un jour, les pouvoirs d’urgence au gouvernement, puis les
prorogea indéfiniment.
Mais
le nouveau gouvernement était impuissant. Ses ministres SPD
voulaient « rétablir l’ordre » mais avaient peu
d’influence sur les troupes. « Le mouvement de masse était
déjà si fort que l’appareil gouvernemental ne pouvait fonctionner
de manière organisée ».5
Hoffmann lui-même expliqua plus tard : « Lorsque
le 17 mars je pris le contrôle du gouvernement, il y avait à Munich
une armée de 30 000 chômeurs, bien organisée contre le
gouvernement ».6
Le
gouvernement était aussi paralysé par ses propres dissensions
internes. Les ministres USPD poussaient pour la socialisation de
l’industrie – mais se heurtaient au blocage de Hoffmann. Les
ministres SPD voulaient un rétablissement rapide de
« l’ordre »
– mais ne pouvaient aller trop loin de peur de mettre en
porte-à-faux l'USPD, dans lequel les soldats avaient une certaine
confiance. Le plus important parti non gouvernemental – le Parti
Bavarois du Peuple – exigeait une déclaration d’indépendance
vis-à-vis de Berlin. Hoffmann répondit que c’était
« impossible ». Mais la pression indépendantiste
était
assez forte pour l’empêcher de faire appel aux Freikorps, dirigés
par Berlin, pour briser la gauche.
Pendant
ce temps, les conditions d’existence de la masse de la population
s’aggravaient de jour en jour. Il y avait dans la ville environ
40 000 chômeurs. Un mois de mars très froid avait englouti les
stocks de charbon et provoqué une annulation de toutes les rations
de carburant. La municipalité était en faillite, ses propres
employés refusant sa monnaie de papier.
Si
les conditions locales étaient de nature à pousser les travailleurs
au découragement, les événements extérieurs, eux, étaient
porteurs d’un espoir révolutionnaire. Le 22 mars, une république
des travailleurs prit le pouvoir en Hongrie. Les conseils ouvriers
restaient une force importante en Autriche, où la politique
dominante était une version de gauche de la social-démocratie. Il
semblait à beaucoup de travailleurs que la Bavière pouvait
constituer un point dans une ligne de républiques ouvrières
s’étendant, à travers l’Autriche et la Hongrie, jusqu’à
Moscou. De telles visions étaient encore plus vraisemblables dans
les derniers jours de mars, avec la Ruhr en route vers la grève
générale, l’état d’urgence proclamé à Stuttgart et des
émeutes secouant Francfort.
Les
choses explosèrent finalement au début d’avril. Il y avait des
rumeurs selon lesquelles le parlement devait être reconstitué, avec
sa majorité bourgeoise. Les soldats disaient qu’ils ne
s’opposeraient pas aux travailleurs s’il y avait une grève
générale. Des meetings nocturnes de milliers de chômeurs
avertissaient Hoffmann que ceux-ci envisageaient de « se
servir » si les augmentations des tarifs du gaz, de
l’électricité et des tramways n’étaient pas annulées. Puis
une réunion des conseils ouvriers à Augsbourg, où était intervenu
le ministre social-démocrate de gauche Niekisch, vota à une immense
majorité pour la fondation d’une république des conseils. C’était
une motion qui bénéficiait du soutien des sociaux-démocrates de
base de la Bavière du sud, exprimé lors d’une conférence du SPD
deux jours plus tôt.
La soi-disant « République
des Soviets »
La
scène la plus étonnante se déroula. Une réunion fut organisée
pour discuter de la formation d’une république des conseils –
par le ministre de la guerre social-démocrate de droite,
Schneppenhorst, dans son propre bureau.
Une
centaine de personnes étaient présentes, du conseil d’ouvriers et
de soldats, du SPD, des Indépendants et de cercles bohémiens
influencés par les anarchistes. Tous semblaient enthousiasmés par
un plan grâce auquel la crise gouvernementale serait résolue en
formant un gouvernement basé sur les conseils comportant les trois
partis ouvriers, le SPD, l’USPD et le KPD. Mais le communiste
Leviné, récemment arrivé de Berlin, se présenta à la réunion.
Il rejeta le plan et mit en garde :
Je viens d’apprendre
l’existence de
vos plans. Nous, communistes, trouvons profondément suspecte l’idée
d’une république soviétique dont les représentants sont les
ministres social-démocrates Schneppenhorst et Durr, qui ont
combattu constamment et par tous les moyens le système des conseils.
Nous ne pouvons interpréter leur attitude que comme la tentative de
dirigeants en banqueroute de se ménager la faveur des masses par une
action qui ait l’air révolutionnaire, ou comme une provocation
délibérée.
Nous savons par notre
expérience en
Allemagne du Nord que les socialistes majoritaires ont souvent tenté
de provoquer des actions prématurées, pour pouvoir les étouffer
d'autant plus facilement.
Une république des conseils ne
peut pas
être proclamée de façon abstraite. Elle est le résultat d'âpres
luttes du prolétariat et de sa victoire. Le prolétariat de Munich
n’est pas encore entré dans des luttes décisives de ce type...
L’euphorie
initiale une fois dissipée, les sociaux-démocrates saisiront le
premier prétexte pour se retirer, trahissant délibérément les
travailleurs. Les Indépendants collaboreront, puis commenceront à
vaciller, à négocier et à se transformer inconsciemment en
traîtres. Et nous, communistes, devrons payer pour vos entreprises
avec le sang des meilleurs d'entre nous.7
Ce
discours provoqua une explosion de colère. Schneppenhorst
s’écria :
« Frappez ce Juif derrière les oreilles ! »
Mais ce
n’était pas suffisant pour mettre un terme aux jeux dangereux. Le
7 avril, les citoyens de Munich découvrirent avec stupéfaction que
la République Bavaroise des Soviets avait été proclamée.
Les
communistes l’appelèrent la « République
pseudo-Soviétique ». C’était une caricature, « une de
ces comédies dont la démolition est nécessaire pour le progrès de
la révolution – plus elle est rapide, mieux c'est ».8
La
république des conseils n’est pas issue de la libre intention de
la classe ouvrière. (...) Elle était pour les anarchistes et les
Indépendants un changement purement formel du gouvernement (...) Une
république des conseils a été établie, qui a été fabriquée
dans un bureau. (...) La participation des masses s'est limitée à
une chose : on leur a donné une fête. (...) La pensée que la
république des conseils ne pouvait être constituée que par
l’action du mouvement de masse leur était totalement étrangère.
La Bavière avait une république des conseils et les conseils
restaient impuissants comme auparavant.9
Mais,
en l’absence de structures reliant les ministres
« soviétiques »
aux masses, ils ne pouvaient rien faire. Comme l’a dit un historien
américain de la révolution bavaroise, « La Première
République Soviétique dura six jours – une semaine de confusion
bruyante, souvent ridicule ».10
Des
décrets étaient édictés, pour la socialisation de la presse et
des mines, pour la réorganisation des banques, pour le remplacement
des cours de justice par des tribunaux révolutionnaires spéciaux,
pour la confiscation des stocks de nourriture et pour la création
d’une Armée Rouge. Mais « les mesures signées au nom du
Conseil Central Révolutionnaire n’existaient que sur les
affiches ».11
Le
dirigeant communiste Leviné a résumé ainsi cet épisode :
Au troisième jour de la
République
Soviétique. (...) Dans les usines les travailleurs triment et gèlent
comme auparavant pour le Capital. Dans les bureaux sont assis les
même fonctionnaires royaux. Dans les rues, les vieux gardiens armés
du monde capitaliste (...) Les ciseaux de tonte des profiteurs de
guerre et des chasseurs de dividendes continuent de cliqueter.
Les
rotatives de la presse capitaliste continuent de crépiter, crachant
leur venin et leur bile, leurs mensonges et leurs calomnies aux gens
assoiffés de cris de guerre révolutionnaires. (...) Pas un seul
prolétaire n'a obtenu d'arme. Pas un seul bourgeois n’a été
désarmé.12
Le
gouvernement lui-même était tout autant une farce que ses mesures
dénuées d’effet. L’homme qui avait présidé à sa formation,
Schneppenhorst, avait décampé pour Nuremberg, prétendant qu’il
allait chercher un soutien pour le gouvernement des conseils. Mais
une fois arrivé, il assista à une réunion du SPD qui vota à
l’unanimité contre le gouvernement des conseils et commença à
rassembler des troupes pour l’attaquer. Le premier président du
gouvernement des conseils, le social-démocrate « de
gauche »
Niekisch, s’attarda un jour de plus – avant de disparaître à
son tour.
Les
communistes déclarèrent plus tard que le rôle des
sociaux-démocrates avait été « un acte de démagogie
perfide ».13
L'interprétation plus récente de l’historien américain Mitchell
n’est guère différente : « Schneppenhorst n’avait
pas une idée très claire de ce qu’il faisait. (...) En invitant
le KPD à participer à une coalition gouvernementale, il espérait
impliquer ses dirigeants dans une responsabilité officielle pour
leurs paroles et leurs actes, qui auraient pu alors – par un moyen
quelconque – être combattus vigoureusement ».14
Il ne réussit pas à obtenir la participation du KPD. Mais il
pouvait toujours aller chercher une armée pour le « combattre
vigoureusement ».
La
désertion des sociaux-démocrates laissa, comme figure de proue du
comité « révolutionnaire », l’Indépendant Ernst
Toller, poète expressionniste de 25 ans. Les critiques communistes
prétendaient que la seule ambition de Toller était de jouer un
rôle, comme dans un de ses propres drames historiques.
« Toller
était enivré par la perspective de jouer le Lénine bavarois »,
raconte Rosa Leviné-Meyer.15
Les
restant du « conseil révolutionnaire » était composé
de vieux habitués du cercle bohémien de discussion d’Eisner,
comme les anarchistes Mühsam et Landauer. Le Commissaire des
Finances était un passionné de numismatique, le Dr Gesell. Toller
présenta un de ses « vieux amis », un certain Dr
Lipp,
et persuada les autres de l’accepter en tant que Commissaire aux
Affaires Etrangères. D’après la plupart des témoins, Lipp était
complètement fou : il disait avoir « déclaré la
guerre
à la Suisse et au Wurtemberg parce que ces chiens ne m’ont pas
prêté immédiatement 60 locomotives », et il écrivit à
Lénine : « Le prolétariat de la Haute Bavière a connu
le bonheur de la victoire. (...) Mais le fugitif Hoffmann est parti
en emportant la clé des toilettes de mon ministère ».
Mais
Hoffmann devait faire des choses autrement plus dangereuses que de
voler des clés de toilettes. Il reforma son gouvernement en dehors
de Munich, dans la ville de Bamberg, au nord de la capitale. Sans
rencontrer la moindre résistance de la part du soviet d’opéra
bouffe installé à Munich, il se fut bientôt rendu maître des
principales villes de la Bavière – à l’exception d’Augsbourg.
Il bloqua alors le ravitaillement de la zone de Munich et commença à
chercher des troupes pour l’attaquer. A la fin de la semaine, il
avait réussi à rassembler 8 000 hommes armés. Mais on pensait
qu’il y avait 25 000 soldats dans la ville – et il était
toujours hors de question de faire appel aux Freikorps, à cause de
la vieille question sensible de l’autonomie bavaroise.
Malgré
tout, une première tentative de prendre la ville fut faite au
sixième jour de l’existence de la République des Conseils. Un
détachement de composition petite bourgeoise basé à Munich, la
Force de Sécurité Républicaine, s’empara de quelques bâtiments
le dimanche 13 avril et colla des affiches proclamant « le
renversement du conseil révolutionnaire ».
Hoffmann,
cependant, avait assez de bon sens pour maintenir le gros de ses
troupes hors de la ville. Bien lui en prit. Les soldats d’une des
casernes de Munich attaquèrent la milice de droite, la repoussant
jusqu’à la gare du chemin de fer, où ils furent rejoints par
plusieurs milliers d’ouvriers et de soldats armés, et, après
plusieurs heures de combat, la tentative de coup de main fut brisée
- au prix de 20 morts. Par chance plus que par habileté, le
soi-disant soviet resta intact. Mais la façon dont il restait intact
jeta ses dirigeants dans une crise aiguë.
La Seconde République des Soviets
Les
membres et les sympathisants du parti communiste avaient joué le
rôle central dans la défense, improvisée à la hâte, de Munich.
Toute la semaine, les travailleurs leur avaient demandé avec
insistance de faire quelque chose pour mettre un terme aux
divagations du « comité révolutionnaire » bohémien.
L’urgence devenait brûlante. Si rien n’était fait, il n’y
aurait pas vingt morts, mais des centaines.
Cependant,
la stratégie générale du Parti Communiste dans tout le pays
consistait à éviter toute répétition des événements de janvier
à Berlin. La direction nationale pensait que la lutte armée ne
pouvait être victorieuse tant qu’il n’y avait pas un parti
puissant soutenu par la majorité des travailleurs et capable de
coordonner l’action dans tout le pays.
Eugen
Leviné avait été envoyé prendre la direction des opérations à
Munich avec pour instruction que « toute occasion d’action
militaire de la part des troupes gouvernementales doit être
rigoureusement évitée ». Il s’était immédiatement
consacré à réorganiser le parti pour le séparer clairement des
éléments bohémiens anarchisants. Il insista pour rappeler toutes
les cartes des membres du parti, ne ré-enregistrant que ceux qu’il
considérait comme dignes de confiance. Le parti demeurait néanmoins
une force substantielle pour une ville de la taille de Munich, avec
3 000 membres comparés à la centaine qui avait constitué la
gauche inspirée par l’USPD un an auparavant.
Conformément
à ses instructions générales (et à son propre instinct), Leviné
se tint à l’écart de la pseudo-République des Conseils. Chaque
jour de son existence, la Rote
Fahne locale répéta
qu’elle n’était pas une véritable république des conseils,
laquelle ne pouvait être construite que par des gens ayant
complètement brisé avec la social-démocratie, ce qui incluait
l’USPD, dont les dirigeants s’étaient compromis avec les
sociaux-démocrates. Même les « conseils » qui
formaient
la base de la « République des Conseils » étaient
inadéquats, ayant été élus pour un objet tout autre que
l’exercice du pouvoir politique. Les travailleurs élus à ces
conseils étaient censés avoir des connaissances sur le système
national d’assurances, sur les lois régissant le service du
travail auxiliaire, la santé et la sécurité dans les usines :
Bien
d’autres qualités sont attendues des membres du nouveau conseil
ouvrier révolutionnaire : celles nécessaires pour une lutte
acharnée contre les citadelles de la bourgeoisie et du capitalisme,
et de leurs complices pseudo-socialistes.16
Il
y avait cependant un problème qui ne pouvait être contourné. Une
large section de la classe ouvrière munichoise s’identifiait avec
l’appel aux soviets, sinon avec la République pseudo-Soviétique.
Et ces travailleurs voyaient dans les manœuvres de Hoffmann une
menace pour les soviets, vrais ou faux. De plus en plus écœurés
par la farce burlesque, ils demandaient aux communistes de prendre
les choses en main et de mettre en place quelque chose d’authentique.
D’après la veuve de Leviné, « Dans de nombreux meetings
étaient adoptées des résolutions pour que « tout le
pouvoir » soit transmis aux communistes ».17
Au
début, les communistes se bornèrent à dire qu’ils étaient
opposés à la proclamation de la République Soviétique, mais
qu’ils seraient aux « avants-postes de la lutte »
contre toute tentative contre-révolutionnaire. Leviné exhorta les
travailleurs à élire des « délégués
révolutionnaires »
pour défendre la révolution. « Ainsi vous élirez des hommes
qui brillent du feu de la révolution, remplis d’énergie et de
combativité, capables de prendre des décisions rapides tout en
étant porteurs d’une vue claire du véritable rapport des forces,
pour (...) choisir sobrement et avec prudence le moment de
l’action », écrivait-il.18
Ce
n’est qu’avec de telles forces qu’une véritable république
des travailleurs pouvait être formée. Mais pour le moment tout cela
restait très hypothétique, dans la mesure où il était évident
que la pseudo-République des Soviets était sur le point de
s’effondrer, et toute l'expérimentation soviétique bâclée
serait terminée. Parler de la façon dont les délégués
révolutionnaires pouvaient former la base d’une véritable
république des soviets semblait se ramener à de la propagande
éducative. « Tout cela sera résolu à l’amiable »,
dit Leviné à sa femme le 12 avril. « Dans quelques jours
l’aventure sera liquidée ».
Mais
lorsque l’offensive contre-révolutionnaire fut lancée le
lendemain même, elle échoua lamentablement. Mieux, elle transforma
l’humeur jusque là passive des travailleurs :
Quand
la nouvelle du putsch se répandit, lune excitation terrible s'empara
des travailleurs. (...) L’iamertume envers le gouvernement de
Hoffmann (...) était universelle. La Social-Démocratie n’osait
pas appeler à des réunions publiques du parti, tellement grande
était leur peur que leurs propres partisans leur brisent le crâne.
Le Conseil Révolutionnaire appela à des manifestations de
protestation, ce qui ne provoqua que des railleries. L’unité du
prolétariat (...) était née en un instant de la volonté de
vaincre ou mourir !19
Les
travailleurs avaient maintenant l’énergie nécessaire pour créer
les véritables conseils ouvriers dont Leviné leur parlait. Ils lui
proposèrent, ainsi qu’au Parti Communiste, de prendre la tête
d’une nouvelle, authentique, République des Conseils. Il accepta.
Les communistes mirent toute leur énergie dans la création d’un
véritable système de conseils et d’un véritable gouvernement à
partir du chaos de la semaine passée.
La
Seconde République des Soviets était tout ce que la première
n’avait pas été. Elle était basée sur des conseils récemment
élus dans les usines. Cela lui permettait d’appliquer ses
décisions facilement. Elle décréta l’armement des
travailleurs :
10 à 20 000 fusils furent distribués. Elle ordonna le
désarmement de la bourgeoisie :
Le
Ministère de la Guerre était littéralement assiégé et des masses
toujours renouvelées y afflueaient en troupeaux. C'était les
bourgeois, venus livrer leurs armes. (...) Ils se poussaient (...)
pour se débarrasser le plus vite possibles des armes cachées sous
leurs manteaux. « C’est là le vote de confiance de la
bourgeoisie pour le nouveau gouvernement’ » remarqua Leviné.20
L’exécutif
des nouveaux conseils ouvriers décréta la grève générale :
pas une roue ne tournait dans la ville.
Des
patrouilles d’ouvriers en armes commencèrent à perquisitionner
dans les maisons bourgeoises à la recherche de stocks de nourriture
cachés à l’intention de la population affamée, à confisquer les
automobiles (à l’époque, bien sûr, un luxe de la classe
dirigeante), à installer des délégués révolutionnaires chargés
de superviser les banques.
Du 14
au 22 avril une grève générale eut lieu, mais les travailleurs
étaient dans les usines se tenant prêts à toute alarme. Les
communistes envoyèrent leurs faibles forces aux points les plus
importants. Sur leur proposition une commission militaire, une
commission pour le désarmement de la contre-révolution, un comité
de propagande, une commission économique, et une commission des
transports furent constitués. Le matelot Rudolf Egelhofer, qui avait
dirigé le combat du 13 avril, mit en œuvre de façon impitoyable en
tant que commandant de la ville et commandant en chef de l’Armée
Rouge le désarmement de la bourgeoisie. (...) L’administration de
la ville était prise en charge par les conseils d’usine. (...) Les
banques étaient bloquées, chaque retrait soigneusement contrôlé.
(...) La presse bourgeoise fut interdite. Les services du téléphone
et du télégraphe étaient constamment supervisés.21
L’efficacité
de la nouvelle République des Conseils gagna même le respect de
certaines sections de la classe moyenne. Des employés de bureau et
des petits fonctionnaires qui étaient très éloignés du communisme
se joignirent à la grève générale.
Comme
le disait un rapport officiel du 23 avril destiné au gouvernement
Hoffmann :
A de nombreuses reprises nous
avons
entendu dans les discussions de rue que la Bavière était destinée
à faire avancer la révolution mondiale, que le monde entier
ressemblait maintenant à la Bavière, etc. Ceux qui parlent sont
souvent des gens tout à fait raisonnables. Il était aussi très
souvent proclamé que la Bavière ne devrait avoir rien de commun
avec le gouvernement du Reich.
Ce
serait une erreur fatale si nous supposions qu’il existe à Munich
la même division claire entre les spartakistes et les autres
socialistes. Pour l’instant, la politique des communistes se donne
constamment pour but d’unir toute la classe ouvrière contre le
capitalisme et en faveur de la révolution mondiale.22
Dans
une démonstration de force impressionnante, « le dernier jour
de la grève générale le prolétariat armé de Munich manifesta. De
12 000 à 15 000 personnes défilèrent en armes dans
les
rues ».23
Egelhofer avait construit une véritable Armée Rouge, même si elle
n’était encore qu’à moitié entraînée. L’armée avait connu
un vrai succès militaire, même s’il était limité, lorsqu’une
de ses sections, commandée par Toller, avait trois jours plus tôt
rejeté les forces de Hoffmann au delà de la zone de Dachau.
Mais
dans toutes ces réussites il y avait quelque chose qui clochait.
Munich était une ville isolée, dont le pouvoir n’allait pas au
delà des autres grandes villes de Bavière. Ailleurs, la presse
bourgeoise et social-démocrate dépeignait la ville comme soumise à
une tyrannie anarcho-communiste, le sang coulant tous les jours dans
les rues. Dans toute la Bavière « libre » des
affiches
proclamaient :
La terreur russe, déclenchée
par des
éléments venus de l’étranger, fait rage dans Munich. Cette
situation honteuse ne doit pas durer un jour de plus, une heure de
plus. (...) Hommes des montagnes bavaroises, des plateaux et des
forêts, levez-vous comme un seul homme. (...) Dirigez-vous vers les
dépôts de recrutement.
Signé :
Hoffmann, Schneppenhorst.24
La
prise de la citadelle révolutionnaire isolée n’était plus qu’une
question de temps.
Quelques
semaines plus tard, le dirigeant communiste Paul Frölich écrivit un
article défendant la décision de proclamer la Seconde République
des Soviets. Il décrivait la proclamation de la Première République
comme « une absurdité » :
La Bavière n’est pas
auto-suffisante
économiquement. Ses industries sont extrêmement retardataires. Une
République Soviétique sans zones d’industrie de grande échelle
ni bassins houillers est impossible en Allemagne. De plus, ce n’est
que dans une poignée d’entreprises industrielles que le
prolétariat bavarois a véritablement un état d'esprit
révolutionnaire et débarrassé des traditions, illusions et
faiblesses de la petite bourgeoisie.25
Mais
toutes ces déficiences étaient toujours là pendant la Seconde
République des Soviets. Le seul changement était qu’un nombre
croissant de travailleurs voyaient les sociaux-démocrates et les
anarcho-Indépendants comme des poseurs.
Les conditions matérielles objectives s’étaient en réalité
aggravées avec la raréfaction des approvisionnements en carburant
et en produits alimentaires.
Étrangler
la ville économiquement ne demanda pas un grand effort au
gouvernement Hoffmann. Sans nourriture, sans charbon, il était clair
que l’effondrement de la République des Conseils n’était qu’une
question de semaines. Malgré sa merveilleuse efficacité, la Seconde
République ne pouvait d’un coup de baguette magique faire
apparaître nourriture et charbon. Les patrouilles parvinrent à
saisir un peu de ravitaillement chez les riches – mais c’était
loin d’être suffisant pour nourrir l’Armée Rouge, sans parler
de la masse des travailleurs. Les tentatives d’obtenir des produits
alimentaires pour les plus démunis ne pouvaient qu’aboutir à des
conflits avec les couches inférieures de la classe moyenne, que les
contre-révolutionnaires étaient ravis d’exploiter. Vers la fin de
la deuxième semaine, le ressentiment commença à monter y compris
dans les rangs des sections les plus radicales des travailleurs. Ils
souffraient de privations extrêmes et sentaient bien que la fin de
la République Soviétique était proche.
Les
dirigeants au rancart de la Première République étaient prêts à
profiter du développement du défaitisme. Toller parla à une
réunion très importante de l’assemblée des conseils d’usine le
26 avril. A peine quinze jours plus tôt, il avait exhorté les
communistes de prendre le pouvoir pour réparer les dégâts de son
propre passage aux affaires. Désormais il les dénonçait avec
aigreur : « Je considère que le gouvernement présent
est
un désastre pour les masses laborieuses bavaroises. Le soutenir
équivaudrait à mes yeux à compromettre la révolution et la
république soviétique ».
Son
ami le social-démocrate indépendant Klingelhofer s’exclama :
« Les communistes sont des terroristes capricieux. Leur
politique immédiate, avec ses revendications provocatrices, ne peut
qu’avoir des conséquences funestes ».
« Des
rumeurs furent répandues », raconte un témoin, selon
lesquelles « les dirigeants communistes s’étaient procurés
cinquante faux passeports en même temps qu’une grosse somme
d’argent et un aéroplane pour préparer leur fuite. Les discours,
y compris ceux de Toller et de ses amis, étaient épicés de termes
suggestifs tels que « éléments étrangers »,
« Prussiens », « Russes » – on
pouvait même
entendre dans le public l’inévitable épithète
« Juif ». »26
Il
était clair que les communistes avaient perdu la confiance d’une
classe ouvrière désormais démoralisée et défaitiste. Leviné
insistait pour que les conseils d’usine acceptent la démission de
son gouvernement, et essaya immédiatement de négocier la fin de la
République des Conseils.
Cela
aurait été possible trois semaines plus tôt, cela ne l’était
plus. Après l’échec de ses premières tentatives d’action armée
contre Munich, Hoffmann avait abandonné ses scrupules
« bavarois »
et s’était tourné vers Noske. Sous le commandement du général
Oven, 30 000 Freikorps faisaient route vers Munich. L’humeur
n’était pas au compromis. Les tentatives de bons offices des
Indépendants ne purent retenir la férocité des Freikorps. Bien au
contraire, elles aggravèrent la chute du moral dans la ville, avec
des querelles continuelles entre les partisans de Toller et les
communistes, et un flot de rumeurs contre ceux qui avaient assuré la
survie de la République des Conseils pendant les quinze jours passés
(on alla jusqu’à prétendre que Levien et Leviné avaient fait
main basse sur les pensions des grands blessés de guerre), ainsi
qu’un relâchement du contrôle sur les bourgeois et leur presse
qui permit à la contre-révolution de s’organiser une fois de plus
ouvertement à l’intérieur de la ville.
Lorsque
les Freikorps entrèrent finalement dans Munich le 1er
mai, il ne restait pas grand-chose de la République des Conseils.
Mais les Freikorps avaient mis à mort 20 auxiliaires médicaux non
armés à Starnberg, et les combattants de l’Armée Rouge savaient
que le choix était entre la résistance armée et l’exécution
sommaire. Ils ne pouvaient qu’être d’accord avec la déclaration
finale des communistes :
Les
Gardes Blancs n’ont pas encore conquis qu’ils accumulent déjà
les atrocités. Ils torturent et exécutent les gardes rouges faits
prisonniers, achèvent les blessés. Ne facilitez pas la tâche des
bourreaux. Vendez vos vies chèrement.27
Malgré
le fait qu’il n’y avait plus trace de gouvernement dans la ville,
il fallut aux Freikorps deux jours de combat pour réduire
complètement la résistance. Il y eut plus de 600 morts. La
répression la plus odieuse s’installa, comme l’admet l’histoire
universitaire la plus complète de la révolution bavaroise :
La
résistance fut rapidement brisée, et sans pitié. Les hommes
trouvés avec des fusils en leur possession étaient fusillés sans
procès et souvent sans interrogatoire. La brutalité irresponsable
des Freikorps continua à s’exercer sporadiquement les jours
suivants, les prisonniers politiques étaient battus et parfois
exécutés.28
Pour
justifier la boucherie généralisée, les Freikorps prirent argument
de l’exécution par les soldats révolutionnaires de dix otages,
essentiellement des membres du groupe antisémite précurseur du
nazisme, la Société de Thulé (hélas, par manque de chance un de
ses dirigeants, Rudolf Hess, n’était pas parmi eux). « Les
gens étaient tirés de leur lit, fusillés, poignardés, et
effroyablement battus ».29
Vingt et un apprentis catholiques tenaient leur réunion habituelle
lorsque les soldats les saisirent : « Les pauvres
garçons
furent battus, frappés à coups de pieds, percés de baïonnettes,
piétinés », avant d’être tués. « Des bâtons brisés
et des sabres tordus furent présentés comme pièces à conviction
lors du procès qui suivit ».30
L’horreur provoquée par cet incident mit un terme au règne du
meurtre – mais pas avant qu’il y ait eu 186 exécutions
militaires.
Il
ne manquait plus désormais au gouvernement Hoffmann qu’un
paragraphe sinistre pour clore le chapitre de cette République
Bavaroise des Conseils que son propre ministre de la guerre avait
inaugurée : le procès et l’exécution d’Eugen Leviné.
Pourtant, même cela éclaboussa en retour les sociaux-démocrates.
Car même si Leviné dut subir un assassinat judiciaire, ce ne fut
pas avant d’avoir prononcé un brillant discours dans lequel il
justifiait ses actes – un discours qui a dû amener nombre de
travailleurs allemands à rompre avec la social-démocratie une fois
pour toutes. Une phrase de ce discours est entrée dans la mythologie
révolutionnaire – peut-être parce qu’elle semble, prise
isolément, résonner de façon quasi-existentialiste. Mais elle vaut
d’être citée dans le contexte. Parce qu’elle ne résuma pas
seulement l’expérience munichoise, mais le cours tout entier de la
Révolution Allemande dans la première moitié de 1919 :
Les
socialistes majoritaires saisiront le premier prétexte pour se
retirer, trahissant délibérément les travailleurs. Les
Indépendants collaboreront, puis commenceront à vaciller, à
négocier et à se transformer inconsciemment en traîtres. Et nous,
communistes, devrons payer pour vos entreprises avec le sang des
meilleurs d'entre nous. (...) Nous autres communistes sommes des
morts en sursis. J'en suis totalement conscient.31
Un choix correct ?
Les
communistes avaient-ils eu raison de proclamer la Seconde République
des Conseils ?
Leviné
pensait qu’ils n’avaient pas le choix. Ils avaient critiqué
âprement la pseudo-République des Soviets et avaient dit aux masses
d’élire de véritables délégués révolutionnaires pour se
défendre. Les masses l’avaient fait – et s’étaient alors
tournées vers les communistes. Leviné pensa que, pour les
communistes, ne pas prendre le pouvoir équivaudrait à abandonner
les masses.
Sa
veuve, Rosa Leviné-Meyer, dit qu’il assuma la responsabilité du
pouvoir en sachant que la défaite était inévitable. Mais,
estimait-il, cette défaite physique avec les communistes à la tête
du mouvement était préférable à une défaite morale, les
communistes dirigeant la déroute.
Leviné
lui-même semble avoir nourri des illusions sur la possibilité d’une
issue victorieuse. Il dit, lors d’une réunion des conseils
ouvriers :
Le
danger n’est pas passé. Les Gardes Blancs pourraient nous
attaquer. La faim pourrait frapper aux portes de Munich. Mais Ebert,
Noske et Scheidemann ne peuvent tenir que pour quelques semaines. La
Saxe est en fermentation ; à Braunschweig une République des
Conseils a été proclamée. A l’étranger, la nouvelle de
l’établissement de la Première République des Conseils a été
accueillie avec jubilation. La Hongrie est une République des
Conseils. En Italie on regarde à présent avec espoir et joie du
côté de la Bavière. (...) Nous tenons un poste avancé. Les
prolétaire russe ont eux aussi tenu un poste avancé. Ils ont persévéré
et ils ont eu raison.32
Si
la proclamation de la Second République des Soviets reposait sur un
tel raisonnement, il ne fait aucun doute qu’elle était basée sur
une illusion. Non que les révolutions ne se répandent jamais. Mais
à la mi-avril le mouvement dans le reste de l’Allemagne était en
déclin ; la République Soviétique Hongroise se battait
désespérément contre une invasion étrangère ; les
sociaux-démocrates étaient fermement au pouvoir en Autriche. La
Bavière ne pouvait, dans de telles conditions, survivre plus de
quelques semaines au maximum.
En
fait, il semble que Leviné n’en soit venu à accepter cette
évaluation trop optimiste que quelque temps après avoir pris le
pouvoir (voir son discours sur les quais).33
Son motif personnel semble avoir été plus proche de l’argument
reproduit par sa veuve – qu’il ne pouvait pas abandonner la
classe. Paul Frölich écrivit peu de temps après, en justification
de ses actes, de la défaite du putsch de droite du 13 avril
Elle
rconduisit à la victoire, et cette victoire devait être liquidée.
Il n’y avait plus de retour en arrière possible à présent. La
pré-condition la plus essentielle existait : l’action
victorieuse des masses. La République des Conseils était la seule
possibilité. Nous nous mîmes sans réserve à la disposition de la
classe ouvrière.34
Cette
défense de la décision de Leviné provoqua une violente rebuffade
du plus éminent dirigeant du KPD d’alors, Paul Levi. Il
distinguait trois phases dans la lutte. Dans la première, il y avait
la « pseudo-République des Conseils », disait-il. Les
communistes de Munich l’avaient dénoncée de façon « tout à
fait juste ». Puis il y avait eu l’attaque d’Hoffmann. Les
communistes avaient à nouveau raison de s’y opposer – non pas
parce qu’ils combattaient pour la pseudo-République des Soviets
(« La République des Conseills de Toller-Mühsam »
n’était « rien » ; « on ne défend
pas pour
un rien ») mais parce que «par cela certaines positions
réelles conquises par le prolétariat » étaient défendues
« qu'il avait conquis justement à Munich pendant les mois de
la révolution ».
Les particularités de la
Bavière
signifiaient que même une défense armée – hors de question
ailleurs en Allemagne – était possible. (...) La situation à
Munich était telle que le prolétariat n’était obligé de
regarder passivement comment les droits qu'il avait acquis durant la
révolution lui étaient confisqués.
Le gouvernement Hoffmann
était
impuissant, mais il hésitait à faire appel à Noske. Par
conséquent, « le gouvernement Hoffmann allait devoir trouver
un arrangement avec le prolétariat munichois, fût-ce à
contre-cœur ».
Mais,
juge Levi, c’était une erreur fondamentale que de proclamer la
Seconde République des Conseils. « Si la masse entre dans des
actions qui ne sont révolutionnaires qu'en apparence et qui en
réalité ne mènent qu’à des reculs, c’est notre devoir de nous
signaler par des avertissements et des critiques » même si
« on comprend aisément aussi combien c’est particulièrement
dur pour nous, (...) lorsque les masses passent à l’action et que
nous devons leur dire que l’action est inutile. »35
Il
ne fait aucun doute que les critiques de Levi sont essentiellement
correctes – même s’il sous-estimait l’importance, pour les
communistes, de montrer leur solidarité avec les éléments
impatients qui voulaient se battre, tout en faisant les critiques
nécessaires de leur action (un défaut de Levi sur lequel nous
aurons l’occasion de revenir).
Leviné
a montré comment la direction communiste peut transformer la
capacité des masses à agir. La Seconde République Bavaroise des
Conseils fut un excellent exemple de la façon dont les travailleurs
peuvent organiser la vie dans une grande ville moderne – à cet
égard elle était proche de la Commune de Paris. Mais les exemples,
aussi excellents soient-ils, n’assurent pas la victoire de la
nouvelle société. A Munich, le résultat fut une défaite
désastreuse de toute la classe ouvrière. A partir de là, les
Freikorps et l’extrême droite avaient les mains libres en Bavière
– dix mois plus tard, ils déposaient ce même gouvernement
Hoffmann qui leur avait ouvert les portes de Munich.
Il
n’y avait, bien sûr, aucune garantie qu’une décision différente
de Leviné eût évité la défaite : à cet égard, sa décision
était dure à prendre, et pas du tout de la même nature que la
folie de Liebknecht en janvier. Hoffmann aurait peut-être eu recours
aux Freikorps de toute façon, et les Freikorps auraient pu prendre
brutalement leur revanche sans avoir besoin de prétextes. Mais ce ne
sont pas des certitudes. Ce qui est certain, c’est que, une fois
proclamée, la Seconde République Bavaroise des Conseils était
condamnée à la défaite, et avec elle la classe ouvrière de
Bavière.